Les Cahiers de notes sur…
Les Cahiers de notes sur… accompagnent les films du catalogue École et cinéma.
Ces livrets verts proposent un éclairage sur les films plutôt qu’un « mode d’emploi pédagogique ». Ils ont été conçus autour d’un point de vue fort et personnel.
Les axes de lecture proposées ne sont pas des recettes, mais davantage des notes personnelles sur la manière d’exploiter les films. Chaque cahier comporte :
-
- un résumé du film,
- une image-ricochet,
- un déroulant retraçant le film,
- l’analyse d’une séquence
- des promenades pédagogiques,
- une courte bibliographie.
Les Cahiers de notes ont été numérisés en septembre 2016, ils peuvent être désormais consultés sur la plateforme NANOUK (matériel pédagogique accessible uniquement aux enseignants et partenaires culturels participant au dispositif sur inscription).
Le Garçon aux cheveux verts
Il était une fois…
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Jacques Aumont
 Le film raconte donc, en fin de compte, simplement le passage de l’enfance à autre chose que l’enfance, et la lutte, dans ce passage et pour s’en rendre maître, entre plusieurs puissances : celle de la société civile, avec ses faiblesses, ses certitudes mesquines, mais aussi sa sécurité ; celle de la société angélique des forces du bien et du vrai, avec ses âmes et ses mains pures – mais aussi, son absence de mains ; celle de la Nature, au sein de laquelle incessamment l’enfant est tenté de se replonger. Les cheveux verts sont le déclencheur – apporté par le vent du hasard, comme de petites graines invisibles – à partir duquel ces puissances vont pouvoir se manifester, conflictuellement. La société des hommes n’a à proposer qu’une chose, un rite collectif, purificateur et initiatique, dont le film évoque deux variantes, sauvage et spontanée, dans la clairière, ou organisée et civilisée, dans un lieu de rencontre civile (voire civique), le salon de coiffure. Les anges de la Paix, eux, offrent un autre passage, une autre façon de grandir : devenir prophète et témoin ; s’exclure volontairement du social pour sauver le monde ; devenir pur, coïncider avec une volonté et un principe.
Le film raconte donc, en fin de compte, simplement le passage de l’enfance à autre chose que l’enfance, et la lutte, dans ce passage et pour s’en rendre maître, entre plusieurs puissances : celle de la société civile, avec ses faiblesses, ses certitudes mesquines, mais aussi sa sécurité ; celle de la société angélique des forces du bien et du vrai, avec ses âmes et ses mains pures – mais aussi, son absence de mains ; celle de la Nature, au sein de laquelle incessamment l’enfant est tenté de se replonger. Les cheveux verts sont le déclencheur – apporté par le vent du hasard, comme de petites graines invisibles – à partir duquel ces puissances vont pouvoir se manifester, conflictuellement. La société des hommes n’a à proposer qu’une chose, un rite collectif, purificateur et initiatique, dont le film évoque deux variantes, sauvage et spontanée, dans la clairière, ou organisée et civilisée, dans un lieu de rencontre civile (voire civique), le salon de coiffure. Les anges de la Paix, eux, offrent un autre passage, une autre façon de grandir : devenir prophète et témoin ; s’exclure volontairement du social pour sauver le monde ; devenir pur, coïncider avec une volonté et un principe.
La Belle et la Bête
Une fiction du désir
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Jacques Aumont

En même temps, de cette logique du rêve, Cocteau utilise une forme déjà symbolisée, celle du conte merveilleux. […] La nature du merveilleux, de la poésie dont il est l’autre nom, c’est de renoncer à raisonner – non pas de renoncer à l’intelligence ni à la capacité de logique, mais renoncer à « comprendre », c’est-à-dire à établir les liaisons habituelles quotidiennes, devenues fausses à force d’habitude. Sésame de la poésie – dont Cocteau devait faire le sous-titre de son ultime film et testament : « Ne me demandez pas pourquoi. » Le carton mis en exergue de La Belle et la Bête nous demande expressément de nous faire naïfs comme des enfants, de suspendre volontairement notre incrédulité, selon l’indépassable expression de Coleridge («willing suspension of disbelief»). Mais, si nous, spectateurs adultes, devons retrouver la vertu enfantine de croyance, ce n’est pas seulement pour être mis, par ce film, dans un état de sensibilité particulier ; s’il est fait appel à ce qui reste en nous d’enfance, à sa réceptivité particulière, c’est qu’il s’agit d’accepter une fiction toujours difficile : la fiction du désir.
Jour de Fête
Le temps à retrouver
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Jacques Aumont

« J’avais été requis par les Allemands en 43, et puis je m’étais évadé, et j’étais allé me réfugier au Marembert, qui est situé à six kilomètres de Sainte-Sévère. Là j’ai été surpris, parce qu’il y avait la guerre, mais on avait l’impression qu’à l’intérieur même de Sainte-Sévère, on ne s’en apercevait pas du tout. C’est quand même formidable de voir des gens qui savent vivre. J’ai pensé que si un jour je faisais un film, je viendrais le tourner
là. » Trois ans plus tard, Jacques Tati réalisait ce souhait ; après avoir fait semblant d’en chercher les extérieurs dans le Midi, il finirait par tourner L’École des facteurs presque entièrement dans le sud du département de l’Indre, dans ce qu’il n’était pas besoin alors d’appeler « France profonde », parce que cette profondeur (ou profondité) était banale. Tati filme aussitôt après un conflit armé qui a marqué durablement l’histoire de l’Occident, et par contre-coup, l’histoire du monde ; il filme en un moment où les affrontements, pour avoir changé de nature et redéfini autrement les camps, restent violents. Moins brutalement peut-être que dans l’Italie, qui se divise alors entre sa moitié communiste et sa moitié chrétienne, la politique en France connaît pourtant un clivage analogue. Ily a les défenseurs de l’ordre démocratique et libéral, et les tenants d’un ordre nouveau, qui attendent le grand soir ; la presse de 1946 – parce qu’elle est alors le média le plus immédiatement proche de l’actualité politique – est ostensiblement scindée, presse communiste contre presse impérialiste (il n’est jusqu’aux illustrés pour enfants qui le reflètent, avec l’opposition quasi militante entre par exemple le christianisme conquérant de Tintin et l’humanisme marxiste de Vaillant). De la défense de l’Empire, il ne reste dans Jour de fête qu’une trace, marginale et généralement inaperçue, sous la forme d’une affiche qui, dans le bureau de poste de Sainte-Sévère-sur-Indre, annonce discrètement : « Au service de l’Union française » (encore peut-il s’agir d’une union postale). Quant au grand soir, c’en est bien une version, mais absolument carnavalesque, qui est donnée : les rapports sociaux sont redéfinis, le temps de la fête, mais comme dans une parenthèse acceptée et une fois pour toutes réglée. Tati le dit bien : ce qui lui a plu à Sainte-Sévère, ce qui l’a intéressé, c’est précisément qu’il s’agit d’un endroit hors du temps, hors de l’époque et hors de l’histoire, d’un coin de France, et rien d’autre (après tout, le facteur s’appelle exactement François, et même « Françoués »). La France rurale du milieu du vingtième siècle est prodigieusement attardée : c’est ce dont se souvient quiconque a séjourné à la campagne en ces années-là (pas d’eau courante, pas de tout-à-l’égout, pas toujours l’électricité, jamais de téléphone évidemment). Un pays pas très riche, qui en outre sort de la guerre, où par conséquent les gens sont encore maigres, plutôt mal nourris (les grandes grèves de 1946 à 48 n’arrangèrent rien, ce fut par moments une pénurie pire que celle du temps de guerre). Les paysans y labourent avec un unique cheval, y moissonnent avec d’antiques instruments de bois, fourches et râteaux rudimentaires, à force de bras. Jour de fête ne parle pas de tout cela, mais il l’enregistre avec le reste ; les gestes des paysans que fugitivement l’on aperçoit, avant et juste après la fête, sont les vrais gestes qu’accomplissaient journellement des familles qu’il fallait nombreuses pour avoir des bras (ces bras dont, dans les discours des ministres, manquait l’agriculture) ; les tracteurs sont absents, et seul le forain en possède un – ce qui dès le premier plan le distingue et dit déjà que la fête est une greffe toute provisoire sur le corps rural.
Le pays de l’innocence
Ce pays « où les gens savent vivre », et où – c’est le sens de la remarque de Tati – ils savent vivre parce qu’ils échappent aux vicissitudes du temps, c’est donc le pays où perdure en dépit de tout un certain état d’innocence. Le pays où se déroule la fête est un pays inexistant au milieu de nulle part, habité par des êtres qui n’ont pas d’histoire, et par conséquent pas d’âge…
Le poème et l’image
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Stéphane Bataillon et Stéphane Dreyfus
En sortant de l’école fait figure d’ovni pour qui connaît les contraintes du marché de l’animation pour enfants destiné à la télévision. La série animée, objet de commande visant à faire le plus d’audience et à attirer des fabricants de produits dérivés, n’a bien souvent rien de la performance artistique – quand elle n’a pas été créée uniquement pour vendre une gamme de jouets… Prendre comme sujet la poésie, genre littéraire qui, même sur son propre marché, ne vaut pas grand-chose en termes de poids économique (à peine 1 % de la vente totale de livres en France) est un risque certain.
Bonjour
Les drôles d’espaces de la parole
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Bernard Benoliel
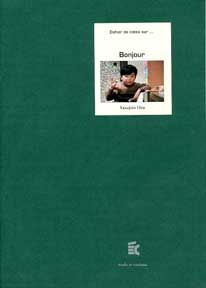 En 1960, Yasujiro Ozu évoque nombre de ses films pour la revue japonaise Kinema Jumpo, et parmi eux Bonjour tourné l’année précédente : « J’ai pensé à cette histoire pendant longtemps. On peut bavarder à l’infini sur des choses insignifiantes, mais quand on arrive à l’essentiel, il est très difficile de dire quoi que ce soit. Je voulais faire un film sur cela bien que sachant qu’il serait très difficile d’exprimer ce genre de situation.(…) Au début, je pensais que cette histoire pourrait être plus calme et plus sobre. Mais professionnellement, comme je pensais à faire de l’argent, j’ai rendu l’histoire plus humoristique. En fait, il serait plus juste de dire que je désirais que les gens viennent voir ce film plutôt que de faire de l’argent. »
En 1960, Yasujiro Ozu évoque nombre de ses films pour la revue japonaise Kinema Jumpo, et parmi eux Bonjour tourné l’année précédente : « J’ai pensé à cette histoire pendant longtemps. On peut bavarder à l’infini sur des choses insignifiantes, mais quand on arrive à l’essentiel, il est très difficile de dire quoi que ce soit. Je voulais faire un film sur cela bien que sachant qu’il serait très difficile d’exprimer ce genre de situation.(…) Au début, je pensais que cette histoire pourrait être plus calme et plus sobre. Mais professionnellement, comme je pensais à faire de l’argent, j’ai rendu l’histoire plus humoristique. En fait, il serait plus juste de dire que je désirais que les gens viennent voir ce film plutôt que de faire de l’argent. »
Relations et dépendances
Ces propos d’Ozu rappellent au premier abord une des belles singularités du cinéaste : loin de traiter de sujets spectaculaires, un désir au contraire d’observer avec insistance la vie quotidienne pour la transfigurer en fictions populaires. Des propos qui invitent aussi à penser que le sujet principal de Bonjour serait incarné par deux personnages en particulier, pas forcément les plus en vue dans le récit (mais on verra la valeur toute relative de cette dernière impression) : le professeur d’anglais et la jolie Setsuko, deux jeunes personnes timides qui éprouvent sans doute la naissance de l’amour en leur for intérieur, n’en laissent rien paraître (sauf une affabilité accentuée et réciproque) et recourent à des conversations passe-partout plutôt que d’oser un aveu : « On peut bavarder à l’infini sur des choses insignifiantes, mais quand on arrive à l’essentiel, il est très difficile de dire quoi que ce soit. » Et ces deux personnages seraient d’autant plus le sujet principal que les noms des deux acteurs: Keiji Sada dans le rôle du professeur et Yoshiko Kuga dans celui de la jeune femme, vedettes du cinéma japonais de l’époque, apparaissent les premiers au générique. Dans ce cas, et comme le dit aussi Ozu avec un repentir, la part comique de Bonjour serait venue après, en plus (plus-value), comme un ajout commercial donc et non comme l’indispensable contrepoint qu’elle représente. Car la vision de Bonjour contredit la relecture par Ozu du scénario de Bonjour : est-ce dû à la photogénie des deux garnements, en particulier à la bouille et à la gestuelle irrésistible du plus petit des deux, Isamu ? À l’effet causé par l’irruption de l’objet télévision dans l’univers codé et très « japonisant » d’Ozu ? L’impression semble bien inverse, celle d’une intrigue principale construite autour des enfants et d’une intrigue secondaire faite d’une histoire d’amour balbutiante, matière plus « ordinaire » somme toute de beaucoup de films du cinéaste. Oui, mais à la réflexion, on peut en dire autant de la télévision comme apparition d’un signe moderne dans l’espace traditionnel ; il suffit de penser au panneau « Drink Coca-Cola » sur le chemin de la plage dans Printemps tardif, à l’enseigne lumineuse « New Japan » qui ouvre Dernier Caprice ou aux images de base-ball dans Le Goût du saké. Et puis, qui dit que le ressort principal de Bonjour n’est pas plutôt le jeu du pet à la commande inventé par les enfants ou cette histoire de commères et de cotisations envolées, ou encore la crise qui couve et trouve sa forme paradoxale dans la « grève de la parole » des deux frères ?

L’Argent de poche
Un film construit sur l’intervalle
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Alain Bergala
Dans ce texte, Alain Bergala analyse la façon dont Truffaut a construit son film sur « l’intervalle » et fait un rapprochement avec le « jeu de la bobine » cher à Sigmund Freud. Voici un passage de sa conclusion.
Le naturalisme consiste à filmer les choses pour elles-mêmes, une par une, dans leur naturalité, plutôt que la relation de ces choses entre elles, ou ce qui se joue entre elles, dans l’intervalle qui les sépare. L’unanimisme consiste à créer des figures faussement diversifiées pour finir par affirmer entre elles une ressemblance « de nature ». Rien de tel dans L’Argent de poche où l’apparence aimable, légère, n’est que le fait de l’élégance de François Truffaut à ne pas mettre en avant la profonde fêlure biographique sur laquelle il bâtit cette œuvre, fêlure que l’on peut deviner dans cette omniprésence d’un intervalle fondamentalement irréductible dans l’univers de ces enfants, mais qui l’éloigne de tout pathos affiché par un habillage relativement lisse et apparemment souriant. Truffaut avec ce film, a refusé avant tout de se « servir de l’enfance » pour le pathos du film, même si le sujet l’affectait en profondeur et personnellement. Il est loin d’en avoir fait, pour autant, un film réconcilié.

Les contrebandiers de Moonfleet
Le Père, le Mal et l’Initiation
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Alain Bergala
C’est très précisément d’initiation que parle ce film aux enfants qui le regardent. Aujourd’hui, comme il y a trente ans. L’initiation, contrairement à ce qu’il y a toujours d’accompagnement et de préservation dans l’apprentissage pédagogique, c’est d’être d’abord confronté sans trop de ménagements au monde des adultes, et à tout ce qu’il peut y avoir de troublant et d’incompréhensible dans ce monde : le mal, en premier chef, la sexualité, la trahison, la violence, la mort, etc. John, petit orphelin, va être littéralement confronté à toutes ces choses dont on protège d’ordinaire les enfants sous prétexte qu’elles ne les concernent pas encore. Comme le frère et la sœur de La Nuit du chasseur de Charles Laughton, comme le petit garçon inoubliable du très beau film de Clint Eastwood : Un monde parfait. Ou encore le petit Edmund d’Allemagne année zéro de Rossellini. Comme par hasard, il s’agit là des plus grands films sur l’enfance de l’histoire du cinéma, et qui tournent tous autour de figures inquiétantes de pères, réels ou adoptifs…
Jeune et innocent
Un scénario peut en cacher un autre
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Alain Bergala

Comme souvent chez Hitchcock, le film se construit sur un double scénario : le scénario de surface, anecdotique, qui est le scénario policier, ici celui du faux coupable, et le scénario de fond, qui commence à hanter Hitchcock, celui de la naissance de l’amour et de la séparation d’avec la loi parentale, nécessaire et angoissante. Le génie d’Hitchcock tient à sa façon inimitable d’articuler les deux. La musique du générique, qui passe sans transition d’une musique de type « dramatique » à une musique sentimentale, annonce à la façon d’une ouverture d’opéra les deux « couleurs » qui vont être celles du film et qui correspondent à ces deux scénarios. Le scénario de surface emprunte ici le grand schéma hitchcockien du « faux coupable », qui aura une très grande postérité dans son œuvre. […] Le scénario de fond (véritable sujet du film) est celui de la naissance de l’amour entre une jeune fille sage et un garçon inconnu à la (provisoire) mauvaise réputation.
Où est la maison de mon ami ?
Ahmad et la porte de la loi
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Alain Bergala

« Si tout le monde cherche à connaître la Loi, dit l’homme, comment se fait-il que depuis si longtemps personne que moi ne t’ait demandé d’entrer ? » Le gardien voit que l’homme est sur sa fin et, pour atteindre son tympan mort, il lui rugit à l’oreille : « Personne que toi n’avait le droit d’entrer ici, car cette entrée n’était faite que pour toi, maintenant je pars, et je ferme.»
Franz Kafka, Le Procès
Au commencement était la détresse
Le premier court métrage de Kiarostami, Le Pain et la Rue, racontait déjà l’histoire d’un enfant en détresse. Ce premier petit garçon, prototype du héros kiarostamien, se trouvait immobilisé par un chien inconnu alors qu’il était sur le chemin du retour vers sa maison avec le pain du repas familial (l’objet de sa mission) sous le bras. Le cinéaste débutant prenait déjà tout son temps pour filmer avec beaucoup d’attention cet état de détresse, comme s’il y avait là, pour lui, une expérience fondamentale de l’enfance, dont les adultes mesurent rarement la gravité et le caractère fondateur. Ils commettent souvent l’erreur de mesurer la gravité d’une détresse enfantine à l’importance réelle, pour eux, de sa cause. Quiconque fait l’effort de se souvenir des moments d’angoisse et de terreur qu’il a connus dans sa propre enfance sait bien que ces détresses qui l’ont pourtant constitué en profondeur étaient souvent causées par des événements objectivement mineurs, voire minuscules aux yeux des adultes. Ce sera l’une des premières caractéristiques du cinéma de Kiarostami : filmer les enfants en étant extrêmement attentif à l’échelle d’intensités qui est celle de leur expérience de la vie, de leurs affects, sans jamais les mesurer à une échelle (plus tardive et hiérarchisée) qui est celle des adultes. C’est une des raisons pour lesquelles les films de Kiarostami ne sont pas des films pour enfants, mais des films sur les enfants, qui nous font partager leurs expériences de détresse, de transgression, et de peur devant les mystères incompréhensibles de l’univers. La posture du cinéaste consiste à tenir ces expériences de l’enfance pour aussi graves, sinon plus, que celles des adultes telles que les films sur les adultes essaient de nous les raconter. Vu sous cet angle, et non sous celui de l’anecdote, Où est la maison de mon ami ? est un film qui nous fait partager un éventail d’affects et d’émotions de la plus haute gravité. L’apparente minceur du scénario (un enfant a emporté par erreur le cahier de son ami et s’efforce de réparer cette erreur) cache un film où se jouent des questions aussi essentielles que celles de la Loi, du libre arbitre, de la transgression, de la solidarité, de la peur de l’inconnu, de la solitude existentielle, du sentiment du mystère cosmique de l’univers. Ce qu’a compris très tôt Kiarostami, dès son premier court métrage, c’est qu’il n’y a pas de « petit » sujet : la seule chose qui compte, c’est la qualité d’expérience que la traversée d’un film nous permet de faire. Le petit Ahmad, à la recherche de la maison de son ami, en fait une qui vaut en gravité et en intensité celle d’Antigone (opposant les exigences de sa conscience, de sa dette personnelle, à la Loi sociale), de Sisyphe (toujours prêt à repartir à l’assaut de la colline, comme le bousier de Le vent nous emportera) ou du K. de Kafka égaré dans le labyrinthe d’un monde aux lois incompréhensibles, sinon absurde où il est amené à connaître les angoisses de l’incommunicabilité et de la misère de sa propre solitude existentielle dans un monde peuplé de figures énigmatiques.
Le Petit Fugitif
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Alain Bergala

D’où vient l’aspect radicalement novateur de ce film, de sa forme, de son style ? En premier lieu de sa méthode, à nulle autre pareille au milieu des années 50. Et d’où vient cette méthode ? De la singularité de ce projet en marge de l’industrie et des codes du cinéma de l’époque. De son économie « pauvre » qui en a garanti la liberté. Cette méthode, tout sauf anarchique, invente ses propres principes. On les retrouvera dans les films de la Nouvelle Vague et de la modernité.
Premier principe. C’est Jean Renoir qui l’a énoncé en premier : « au cinéma il faut être passif avant d’être actif ». Passif, c’est-à-dire observer avant de mettre en scène ; prendre le temps de s’imprégner du décor, de l’atmosphère, de la lumière, de la météorologie ; se laisser absorber par le milieu avant d’agir, le plus discrètement possible, sur ce milieu. Le concept du plan n’écrase pas le réel, il s’y adapte en souplesse, il y germe, voire il s’y transforme. La maîtrise n’est pas le pouvoir de forcer le réel mais de se laisser impressionner par lui avant de mettre en scène. Cette méthode, Morris Engel n’a pas eu à la trouver, c’était la sienne en tant que photographe. Sa force a été de ne pas vouloir mimer ce qu’il ne connaissait pas (un tournage cinéma) mais de se faire confiance à partir de ce qu’il savait faire : se promener dans la réalité, y être le plus invisible et le plus attentif possible, et prélever ses images discrètement, parfois à la sauvette, dans les rues et dans la foule des baigneurs de Coney Island. Ce principe induit une mise en scène tout à fait particulière, qui est rarement celle de la fiction. La caméra, petite et discrète, et l’acteur, anonyme, doivent s’intégrer à la foule des figurants, à hauteur d’homme ou d’enfant, sans jamais attirer l’attention sur le fait qu’il s’agit d’un tournage de film. Choisir un point de vue, un cadre, répéter discrètement et lancer la prise sans clap ni perche (le film a été tourné en muet) avec la caméra à hauteur d’enfant. Dans les scènes des rues et des terrains vagues de Brooklin, au début du film, le cinéaste n’a pas eu non plus à inventer quelque chose à partir de rien ni encore moins à forcer le réel. Ce quartier populaire, sans être pauvre, c’était celui de son enfance et il en connaît les territoires, les agencements d’espaces et les jeux. La mise en scène devient limpide pour qui connaît depuis toujours la scène où elle se joue.
Ponette
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Alain Bergala

De Ponette je dirai d’abord que c’est une des plus belles leçons de confiance dans le cinéma que je connaisse. Pour entreprendre un tel film, il a fallu au cinéaste une ténacité à toute épreuve et croire avec la foi du charbonnier qu’il pouvait demander au cinéma quelque chose que personne ne lui avait jamais demandé et que le cinéma aurait la générosité de lui donner en échange. C’est ce qui s’est passé. Rien pourtant ne garantissait que ce projet insensé ait une chance d’aboutir, et d’aboutir à un film de cette force d’évidence et de cette maîtrise de mise en scène. Tout le menaçait d’échouer ou de devenir fortement antipathique : le pari de faire porter le rôle principal et permanent sur les épaules d’une petite fille de quatre ans ne sachant pas lire ; le danger pour un adulte d’écrire les dialogues d’enfants de cet âge ; le danger de manipulation, voire d’exploitation de l’enfance au bénéfice de la réussite du film ; le danger des émotions faciles et du chantage sentimental quand on parle d’une enfant qui vient de perdre sa mère ; le danger de baisser les exigences de la mise en scène devant la difficulté de travailler avec des acteurs si petits : le dangerde faire sur un tel sujet un film malaisant dont le spectateur sortirait en état d’angoisse, avec une boule dans la gorge. C’est un film unique qui prouve que si le cinéaste fait confiance au cinéma et à sa relation aux acteurs, s’il est bien au clair avec ses intentions, s’il a une solide morale du cinéma et s’il est prêt à prendre tous les risques, le miracle peut avoir lieu et il peut éviter les nombreux écueils qui menaçaient son projet et parvenir à réaliser un film limpide, mis en scène avec la plus grande rigueur, au-dessus de tout soupçon quant à son rapport à l’enfance, un film dont l’émotion n’est jamais obtenue par un quelconque chantage aux sentiments et dont on sort – que l’on soit grand ou petit – parfaitement apaisé, plus léger et confiant dans les puissances de la vie qu’on n’y était entré.
Une expérience vécue au présent du personnage
Le sujet aurait pu s’y prêter mais on chercherait en vain une once de morbidité dans ce film où l’on partage sans la moindre avance ni surplomb ce que vit ce personnage de quatre ans qui vient de perdre sa mère. Et devant le mystère de la mort et du deuil, où nous sommes toute notre vie toujours aussi démunis, où personne n’a de l’avance sur personne, le personnage de Ponette, dans cette traversée du deuil le plus lourd à porter qui soit pour une enfant, celui d’une mère, nous permet d’approcher l’incompréhensible, l’inacceptable – la mort subite d’un proche – par notre expérience de spectateur du film. Doillon, en effet, s’est farouchement refusé à tout effet de surplomb sur ses personnages et quand il déclare qu’il a beaucoup appris de cette petite fille sur son propre rapport au scandale de la mort, il faut le prendre au pied de la lettre. Ce film est le contraire d’un film où le cinéaste penserait en savoir plus que son personnage d’enfant sous prétexte que c’est un enfant, ou, pire, utiliserait une enfant pour créer du pathos sur son dos. Ce que l’on sent en permanence dans Ponette, c’est que Doillon, Ponette, Victoire (l’actrice qui l’incarne) le film lui-même, le spectateur, avancent en même temps, au même pas, dans l’inconnu de cette traversée du deuil. Jour après jour, scène après scène, ce que fait Ponette ne semble jamais obéir à un scénario qui en saurait plus qu’elle sur l’état où elle en est avec la mort de sa mère. Et nous, spectateurs, vivons son expérience au présent avec le sentiment que tout est ouvert, que chaque séquence qui arrive apporte des expériences, des recherches, des hypothèses de vie nouvelles dont nous ne savons pas au moment où nous les partageons si elles seront viables ou non, ni quel sera leur avenir. Il était essentiel pour que le film donne le sentiment d’avancer au pur présent d’une expérience que Victoire, la petite actrice, soit parfaitement synchrone au tournage avec le présent de chaque scène. Tout reposait donc sur son travail d’actrice. Doillon sait depuis longtemps que c’est de la relation entre le cinéaste et le comédien que dépend la réussite du jeu d’acteur. Il lui fallait donc trouver le bon rapport de travail avec Victoire et compter sur elle, comme sur une actrice adulte, pour donner l’impression au spectateur, à chaque plan, qu’elle ne sait pas d’avance ce qu’elle va faire ni dire dans la fraction de seconde qui va suivre, même lorsqu’elle a un texte écrit à dire et des indications de mise en scène très précises à jouer. La petite actrice y est parvenue avec une incroyable puissance d’invention, sans jamais donner l’impression d’anticiper sur les gestes, les mimiques, les postures, les mots qui vont être les siens. Le spectateur, par son truchement, a l’impression d’expérimenter avec elle, en même temps qu’elle, quelque chose de la traversée de ce moment difficile de la vie, et d’en sortir avec la force (par procuration) de cette expérience dont Ponette sort elle-même renforcée dans son désir de vivre.
La Vie est immense et pleine de dangers
Dans l’hôpital apprivoisé, un parcours initiatique
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Marie-Christine Pouchelle, ethnologue, directeur de recherche au CNRS, Centre d’ethnologie française, Musée national des arts et traditions populaires

L’hôpital est généralement perçu comme un monde à part, aussi bien par les malades et leurs proches que par les équipes soignantes. Monde à part en raison des enjeux vitaux qui sont sa raison d’être, à cause de la proximité quotidienne de la souffrance, de la détresse et de la mort. Mais aussi parce que lesreprésentations scientifiques du corps et de la maladie qui y ont cours ne sont pas toujours familières, tant s’en faut, à ceux qui viennent y chercher la guérison. D’ailleurs, même lorsque ces savoirs appartiennent aux patients (quand ces derniers sont eux-mêmes médecins par exemple) ils sont par définition décalés par rapport aux évidences immédiates que le corps, ses alchimies internes et la maladie éveillent chez tout individu. À ce décalage, le film fait allusion lorsqu’on nous montre l’échographie subie par Cédric, ou lorsqu’au téléphone le médecin décrit à son correspondant la tumeur de Dolorès, tandis que la caméra est fixée sur le visage de l’enfant inquiète.
Dans l’hôpital apprivoisé, un parcours initiatique
La vie est immense et pleine de dangersExtrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Marie-Christine Pouchelle, ethnologue, directeur de recherche au CNRS, Centre d’ethnologie française, Musée national des arts et traditions populaires

L’hôpital est généralement perçu comme un monde à part, aussi bien par les malades et leurs proches que par les équipes soignantes. Monde à part en raison des enjeux vitaux qui sont sa raison d’être, à cause de la proximité quotidienne de la souffrance, de la détresse et de la mort. Mais aussi parce que lesreprésentations scientifiques du corps et de la maladie qui y ont cours ne sont pas toujours familières, tant s’en faut, à ceux qui viennent y chercher la guérison. D’ailleurs, même lorsque ces savoirs appartiennent aux patients (quand ces derniers sont eux-mêmes médecins par exemple) ils sont par définition décalés par rapport aux évidences immédiates que le corps, ses alchimies internes et la maladie éveillent chez tout individu. À ce décalage, le film fait allusion lorsqu’on nous montre l’échographie subie par Cédric, ou lorsqu’au téléphone le médecin décrit à son correspondant la tumeur de Dolorès, tandis que la caméra est fixée sur le visage de l’enfant inquiète.
Le monde hospitalier et la tradition du secret technique
D’autre part l’hôpital lui-même s’est beaucoup revendiqué comme lieu initiatique distinct de l’espace profane pour les corporations professionnelles qui y exercent leurs savoirs. En excluant les familles des espaces de soins (ce qui n’est pas le cas dans le service où est hospitalisé Cédric) les soignants ont longtemps cherché non seulement à conserver l’exclusivité de leurs savoir-faire, mais peut-être aussi à esquiver le regard que les profanes pourraient porter sur leurs pratiques. En sus de leurs nécessités techniques, ces pratiques ont en effet une dimension rituelle qui ne renvoie pas aux malades mais à la dynamique interne de l’équipe soignante en tant que groupe social. De sorte que l’opacité bien connue de nombre d’institutions thérapeutiques protège encore souvent non pas le malade mais la « cuisine » hospitalière dont il est l’objet. Au sortir de cet espace relativement étranger qu’est l’hôpital, les patients n’ont pas acquis un véritable statut d’initiés au savoir médical, même si, surtout dans le cas de traitements prolongés, ils finissent par posséder une certaine compétence (voir l’épisode où Cédric s’inquiète de son cathéter). L’interdit qui continue de peser sur le dossier médical et sa consultation directe par les intéressés (même médecins) ou leurs proches montre que les malades ne sont pas censés franchir la frontière qui sépare les profanes des experts. En cela notre système médico-hospitalier fonctionne d’une manière opposée aux sociétés traditionnelles puisque dans celles-ci, même si les chamanes ont aussi leurs secrets, la maladie est susceptible d’apparaître comme une épreuve initiatique qui peut transformer le malade en thérapeute. Cependant, certaines des coutumes propres à l’espace hospitalier se rapprochent de celles qui sont observables dans les sociétés initiatiques traditionnelles. C’est vrai des usages même les plus techniques, telles les précautions d’asepsie qui, au bloc opératoire, en réanimation, et dans le « secteur » décrit dans le film (la chambre stérile), aboutissent à une topographie particulière ainsi qu’à des comportements d’isolement et d’évitement qui évoquent puissamment les rituels d’exclusion temporaire des candidats à l’initiation. Il n’est pas bien sûr question de nier l’importance de la bactériologie, mais de montrer que les précautions prises sont surdéterminées par des raisons d’ordre symbolique. En effet tout se passe comme si les transformations qui affectent les individus dans leur être le plus intime nécessitaient une enceinte, pour se dérouler correctement et efficacement. Le dispositif est celui de la clôture du ventre maternel lors de la gestation, laquelle sert de modèle universel pour toutes les mutations qu’auront ensuite à vivre les individus. C’est que, comme dans le fourneau des cuisinières, comme au plus profond de l’athanor des alchimistes, comme au cœur des centrales nucléaires (et comme dans les salles de radiothérapie) sont en jeu des énergies vitales originelles dont le subtil maniement conserve une part d’inconnu. Aussi ne doit-on ni permettre que des éléments extérieurs viennent interférer de manière incontrôlée dans le processus en œuvre, ni laisser les forces en jeu déborder du cercle magique qui isole l’intéressé du reste de l’humanité. Qui sait où elles iraient se fixer ensuite ?
Le film : d’une contagion redoutée à un utile exorcisme
Qu’il y ait du danger quelque part, c’est bien ce que nous dit Cédric. C’est bien ce que nous ressentons nous aussi au vu de ces séquences, et encore plus parfois à l’idée que ce film soit vu par des enfants du même âge. Mais de quel ordre est donc cette inquiétude, sachant que les enfants, pour leur part, n’ont pas nécessairement les mêmes angoisses que leurs parents ou leurs maîtres ? Est-ce que nous ne craignons pas, justement, qu’il n’y ait quelque chose de contagieux dans ces images? Comme si le film venait défaire toutes les conjurations dont nous entourons la vie de nos enfants ?
Le Voleur de bicyclette
Une dilution d’identité
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Alain Bergala

Le temps modifie de façon imprévisible la perception des films. Le Voleur debicyclette a été longtemps embaumé comme jalon historique du néoréalisme et il était difficile de le revoir autrement que « surcadré » par un savoir un peu gelé sur l’esthétique de ce mouvement. Un film emblématique de quelques positions bien connues : tournage dans la rue, en décors naturels, avec des non-acteurs, scénario minimal sur background social et historique de la Rome des pauvres dans l’après-guerre. Le Voleur de bicyclette est évidemment tout cela, qui a déjà été écrit et analysé cent fois, et par les plus grands, André Bazin en tête. Sauf qu’à force d’être convoqué comme exemple, ce film avait fini par être écrasé par son statut d’objet culturel et perdre toute vie au présent, la seule qui vaille pour un film comme pour un livre. Mais hélas pour nos pays européens, le scénario d’un homme qui est au chômage depuis deux ans et qui retrouve l’espoir d’un travail salarié est redevenu tout à fait actuel et concerne à nouveau au premier degré notre représentation du monde. Ce qui frappe, à revoir Le Voleur de bicyclette aujourd’hui, par rapport aux films contemporains qui essaient de parler du même sujet, c’est que tout est différent (les causes de la crise, le statut de ceux qui cherchent un emploi, le décor des grandes villes) mais que ce film d’il y a cinquante ans propose une hypothèse forte (et encore actuelle) sur l’état de chômeur prolongé. Cette hypothèse est devenue aujourd’hui nettement plus visible à nos yeux que pendant la longue période où ce film n’a plus été qu’un emblème.
La saisie filmique du monde
Cette hypothèse, que je vais essayer de suivre au fil du film, est la suivante : la menace majeure qui pèse sur Ricci est celle d’une perte d’identité, j’ai envie de dire plus précisément d’une dilution d’identité. La grande force du film (qui le rend tout à fait passionnant à retrouver et à revisiter) c’est que cette menace est avant tout sensible dans la saisie filmique du monde, plus que dans le scénario et le dialogue. Le rapport au monde d’une conscience troublée, en danger de déshérence, de dilution d’identité, passe d’abord par le filmage lui-même, c’est-à-dire directement dans l’expérience de la traversée du film par le spectateur. Cette menace se manifeste essentiellement de trois façons. Par une vacillation des repères symboliques : le père et le fils ne savent plus très bien où ils en sont dans les rapports de filiation (de savoir, d’autorité, de figure du surmoi). Par une vacillation des références spatiales dans sa perception du monde (qui devient siphon, labyrinthe, trompe-l’œil). Par une perte de la faculté d’accomoder sa vision sur un plan de netteté du réel, qui perd du même coup de sa stabilité : l’unitaire est sans cesse menacé de s’évanouir entre la multiplication et la division des formes et des figures. Au début du film, par cette proposition de travail qui lui est faite alors qu’il semblait avoir perdu tout espoir de retravailler un jour, Ricci semble réintégrer une identité sérieusement ébréchée par deux ans de chômage. Tout se passe dans la première scène comme s’il ne faisait plus très bien le lien entre son nom de Ricci (prononcé par l’embaucheur) et son corps abandonné à l’écart du groupe de ceux qui se battent encore pour un travail : il faut qu’un autre homme (celui qui vient le chercher et le tirer de sa léthargie) fasse la jonction entre les deux. Reste qu’il n’est pas très sûr que cette élection imprévue s’adresse bien à lui, puisqu’elle concerne le possesseur de bicyclette qu’il n’est plus très sûr d’être (la sienne est au Mont-de-Piété, dans un inter-monde où la propriété des choses devient purement virtuelle) : « Je l’ai et je ne l’ai pas » répond-il à l’embaucheur, associant pourle reste du film le restauration de sa dignité et de son identité à la possession déjà indécidable de cette fameuse bicyclette. Au Mont-de-Piété, une angoisse non fondée le prend devant ’hésitation du préposé à identifier sa bicyclette, qu’il manifeste en prenant les devants de façon un peu trop impatiente, comme si ce retard à l’identification mettait en danger sa propre identité. Un plan très inquiétant nous montre aussitôt après son regard sur le ballot contenant les draps familiaux (sans doute une pièce du trousseau transmis lors de la fondation de son couple) qui va rejoindre un amoncellement de milliers de ballots semblables où il semble impossible qu’on puisse les identifier un jour comme les siens. (On imagine en outre les connotations funèbres de cette accumulation au moment où l’on découvrait les images des amoncellements des cheveux, lunettes, vêtements, bijoux « récupérés » par les nazis à ceux qu’ils envoyaient dans les Camps).
Un vertige perceptif et symbolique
La première chose qu’il exhibe à sa femme, comme signe de sa dignité sociale retrouvée, c’est sa casquette (mais elle n’est pas vraiment encore « à lui » puisqu’il faudra que sa femme la retouche pour qu’elle lui aille). Ce qui restaure son identité, c’est ce qui est fait pour la nier, c’est-à-dire un uniforme – comme dans Le Dernier des hommes de Murnau où le portier d’hôtel continuait à porter son uniforme après avoir perdu sa fonction. Dans la rue, il soulève sa femme pour qu’elle voie « son » vestiaire, ce petit espace privé dans le lieu public de l’entreprise. Avec ce travail, Ricci a retrouvé une capacité de joie qu’il partage aussitôt avec sa femme.
Le Tableau
Éloge de l’inachevé
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Marielle Bernaudeau
« Si cela était possible, je laisserais (le tableau) tel quel, tout en recommençant et en le poursuivant sur une autre toile, il n’y aurait jamais de tableau ?achevé” mais seulement des états successifs d’une même peinture… Finir, exécuter, est-ce que ces mots n’ont pas double sens ? Terminer, c’est aussi achever, tuer, asséner le coup de grâce »
Picasso à son ami Brassaï, exposition Picasso – Françoise Gilot, peintre et muse, musée du vieux Nîmes, 2012.
Dès les premières minutes du film, mon cœur s’accélère à la vue d’un Reuf poursuivi par deux Toupins menaçants. Le voici qui vibre ensuite à l’unisson du discours humaniste de Ramo face à la tyrannie du Grand Chandelier. Puis il se serre devant la douleur solitaire de Plume… Que m’arrive-t-il ? Je m’identifie sans l’ombre d’un doute à ces formes dessinées et peintes qui ne sont pas des photographies de corps réels (les acteurs) et qui pourtant provoquent en moi toute une palette d’émotions. Comment se fait-il que je me reconnaisse en ces êtres de papier définis par quelques traits de crayon ou taches de couleur ?
Partagent-ils une humanité commune avec nous, les spectateurs ? Comment pouvons-nous éprouver des émotions aussi fortes qu’avec des films d’acteurs ? Comment l’auteur crée-t-il l’illusion nécessaire pour que nous puissions nous identifier aux personnages, à leurs caractères et à leurs parcours ?
Lire l’intégralité du texte sur la plateforme NANOUK
Princess Bride
De la narration comme un pur plaisir
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Berthomé Jean-Pierre »
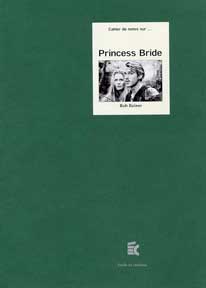 En haut des falaises de la démence, dans un superbe décor visiblement dressé tout exprès pour permettre l’étourdissante fantaisie du duel qui va suivre, Inigo prend son temps pour raconter à Westley l’histoire de sa vie. S’il travaille pour Vizzini, « c’est pour payer les factures. Ça ne rapporte pas grand-chose, la vengeance ». Les confidences terminées, chacun reprend sa place, comme deux travailleurs après la pause, pour nous offrir ce que nous attendions : trois minutes de duel éblouissant où la légèreté des propos n’a d’égale que celle des corps qui tourbillonnent et pirouettent, ou celle des armes qui voltigent et restent à l’occasion suspendues en l’air. Le charme de Princess Bride, pour moi, réside dans ce refus résolu de la pesanteur en même temps que dans l’élégance souveraine avec laquelle scénariste et réalisateur installent une distance narquoise qui moque gentiment les conventionsen même temps qu’elle joue de leur charme. Distance des personnages vis-à-vis de leurs « emplois », distance d’un couple narrateur vis-à-vis d’une histoire racontée, distance des auteurs du film par rapport au matériau mis en œuvre, distance enfin imposée au spectateur d’un film dont on lui propose de goûter au premier degré la saveur d’aventures en même temps qu’on l’invite à s’en détacher pour en reconnaître les modèles.
En haut des falaises de la démence, dans un superbe décor visiblement dressé tout exprès pour permettre l’étourdissante fantaisie du duel qui va suivre, Inigo prend son temps pour raconter à Westley l’histoire de sa vie. S’il travaille pour Vizzini, « c’est pour payer les factures. Ça ne rapporte pas grand-chose, la vengeance ». Les confidences terminées, chacun reprend sa place, comme deux travailleurs après la pause, pour nous offrir ce que nous attendions : trois minutes de duel éblouissant où la légèreté des propos n’a d’égale que celle des corps qui tourbillonnent et pirouettent, ou celle des armes qui voltigent et restent à l’occasion suspendues en l’air. Le charme de Princess Bride, pour moi, réside dans ce refus résolu de la pesanteur en même temps que dans l’élégance souveraine avec laquelle scénariste et réalisateur installent une distance narquoise qui moque gentiment les conventionsen même temps qu’elle joue de leur charme. Distance des personnages vis-à-vis de leurs « emplois », distance d’un couple narrateur vis-à-vis d’une histoire racontée, distance des auteurs du film par rapport au matériau mis en œuvre, distance enfin imposée au spectateur d’un film dont on lui propose de goûter au premier degré la saveur d’aventures en même temps qu’on l’invite à s’en détacher pour en reconnaître les modèles.
Conventions reconnues
La distance, c’est celle d’abord qu’introduit l’impression de trop-plein laissée par le film, et le goût de pastiche qui l’accompagne. Pastiche en forme d’hommage affectueux et non de parodie ni de caricature. Nous ne sommes ni chez Mel Brooks ni chez les Monty Python et les cinéastes ont choisi de s’amuser avec les conventions plutôt qu’à leurs dépens. Mais comment ne pas sourire de cette boulimie scénaristique qui mêle joyeusement les ingrédients de quinze films pour en réussir l’improbable synthèse ? Deux duels dignes des plus beaux films de cape et d’épée, un couple d’amoureux de conte de fées, un pirate masqué aussi séduisant que Zorro, des marais de feu qui appartiennent à l’univers du merveilleux, une salle des tortures dans la tradition décorative des grands films d’horreur, un trio d’aventuriers parfaitement picaresques et, pour couronner le tout, un couple de sorciers querelleurs qu’on croirait égarés de quelque comédie yiddish. C’est beaucoup. Ce serait trop si le film ne venait nous rappeler constamment que rien de tout cela n’est à prendre au premier degré. Que si l’on peut jouer ainsi avec cette accumulation de conventions, c’est que le spectateur d’aujourd’hui, justement, les reconnaît comme conventions. La source constante de Princess Bride, c’est le cinéma d’aventures hollywoodien classique, mais un cinéma classique revisité par un regard moderne qui en savoure tous les charmes en même temps qu’il s’amuse à en démonter les rouages. Princess Bride, en ce sens, participe du même travail de relecture des grands genres du cinéma américain qui nous a donné aussi New York New York de Scorsese (pour la comédie musicale), Draculade Coppola (pour le film fantastique), Impitoyable d’Eastwood (pour le western), Chinatown d’Huston (pour le film noir) ou Blade Runner de Ridley Scott (pour la science-fiction). Cette convention qui nourrit tout le film est si totalement assumée que les personnages eux-mêmes semblent en être conscients et commentent leurs propres activités sur le ton détaché de celui qui sait bien qu’il n’est après tout qu’un des participants d’un vaste jeu de rôles. Qu’on pense seulement à l’extravagant échange d’Humperdinck et Rugen quand celui-ci propose au prince de venir le voir torturer Westley :
— Écoutez, vous savez combien j’aime vous voir travailler, mais j’ai à préparer le cinq centième anniversaire de mon pays, mon mariage à organiser, ma femme à tuer et Guilder à faire accuser. Je suis vraiment débordé !
— Alors reposez-vous. Lorsqu’on n’a plus la santé, on n’a plus grand-chose.
Comme Inigo et Westley faisant la pause avant de se battre, comme Vizzini détournant l’attention de Westley avec la malice maladroite du bambin qui joue à cache-cache avec un adulte, ils s’appliquent avec conscience à être ces personnages tout d’une pièce qu’on attend d’eux, mais laissent un geste inattendu, une réplique insolite nier l’homogénéité de leurs personnages, souligner l’énormité de ce que le récit exige d’eux et empêcher le spectateur de s’abandonner tout à fait au plaisir d’y croire au profit de celui, plus subtil, de s’émerveiller d’y avoir presque cru.
Simplification raffinée à l’extrême
C’est dans ce « presque » qu’est tout le secret du film. Autrement dit dans le délicat travail de décalage opéré à tous ses niveaux par le réalisateur et le scénariste et dont la conscience par le spectateur impose celle, préalable, de la norme dont on s’écarte. D’où l’intérêt de travailler sur des genres particulièrement bien codés : le conte merveilleux, le film de cape et d’épée, le cinéma fantastique classique, le récit picaresque, dont la confusion ici proposée menace déjà la cohérence. De part et d’autre d’Humperdinck s’adressant à la foule depuis son balcon, Rugen, le fourbe archétypique des films de cape et d’épée, et le vieux roi débonnaire droit sorti d’un conte de fées n’appartiennent pas plus au même univers, fût-il de fiction, que les marais de feu et les ruines du duel, que le duel lui-même et le combat avec le rat géant. D’où la simplification extrême de personnages qui se doivent d’être crédibles une rapière à la main aussi bien que dans une foule pseudo-médiévale ou dans un univers de fantaisie héroïque, parfaitement illustrée par la stylisation de costumes : on serait bien en peine de les dater tant s’y mêlent les conventions contradictoires, exemplairement résolues dans le costume de Pirate noir de Westley qui ne fait appel à aucun repère identifiable de lieu ni d’époque et n’est plus que pure expression d’un monde de fiction qui ne doit rien qu’au cinéma.
Princess Bride
La table tournante
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Berthomé Jean-Pierre »
MANQUANT SUR ANCIEN SITE
écrit par Marie-Christine Pouchelle, ethnologue, directeur de recherche au CNRS, Centre d’ethnologie française, Musée national des arts et traditions populaires
Dans l’hôpital apprivoisé, un parcours initiatique
 L’hôpital est généralement perçu comme un monde à part, aussi bien par les malades et leurs proches que par les équipes soignantes. Monde à part en raison des enjeux vitaux qui sont sa raison d’être, à cause de la proximité quotidienne de la souffrance, de la détresse et de la mort. Mais aussi parce que les représentations scientifiques du corps et de la maladie qui y ont cours ne sont pas toujours familières, tant s’en faut, à ceux qui viennent y chercher la guérison. D’ailleurs, même lorsque ces savoirs appartiennent aux patients (quand ces derniers sont eux-mêmes médecins par exemple) ils sont par définition décalés par rapport aux évidences immédiates que le corps, ses alchimies internes et la maladie éveillent chez tout individu. À ce décalage, le film fait allusion lorsqu’on nous montre l’échographie subie par Cédric, ou lorsqu’au téléphone le médecin décrit à son correspondant la tumeur de Dolorès, tandis que la caméra est fixée sur le visage de l’enfant inquiète.
L’hôpital est généralement perçu comme un monde à part, aussi bien par les malades et leurs proches que par les équipes soignantes. Monde à part en raison des enjeux vitaux qui sont sa raison d’être, à cause de la proximité quotidienne de la souffrance, de la détresse et de la mort. Mais aussi parce que les représentations scientifiques du corps et de la maladie qui y ont cours ne sont pas toujours familières, tant s’en faut, à ceux qui viennent y chercher la guérison. D’ailleurs, même lorsque ces savoirs appartiennent aux patients (quand ces derniers sont eux-mêmes médecins par exemple) ils sont par définition décalés par rapport aux évidences immédiates que le corps, ses alchimies internes et la maladie éveillent chez tout individu. À ce décalage, le film fait allusion lorsqu’on nous montre l’échographie subie par Cédric, ou lorsqu’au téléphone le médecin décrit à son correspondant la tumeur de Dolorès, tandis que la caméra est fixée sur le visage de l’enfant inquiète.
Le monde hospitalier et la tradition du secret technique
D’autre part l’hôpital lui-même s’est beaucoup revendiqué comme lieu initiatique distinct de l’espace profane pour les corporations professionnelles qui y exercent leurs savoirs. En excluant les familles des espaces de soins (ce qui n’est pas le cas dans le service où est hospitalisé Cédric) les soignants ont longtemps cherché non seulement à conserver l’exclusivité de leurs savoir-faire, mais peut-être aussi à esquiver le regard que les profanes pourraient porter sur leurs pratiques. En sus de leurs nécessités techniques, ces pratiques ont en effet une dimension rituelle qui ne renvoie pas aux malades mais à la dynamique interne de l’équipe soignante en tant que groupe social. De sorte que l’opacité bien connue de nombre d’institutions thérapeutiques protège encore souvent non pas le malade mais la « cuisine » hospitalière dont il est l’objet. Au sortir de cet espace relativement étranger qu’est l’hôpital, les patients n’ont pas acquis un véritable statut d’initiés au savoir médical, même si, surtout dans le cas de traitements prolongés, ils finissent par posséder une certaine compétence (voir l’épisode où Cédric s’inquiète de son cathéter). L’interdit qui continue de peser sur le dossier médical et sa consultation directe par les intéressés (même médecins) ou leurs proches montre que les malades ne sont pas censés franchir la frontière qui sépare les profanes des experts. En cela notre système médico-hospitalier fonctionne d’une manière opposée aux sociétés traditionnelles puisque dans celles-ci, même si les chamanes ont aussi leurs secrets, la maladie est susceptible d’apparaître comme une épreuve initiatique qui peut transformer le malade en thérapeute. Cependant, certaines des coutumes propres à l’espace hospitalier se rapprochent de celles qui sont observables dans les sociétés initiatiques traditionnelles. C’est vrai des usages même les plus techniques, telles les précautions d’asepsie qui, au bloc opératoire, en réanimation, et dans le « secteur » décrit dans le film (la chambre stérile), aboutissent à une topographie particulière ainsi qu’à des comportements d’isolement et d’évitement qui évoquent puissamment les rituels d’exclusion temporaire des candidats à l’initiation. Il n’est pas bien sûr question de nier l’importance de la bactériologie, mais de montrer que les précautions prises sont surdéterminées par des raisons d’ordre symbolique. En effet tout se passe comme si les transformations qui affectent les individus dans leur être le plus intime nécessitaient une enceinte, pour se dérouler correctement et efficacement. Le dispositif est celui de la clôture du ventre maternel lors de la gestation, laquelle sert de modèle universel pour toutes les mutations qu’auront ensuite à vivre les individus. C’est que, comme dans le fourneau des cuisinières, comme au plus profond de l’athanor des alchimistes, comme au cœur des centrales nucléaires (et comme dans les salles de radiothérapie) sont en jeu des énergies vitales originelles dont le subtil maniement conserve une part d’inconnu. Aussi ne doit-on ni permettre que des éléments extérieurs viennent interférer de manière incontrôlée dans le processus en œuvre, ni laisser les forces en jeu déborder du cercle magique qui isole l’intéressé du reste de l’humanité. Qui sait où elles iraient se fixer ensuite ?
Le film : d’une contagion redoutée à un utile exorcisme
Qu’il y ait du danger quelque part, c’est bien ce que nous dit Cédric. C’est bien ce que nous ressentons nous aussi au vu de ces séquences, et encore plus parfois à l’idée que ce film soit vu par des enfants du même âge. Mais de quel ordre est donc cette inquiétude, sachant que les enfants, pour leur part, n’ont pas nécessairement les mêmes angoisses que leurs parents ou leurs maîtres ? Est-ce que nous ne craignons pas, justement, qu’il n’y ait quelque chose de contagieux dans ces images? Comme si le film venait défaire toutes les conjurations dont nous entourons la vie de nos enfants ?
Un cheval nommé liberté
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Émile Breton
 Conte de fées, puisqu’il met en scène un cheval aux pouvoirs en quelque sorte magiques, Le Cheval venu de la mer est aussi un témoignage sur le racisme dont les « Tinkers » (qui sont des nomades mais pas des Gitans, on le verra dans les « Promenades pédagogiques ») sont l’objet en Irlande. C’est également, et tout aussi fortement, une plongée dans les rêves d’enfants nourris par leur grand-père des antiques mythes que les « gens du voyage » se transmettent de génération en génération et, par la télévision, des visions de grands espaces où chevauchent, libres, cow-boys et Indiens. Ce va-et-vient entre la légende, la réalité et le rêve fait le prix du film, par ailleurs mené et monté rapidement, en plans courts ménageant de multiples rebondissements, comme le grand récit d’aventures qu’il est, sur le modèle justement des westerns que ces gosses adorent. Ces va-et-vient constants ne touchent pas seulement la construction du scénario qui passe d’un niveau à l’autre, mais se retrouvent à l’intérieur des séquences elles-mêmes, où il n’est pas toujours aisé de déterminer si l’on se trouve dans le conte, dans le réel ou dans les fantasmes des deux enfants jouant aux Indiens et aux cow-boys. Ainsi, dans une séquence qui, très volontairement, démarre sur un plan archi-répété dans les westerns, de silhouettes de cavaliers se détachant à contre-jour dans les lointains d’une crête de colline, l’équivoque sera jusqu’au bout entretenue sur le « gibier » que poursuivent ces cavaliers. Si le spectateur sait en effet très vite, par leur tenue, la présence de chiens en meute, et autres détails, qu’il s’agit de participants à une chasse à courre, il croira un long moment (jusqu’à ce qu’il découvre un renard caché dans les mêmes ruines que le cheval et les deux enfants), que ce sont eux que les chasseurs traquent. Et ceci d’autant plus que tout, dans l’attitude des gamins, montre qu’ils se sentent poursuivis. Autre exemple de ces équivoques délibérément maintenues : lorsque, à la fin du film, le grand-père, croyant que son petit-fils, Ossie, ne reviendra pas à la vie, s’accroupit sur le rivage et se lamente, « Ah moi, avec toutes mes histoires », il est clair qu’une telle phrase n’est là que pour entretenir le doute sur les « pouvoirs magiques » de ce cheval qui a conduit les enfants auprès de la « Madone des voyageurs » et qui a su leur faire retrouver la tombe de leur mère. Mettant en effet lui-même en cause ses « histoires » – comme celle, qu’il conta au début du film, d’Osin, l’homme qui mourut pour avoir voulu retrouver les siens, gens du voyage, alors qu’il était promis à l’immortalité – il laisse entendre que ce sont toutes les légendes dont il a nourri Tito et Ossie qui les ont fait s’enticher de Tir na nOg qui n’était peut-être qu’un cheval comme les autres, et les ont poussés dans cette aventure…
Conte de fées, puisqu’il met en scène un cheval aux pouvoirs en quelque sorte magiques, Le Cheval venu de la mer est aussi un témoignage sur le racisme dont les « Tinkers » (qui sont des nomades mais pas des Gitans, on le verra dans les « Promenades pédagogiques ») sont l’objet en Irlande. C’est également, et tout aussi fortement, une plongée dans les rêves d’enfants nourris par leur grand-père des antiques mythes que les « gens du voyage » se transmettent de génération en génération et, par la télévision, des visions de grands espaces où chevauchent, libres, cow-boys et Indiens. Ce va-et-vient entre la légende, la réalité et le rêve fait le prix du film, par ailleurs mené et monté rapidement, en plans courts ménageant de multiples rebondissements, comme le grand récit d’aventures qu’il est, sur le modèle justement des westerns que ces gosses adorent. Ces va-et-vient constants ne touchent pas seulement la construction du scénario qui passe d’un niveau à l’autre, mais se retrouvent à l’intérieur des séquences elles-mêmes, où il n’est pas toujours aisé de déterminer si l’on se trouve dans le conte, dans le réel ou dans les fantasmes des deux enfants jouant aux Indiens et aux cow-boys. Ainsi, dans une séquence qui, très volontairement, démarre sur un plan archi-répété dans les westerns, de silhouettes de cavaliers se détachant à contre-jour dans les lointains d’une crête de colline, l’équivoque sera jusqu’au bout entretenue sur le « gibier » que poursuivent ces cavaliers. Si le spectateur sait en effet très vite, par leur tenue, la présence de chiens en meute, et autres détails, qu’il s’agit de participants à une chasse à courre, il croira un long moment (jusqu’à ce qu’il découvre un renard caché dans les mêmes ruines que le cheval et les deux enfants), que ce sont eux que les chasseurs traquent. Et ceci d’autant plus que tout, dans l’attitude des gamins, montre qu’ils se sentent poursuivis. Autre exemple de ces équivoques délibérément maintenues : lorsque, à la fin du film, le grand-père, croyant que son petit-fils, Ossie, ne reviendra pas à la vie, s’accroupit sur le rivage et se lamente, « Ah moi, avec toutes mes histoires », il est clair qu’une telle phrase n’est là que pour entretenir le doute sur les « pouvoirs magiques » de ce cheval qui a conduit les enfants auprès de la « Madone des voyageurs » et qui a su leur faire retrouver la tombe de leur mère. Mettant en effet lui-même en cause ses « histoires » – comme celle, qu’il conta au début du film, d’Osin, l’homme qui mourut pour avoir voulu retrouver les siens, gens du voyage, alors qu’il était promis à l’immortalité – il laisse entendre que ce sont toutes les légendes dont il a nourri Tito et Ossie qui les ont fait s’enticher de Tir na nOg qui n’était peut-être qu’un cheval comme les autres, et les ont poussés dans cette aventure…
Le Voleur de Bagdad
L’œil magique
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Émile Breton

Né de la volonté d’Alexander Korda, Le Voleur de Bagdad n’en est pas moins fortement marqué par la « griffe » de Michael Powell. Tous deux hommes de spectacle – ils faisaient les films pour le public et n’ont jamais manqué, l’un comme l’autre, de dire qu’une œuvre n’existait vraiment que lorsqu’elle rencontrait ceux à qui elle était destinée – ils savaient que le cinéma est une création collective. Et ils faisaient entièrement confiance à ceux avec qui ils travaillaient. « Personnellement, écrit Powell dans Une vie dans le cinéma, je n’arrive pas à comprendre pourquoi certains réalisateurs tiennent absolument à exercer un pouvoir absolu. Ils perdent la moitié du plaisir qu’on prend à faire un film. » C’est qu’ils avaient, Korda comme Powell, une assez haute idée de leur capacité à savoir, dès le départ, ce qu’ils voulaient faire passer dans le film sur lequel ils travaillaient pour ne pas se perdre dans des besognes qui ne leur incombaient pas. On a vu avec quel soin Korda s’était entouré, à la London Film, de gens sur lesquels il pouvait compter pour « mettre en musique » la chanson qu’il avait en tête, de son frère Vincent, peintre dont l’apport allait être déterminant dans le traitement – admirable – de la couleur pour le film, au scénariste Lajos Biro ou au musicien Miklos Rozsa qu’il connaissait depuis sa jeunesse hongroise. Et, peut-être inspiré par cet exemple, Michael Powell, tout au long de sa carrière qui n’en était alorsqu’à ses débuts eut pour premier soin de chercher qui conviendrait le mieux et à quelle place pour chacun de ses films. Aussi ne s’étonnera-t-on pas que coexistent dans Le Voleur de Bagdad – coexistence particulièrement heureuse et sans heurts – le grand film d’aventures, inspiré du premier Voleur américain et de maints épisodes des Mille et Une Nuits, voulu par Korda et un autre film, plus secret, dans lequel percent quelques-unes des obsessions qu’on allait retrouver tout aulong de l’œuvre de Powell. La première et la plus forte de ces obsessions, étant celle du « voyeurisme », forcément lié aux fondements mêmes du cinéma. On allait, vingt ans plus tard, la retrouver avec son maximum d’intensité dramatique dans le film justement nommé Le Voyeur (Peeping Tom) où un fanatique de cinéma et d’émotions fortes, invente une caméra qui lui permet tout à la fois d’assassiner ses victimes – cet appareil étant pourvu d’un pied acéré comme une épée – et de filmer leurs derniers instants d’effroi. C’est naturellement sur un mode beaucoup moins terrifiant, celui de l’importance du regard, que ce thème traverse ici le film. C’est que pour le cinéaste, comme le rappelle Bertrand Tavernier dans la préface du livre déjà cité, « le cinéma est une création visuelle, organisée, pensée par un metteur en scène ». Et il en était sans doute déjà assez persuadé pour vouloir l’inscrire – visuellement, bien sûr – comme en exergue au second des grands films, et au premier des grands spectacles qu’il était autorisé à codiriger. Quand on sait que c’est lui et lui seul, qui dirigea, en Cornouailles, les extérieurs de la séquence d’ouverture sur l’arrivée du navire du « méchant » Jaffar dans le port de Basra, il est difficile de ne pas voir comme un manifeste, dans l’image de cet œil ouvert peint à la proue qu’on voit grandir jusqu’à ce qu’il occupe tout l’écran, en un lent et irrésistible travelling avant. Michael Powell, dans ses mémoires, a beau plaisanter joliment sur cette trouvaille, racontant qu’il demanda à Vincent Korda de faire peindre un œil à l’avant du navire, et qu’à la question de celui-ci : « Quel genre d’œil ? », il répondit « Un œil grand ouvert. Il faut bien qu’ils voient où ils vont », il reste que cette entrée dans le film joue le rôle d’un avertissement au spectateur d’avoir précisément à « ouvrir l’œil ». Et ce n’est pas là un simple « jeu d’image », une coquetterie d’auteur tenant à marquer son territoire, mais la mise en place d’un thème véritablement récurrent, comme l’ouverture d’un opéra annonce ce qui va suivre. En effet, le récit lui-même, venant en flash-back est introduit par le récit d’Ahmad, le mendiant aveugle, dont on ne sait pas encore qu’il est le jeune prince accablé de cette infirmité par le fourbe magicien Jaffar. Lequel Jaffar, caché derrière un rideau – et qui a, lui, bien reconnu sa victime ignorante – épie la scène dans une situation de voyeur-non-vu, qui sera la sienne en maintes autres occasions dans le film, notamment dans la séquence 30, lorsque la princesse dit à son père qu’elle ne veut pas l’épouser.
écrit par Antoine Copolla
La quête des paradis perdus
L’histoire simple de Jin et Bin, deux fillettes abandonnées par tous qui, finalement, s’accrochent à leur bonté et à leur innocence retrouvées, est portée par une recherche esthétique remarquable. L’esthétique de Treeless Mountain joue sur deux esthétiques, a priori, antagonistes : la stylisation et le réalisme. La directrice de la photographie, Anne Misawa, a un rôle prépondérant dans la recherche d’une puissance visuelle qui évite au film de sombrer dans le mélodrame.
Les choix stylistiques de Treeless Mountain ne sont pas gratuits. Ils sont mis au service d’une ambition réaliste. Il s’agit de faire surgir le réel sur l’écran autant pour convaincre le spectateur du bien-fondé du récit – effet de réel – que pour documenter le discours. Et, en effet, dans Treeless Mountain, le spectateur découvre une certaine forme de vie sociale en Corée du Sud. La présence des lieux et des décors (marchés, rues, boutiques, intérieurs de maison) insiste sur ce souci du film : ancrer l’histoire de Jin et Bin dans le contexte culturel et social coréen.
Comme nous le verrons, si Treeless Mountain met l’accent sur le style et le réalisme, il n’en est pas moins un discours sur la société. L’histoire mélodramatique des deux fillettes est une métaphore de la société moderne et de ses échecs. Le spectateur assiste ainsi à une série de pertes liées à des problèmes économiques : celle du père, puis de la mère, puis de la ville, puis de l’espoir. Et peu à peu entre en jeu une quête nostalgique de ces mêmes parents et de ces mêmes lieux d’enfance. La nostalgie de l’enfance et du pays fait écho à la critique indirecte de la société moderne. Au final, le film semble aboutir à une certaine résignation qu’il faut lier à la présence entêtante et réconciliatrice de la nature.
Style
En l’absence de générique, le film nous plonge, dès le premier plan qui surgit sans crier gare, dans la vision du visage de Jin, puis de celui de Bin, sa petite soeur. La moitié des images sont des vues de visages plus ou moins expressifs, plus ou moins concernés, parfois pensifs, parfois de marbre ou énigmatiques. Le visage comme paysage est une des puissances du cinéma. (On pense à Faces de John Cassavetes ou, dans le cinéma asiatique, à Nobody Knows de Kore-Eda). La caméra se tient à distance (longue focale) et observe de loin les signes exprimés par les visages. En occupant le cadre avec les visages de Jin ou de Bin, la caméra explore un panorama complexe d’expressions (les yeux peuvent sourire tandis que les lèvres se pincent, ou encore les sourcils peuvent se froncer tandis que la bouche fait la moue, etc.). Ce cinéma du visage utilise aussi la durée : c’est un véritable flux intérieur qui est suggéré par la durée des gros plans tandis qu’autour les voix des autres personnes, les bruits d’ambiance en constituent le contrepoint.
La vitesse burlesque et le chaos du monde
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Carole Desbarats
 Le Burlesque est un genre qui participe du Merveilleux. À partir d’une cause le plus souvent absurde se met en place une logique implacable qui substitue à la cohérence du monde réel celle qu’implique la présence du héros burlesque. La raison du spectateur s’en accommode très vite et s’installe confortablement dans ces nouvelles données : par le rire, le personnage burlesque nous entraîne à oublier les pesanteurs de la vie la plus prosaïque… En fait, le spectateur est, au sens étymologique, ravi : comment, devant leur inventivité, refuser la proposition que nous font Charley Bowers, Chaplin, Keaton de faire plier le principe de réalité sous le joug du principe de plaisir, – et non l’inverse comme le voudrait l’ordre social ? Au moins pendant quelques minutes…Tout est fait pour dissimuler l’audace du pari : sans être forcément défini par une appartenance sociale et une condition inférieure comme le voulait Aristote pour la comédie, (Charlot en donne la meilleure preuve dans notre programme puisqu’il y incarne aussi bien un petit repris de justice qu’un bon bourgeois), le personnage est soumis à différentes avanies par la police, un patron, un barbon, ces difficultés privées offrant surtout un terrain d’expériences propice au développement de la créativité burlesque. Rien que de très connu. Or, derrière cet aspect tellement codé qu’il en semble banal, les problèmes soulevés sont graves.
Le Burlesque est un genre qui participe du Merveilleux. À partir d’une cause le plus souvent absurde se met en place une logique implacable qui substitue à la cohérence du monde réel celle qu’implique la présence du héros burlesque. La raison du spectateur s’en accommode très vite et s’installe confortablement dans ces nouvelles données : par le rire, le personnage burlesque nous entraîne à oublier les pesanteurs de la vie la plus prosaïque… En fait, le spectateur est, au sens étymologique, ravi : comment, devant leur inventivité, refuser la proposition que nous font Charley Bowers, Chaplin, Keaton de faire plier le principe de réalité sous le joug du principe de plaisir, – et non l’inverse comme le voudrait l’ordre social ? Au moins pendant quelques minutes…Tout est fait pour dissimuler l’audace du pari : sans être forcément défini par une appartenance sociale et une condition inférieure comme le voulait Aristote pour la comédie, (Charlot en donne la meilleure preuve dans notre programme puisqu’il y incarne aussi bien un petit repris de justice qu’un bon bourgeois), le personnage est soumis à différentes avanies par la police, un patron, un barbon, ces difficultés privées offrant surtout un terrain d’expériences propice au développement de la créativité burlesque. Rien que de très connu. Or, derrière cet aspect tellement codé qu’il en semble banal, les problèmes soulevés sont graves.
Merveilleux et chaos
En effet, comme les contes de fées, le Burlesque nous raconte de véritables horreurs : en utilisant le comique pour démasquer et décrire le chaos, il démontre que le mal est à l’œuvre dans le monde. L’enjeu est donc de taille : nos trois burlesques nous donnent à voir ce qui, énoncé sur un autre mode, serait dérangeant, voire passible de censure. Chaplin table sur la jouissance sadique – aussi bien celle du personnage que, par contre-coup, celle du spectateur – ; sans malignité aucune, simplement en déréglant puis en réorganisant à sa manière l’ordre du monde, Keaton insinue qu’il n’est pas immuable. Quant à Bowers, sous couvert de faciliter le travail des hommes, il met en place un système de reproduction qui, en fait, court-circuite métaphoriquement une sexualité probablement jugée difficile à vivre… Si Merveilleux il y a, il faut donc le raccorder au génie que déploie le héros burlesque pour à la fois dépasser l’abîme qui se découvre sous chacun de ses pas, et, en nous faisant rire, en dissimuler la présence, pourtant réelle. Coups répétés sur un pied bandé, cambouis sur la robe immaculée d’un cheval, génération spontanée et proliférante d’objets manufacturés pourtant non travaillés par la main de l’homme… le risque encouru est bien celui du dégoût. De cela, trois éléments nous préservent : d’une part, on le sait, tout être humain, quel que soit son âge, peut se trouver clivé entre attraction et répulsion pour un même phénomène. D’autre part, l’identification cinématographique fonctionne à plein. Maladresse, paresse, lâcheté, nous connaissons tous ces travers, à divers degrés…
Je deviens quelqu’un
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Carole Desbarats
« Je deviens quelqu’un » est le titre du deuxième chapitre des mémoires de Keaton. On pourrait l’appliquer au personnage qu’il interprète dans Steamboat Bill Junior : Junior va conquérir sa propre estime, le respect de son père et une épouse. Il s’agit bien sûr d’un récit d’apprentissage et d’initiation. Apprentissage si l’on considère qu’au dénouement, Junior est capable de piloter le steamer avec une précision de vieux loup de mer quand il éperonne la prison flottante dans laquelle son père risque de mourir noyé. Initiation si l’on observe l’itinéraire que parcourt ce jeune homme que son père ne reconnaît même pas lorsqu’il arrive sur le quai de la gare (et qui le lui rend bien…) : à la fin du récit, Junior sauve sa douce, son père, son futur beau-père, et va même repêcher un prêtre pour qu’il célèbre son mariage hors récit. En bref, ce fils est devenu un homme.
Pour une fois, on voit le père du personnage, ce qui est rare dans l’œuvre de Keaton. Dans Battling Butler et dans College, les parents sont juste évoqués. Ici, le père tient un rôle essentiel et la relation qu’il entretient avec son fils constitue le moteur du récit qui s’achève quand les deux hommes acceptent d’exprimer leur affection. Certes, un deuxième père est présent, le riche, très riche King qui tient le rôle du méchant avec ce que cela inclut de représentation stéréotypée, d’absence de caractérisation : il ne sert que d’opposant et son rôle se réduit à représenter le pouvoir néfaste des puissants et à empêcher les amoureux de se rejoindre, à la fois dans une relation œdipienne classique et pour des raisons de différence de classe. On retrouve là une thématique récurrente chez Keaton, celle des amours contrariées. Il l’a d’ailleurs presque théorisée au début des Trois âges (1923). Un carton y pose un axiome qui se révèle valable pour Cadet d’eau douce : « Depuis le commencement des temps, les parents ont toujours trouvé différentes méthodes pour choisir le compagnon de leur fille. » Heureusement que Kitty, qui certes est un peu frivole et coquette, est surtout une jeune fille déterminée, plus volontaire – dans un premier temps – que son amoureux…
La scène et le monde
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Carole Desbarats

Chantons sous la pluie est peut-être un film culte parce que c’est un conte et une comédie musicale à la fois optimiste, tonique et particulièrement réussie, parce que ce musical traite bien d’un bouleversement essentiel dans l’histoire du cinéma, le passage au sonore, et aussi parce que le cœur du film, fait de danse, de chant, d’économique, d’observation documentaire, cerne pour une fois bien ce qu’est le travail du cinéma. Ce qui ne serait rien si toutes ces qualités n’étaient servies par la rencontre exceptionnelle d’artistes de grand talent, les scénaristes Betty Comden et Adolph Green, les co-réalisateurs Donen / Kelly, les interprètes, le compositeur Nacio HerbBrown, réunis autour du grand producteur Arthur Freed.
Un conte
Le dernier plan du film donne vraiment l’impression d’un conte de fées qui s’achève : main dans la main, les héros regardent l’image de légende qu’ils ont réussi à forger et s’y conforment en tous points, ils peuvent donc vivre longtemps heureux et avoir beaucoup d’enfants. Les travaux de Rick Altman ont montré que la comédie musicale se fonde sur trois sous-genres, soit, le Show Musical, – des films chantants et/ou dansants qui travaillent le monde du spectacle – ou encore le Fairy Tale Musical qui prend la tona-lité des contes de fées, ou, enfin et moins connu, le Folk Musi-cal qui s’intéresse au terroir et que Donen a lui aussi illustré dans les Sept Femmes de Barberousse. Rick Altman évoque également le fait que le Musical peut,sans perdre sa spécificité, faire appel à plusieurs codes à lafois : ainsi, dans Chantons sous la pluie, si certains éléments ont, pendant le récit, préparé cette tonalité d’un conte sans fée, ils sont à la fois puisés dans le Show Musical, dans le Fairy Tale et dans le mélodrame. C’est en particulier le cas de la radicalisation des rôles : le prince rencontre la bergère (ici, la star et a chorus girl), la méchante l’est irrémédiablement, sans nuances et jusqu’au bout sauf qu’elle est jolie, mais sa voix, nasillarde et vulgaire, dit sa vérité de sorcière, le Prince Charmant a unvaillant écuyer, Cosmo, qui le conseille et le guide dans le droit chemin tout en s’effaçant derrière lui… Le fait de prendre des personnages principaux dont le statut social est diamétralement opposé renvoie au mélodrame, par exemple. L’idéalisation des personnages (le parfait acteur-chanteur-danseur interprété par Gene Kelly, la timide débutante honnête servie par Debbie Reynolds) va également dans cesens, tout en ressemblant très classiquement au conte de fées. D’ailleurs, on peut se poser la question : Kathy Selden est-elle une Cendrillon moderne, ou, comme le dit Peter Wollen, aurions-nous à faire à une discrète adaptation de la Petite Sirène d’Andersen ? Dans son remarquable texte, ce critique suggère l’idée que, comme l’héroïne du conte, Kathy sacrifie l’un de ses attributs physiques, la voix, à son Prince. L’avantage du conte de fées est, on le sait, qu’il propose un cheminement au héros et que cet itinéraire se fraie à travers des épreuves balisées et repérables. Dans Chantons sous la pluie, l’initiation est discrète ; elle affecte un personnage que la qualité de son interprète, Gene Kelly, marque d’un fort coefficient de positivité et ce, dès sa première apparition dans le film : par son passé cinématographique, Kelly est d’emblée perçu par le spectateur comme un gentil garçon. Son cheminement va donc le mener non du mal au bien mais de la méconnaissance de certaines valeurs à leur pleine acceptation. C’est déjà là une altération de la stylisation liée au conte de fées et l’introduction d’une complexité davantage attachée à une représentation artistique. En particulier, grâce à la violette timide qu’est la femme aimée, le personnage de Don va assumer son passé, la roture de son métier et du coup va devenir meilleur comédien. Il s’agira pour lui de comprendre que le bastringue, le music hall de bas de gamme sont tout aussi « dignes» que les ZiegfeldFolies ou Broadway. Et tout cela le conduira à affirmer son amour en public, dans la scène de dénouement où une chorus girl de base devient une grande star, non sans avoir elle aussi eu honte de son travail, mais après l’avoir toutefois assumé plus vite que le héros. En fait, les deux personnages vont former un couple parce que tous deux ont accompli le même itinéraire : il n’osait pas dire qu’il avait commencé dans des bars enfumés (comme le Jackie du Chanteur de Jazz), elle prétendait être actrice de théâtre et non de cinéma. Marc Voinchet explique ici combien le thème de la dignité est essentiel dans Chantons sous la pluie. (voir page 15) En tout état de cause, si les deux protagonistes sont honteux de leur origine, il n’est pas interdit, en outre, de voir dans leur plus ou moins lente acceptation de la dignité de leur travail une métaphore du cinéma s’assumant progressivement dans ses origines plébéiennes, loin de la noblesse du théâtre…
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Carole Desbarats

Le mythe Pendant très longtemps, Le Magicien d’Oz a participé du mythe que se sont construit les États-Unis : à peine un an aprèsla sortie du film, dans The Philadelphia Story de Cukor, James Stewart chante « Over the Rainbow » en prenant ses désirs pour des réalités alors qu’il porte Katharine Hepburn dans ses bras comme une jeune mariée… Certes, à la sortie en salles, le film perd un million de dollars mais très vite, tous les ans, Le Magicien d’Oz est diffusé pour les fêtes de Noël et, à l’inverse, rapporte de considérables bénéfices. On imagine comment, en devenant une référence commune, ce film a pu, pendant des décennies, toucher les imaginaires enfantins et adultes. Plus tard, la société américaine ébranlée par les soubresauts d’une nouvelle crise ne se reconnaît plus de la même manière dans cette féerie: un tournant est pris lorsque, dans Sailor et Lula de David Lynch, deux jeunes en cavale – non plus devant la fureur criminelle d’une sorcière mais celle d’une mère ! – voient leur amour sauvé par la fée du film de 1939. En effet, en 1990, la Bonne Sorcière apparaît dans un costume très proche de celui du film de Fleming, mais devant des loubards de banlieue et son intervention salvatrice est soulignée par un des derniers lieders de Strauss et une chanson d’amour du grand Elvis : à la joliesse de la référence au Magicien d’Oz s’ajoutent la mélancolie du compositeur du Chevalier à la rose et celle du grand King, signe que l’époque n’admet plus la couleur dragée. On ne saurait mieux signifier combien, en cette fin de siècle, il faut d’énergie pour croire aux contes de fées. Mais, pour que ce film ait autant marqué les États-Unis, et, par l’intermédiaire de son cinéma exporté, le monde occidental, il faut bien qu’il ait touché juste et que la vision du monde proposée puisse susciter l’identification de millions de spectateurs.
Une petite fille américaine
Après tout, Dorothy est une petite fille du Kansas profond qui a connu un monde merveilleux et dont le plus grand désir est de revenir au sein de sa famille. Quoi de plus rassurant comme morale ? Il n’est pas étonnant que les fêtes de Noël aux États-Unis aient été soudées dans la communion autour de ce film : Home, sweet Home ! Vu sous cet angle, Le Magicien d’Oz est une œuvre portée par une bonne conscience moralisatrice : surtout, que nos chérubins n’aillent pas de par le monde, voir si, hors des États-Unis, d’autres vivent, sont heureux ou souffrent différemment… Il faut dire que Dorothy répète plusieurs fois, dans la dernière scène au pays d’Oz : « Il n’y a rien de mieux qu’un chez soi. » Au fait, aurait-elle besoin de s’en convaincre ? Cela étant, dans le même temps, le film dépasse la « sagesse » de cette morale convenue, et, comme les contes de fées, propose de plus résistantes nourritures à l’imaginaire : le parcours initiatique de cette petite fille n’a pas été aussi insignifiant que voudrait le laisser conclure le ton simplificateur et rassurant du happy end. Reprenons : soit Dorothy, une petite fille américaine, qui n’a pas la vie facile. Orpheline, elle est entourée de l’affection débordée de ses oncle et tante ; en fuite, elle doit s’affronter à des puissances bénéfiques et maléfiques et trouve secours auprès de ses vrais amis, son chien et les adultes qu’elle côtoyait déjà sur terre, les trois ouvriers agricoles. C’est bien là que le film est plus complexe que ne le laisse penser son dénouement : les trois « hommes » qui, littéralement, accompagnent Dorothy dans son parcours initiatique, ne lui proposent pas comme modèle d’identification des adultes taillés dans le bronze mais bien plutôt des êtres fragiles et susceptibles, eux aussi, de perfectionnement. Ce qui n’est pas dénué d’intérêt : la quête de soi n’est donc pas réservée aux enfants et les adultes ne sont pas érigés en parangon de sagesse (ou de méchanceté, ce qui serait tout aussi peu nuancé et conforterait la même vision du monde). Le personnage qui incarne la Loi ne rassure pas plus. Le « magicien » qui devrait être l’homme du savoir absolu présente une figure paternelle sans véritable force, sans véritable message puisqu’il est sans voix. En effet, dans la séquence 28, on le voit dans toute sa faiblesse quand le rideau relevé démasque sa supercherie : pour faire peur, il avait recours à des moyens participant plus du domaine du spectacle que de la conviction communément attribuée à celui qui profère la Loi… Déjà obligé d’amplifier sa voix par des prothèses techniques, il en est réduit à balbutier quand sa supercherie est découverte et la perte de toute voix crédible ne lui laisse plus qu’une fragilité un peu pitoyable.
Respect de ce qui est filmé, respect du spectateur,
la manière de Nicolas Philibert
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Carole Desbarats
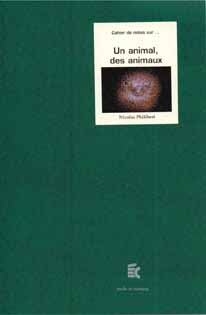
Ce qui est révélateur dans Un animal, des animaux, est la difficulté à le classer dans un genre, et, s’agissant d’un film sur une Galerie de Zoologie du Museum d’Histoire Naturelle, cela ne manque pas de sel… Film de coulisses comme le sont les comédies musicales, certainement, film sur le travail, c’est sûr, documentaire, en effet, mais peu classique…film sur le monde des animaux naturalisés, évidemment, même si…
Documentaire :
Nicolas Philibert fait volontiers part de ses réticences sur la séparation entre documentaire et fiction.
Il n’est pas le seul à la remettre en question et la production de ces dix dernières années montre bien que les cinéastes, quand ils s’attachent à ne pas placer le contrôle sur le réel en avant comme le permet la fiction, ne se privent plus pour autant des bénéfices de certains des attributs traditionnels de ce genre-là. Ainsi, en 2008, Avi Mograbi utilise-t-il dans Z32 un effet spécial pour flouter le visage de certains de ses personnages. La technique numérique lui permet de garder les yeux et la bouche non floutés : ces trous expressifs dans un masque à l’inquiétante étrangeté autorisent la confession intime d’un soldat israélien.
De même, la musique n’est plus tabou dans le documentaire de création, et la collaboration de Nicolas Philibert avec le compositeur Philippe Hersant le prouve bien, ou encore, un documentariste peut faire rejouer une scène, un entretien, si les besoins du film le nécessitent.
S’en étonner est compter sans l’Histoire du cinéma. On peut juste rappeler à cet égard l’exemple devenu canonique de la scène de capture dans Nanouk l’esquimau, dont on sait bien maintenant qu’elle a totalement été « mise en scène », avec les assistants de Flaherty qui tiraient le filin sur lequel Nanouk concentrait ses efforts pour hâler un gros phoque. Ils étaient hors-champ et, du coup, l’effet dramaturgique marche vraiment. En 1922 comme de nos jours…
On ne saurait oublier que les questions d’argent interviennent parfois aujourd’hui au grand jour dans le domaine du documentaire qui en était jusque-là « préservé », au moins aux yeux du public, ne soyons pas naïfs. C’est d’ailleurs précisément l’objet du procès intenté par le personnage principal d’un précédent film de Nicolas Philibert, Etre et avoir. Le procès a été maintes fois perdu par le plaignant : Nicolas Philibert reste reconnu comme le responsable du sens mis en place dans ce film.
« Je déteste ce mot : « documentariste » dit l’auteur d’Un animal, des animaux, il contribue à dresser une frontière autour d’un genre qui n’a jamais cessé d’évoluer et dont chacun connaît au contraire la porosité, la variabilité des tracés, les liens presque consanguins qu’il entretient avec celui qu’on lui oppose toujours, la fiction. Tant il est vrai que les images sont moins fidèles au « réel » qu’aux intentions de ceux qui les produisent ».
Un humanisme généreux
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Carole Desbarats
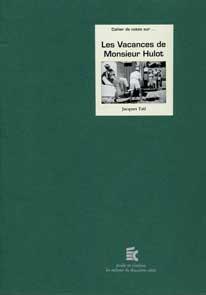
Il est intéressant de montrer Les Vacances de Monsieur Hulot aux enfants, aujourd’hui, en cette fin de siècle désabusée. En effet, dans ce film, et peut-être de manière plus large que dans des films ultérieurs de Tati, la générosité est grande : d’abord, bien sûr, celle du personnage, Hulot, mais aussi, et c’est au moins aussi important, celle du cinéaste envers son spectateur. En fait, les deux sont liées. C’est parce que Hulot est un être profondément gentil que ses actes ne sont pas forcément adaptés à ce que la société attend de nous et donc qu’il déclenche le rire. Et c’est parce que Tati respecte son spectateur que son personnage principal n’est pas le seul à nous faire rire : chez Tati, tout le monde peut participer du gag, le provoquer, en profiter, aussi bien héros, personnages de second plan… que spectateurs.
Quelqu’un de gentil
Reprenons. Hulot est un personnage qui suscite plutôt l’attendrissement ou l’étonnement que la distance. Comparons le bouquet final – le feu d’artifice des Vacances–à la dévastation ultime de Pour épater les poules de Charley Bowers ou à la zizanie semée par Charlot au sein d’un hôtel thermal dans La Cure. On s’aperçoit de ce qui sépare fondamentalement les rires suscités par ces trois scènes conclusives. Chez Bowers, une invention géniale (un œuf incassable) se solde par la destruction totale du hangar qui abritait les expériences et le dernier plan laisse le héros éberlué sous un amas de planches et de gravats: ainsi se paye le fait de vouloir altérer les lois de la nature. Chez Chaplin, dans La Cure, ce bouleversement va encore plus loin : à cause de lui, une source thermale offre du vin et non plus de l’eau aux curistes et un hôtel tout entier est donc livré à une débauche dionysiaque tandis que Charlot le quitte sereinement au bras de sa dulcinée. Dans ces deux cas, le rire naît d’un formidable plaisir, dénué de toute considération morale, celui, par exemple, du petit enfant qui considère ses excréments avec intérêt. L’analyse n’est pas neuve. Pour Monsieur Hulot, le ressort n’est pas le même. Certes, à voir, en conclusion des Vacances, le déploiement de cette pyrotechnie, le spectateur éprouve la grande jubilation qui accompagne les dépenses somptuaires, apparemment inutiles, celles que Bataille qualifiait d’« improductives » et dont l’histoire donne des exemples, des jeux de cirque aux défilés commémoratifs et des œuvres plastiques jusqu’aux feux d’artifice. Dans Les Vacances, le plaisir esthétique du noir et blanc, des fusées éclatant dans la nuit, relève de cette jouissance : toutes ces gerbes de lumière, toutes ces chandelles, pour moi, spectateur !… À cela se superpose un élément spécifique du comique de Tati : le feu d’artifice éclaire par intermittences un Hulot très concerné par la micro catastrophe et qui s’affaire donc – inutilement – à contrôler ce que sa maladresse a déclenché. Et nous rions d’autant plus de son inefficacité qu’après tout ce feu d’artifice ne blessera personne, s’il était dans cette cabane, c’était bien pour être utilisé, il aura éclaté un peu plus tôt et réveillé une fois de plus l’hôtel, voilà tout ! Rien à voir avec le – salutaire – rire d’exultation devant la destruction provoquée par la plupart des burlesques américains. En fait, pour ces apocalypses hilarantes de fin de film, le rire peut être libéré par des impulsions contradictoires : d’une part, le désastre est tellement grand que, de facto, il nous délivre d’une référence au réel et autorise un rire de jubilation cathartique (les enfants connaissent bien cela à travers le monde cruel, et ô combien réjouissant, des dessins animés de Tex Avery) ; de l’autre, le spectateur qui apprécie en toute connaissance de cause les efforts disproportionnés du personnage sait, lui, évaluer l’aspect dérisoire de ce que le héros prend pour un cataclysme : le rire ne vient alors pas d’une position poétique déconnectée du réel, mais, et c’est paradoxal, d’un attendrissement bienveillant. Devant l’innocence de Hulot s’agitant comme un insecte inefficace, ou faut-il dire devant sa gentillesse – Hulot est clairement désoléde ce qui arrive – le spectateur a un rire qui, curieusement, laisse une place à la sympathie et, en cela, serait plus proche de celui provoqué par cet autre comique aussi affable que génial : Buster Keaton. Revoyez l’expression satisfaite de Charlot laissant tous les curistes ivres et déchaînés derrière lui… Hulot ne participe pas de cette conscience libertine de la maîtrise du mal. Il donnerait visiblement beaucoup pour faire revenir l’ordre dans la petite station balnéaire. D’où vient alors, devant tant d’aménité et de bons sentiments, que cette scène ne sombre pas dans une mièvrerie qui interdirait le rire ? De la bande-son.
Père et fils, un sourire et peut-être aussi une larme
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Carole Desbarats
Vagabond ou vitrier ?
Commençons par une curiosité : pourquoi les génériques du Kid appellent-ils le personnage interprété par Charles Spencer Chaplin, « le vagabond » ? Dans ce film, le héros principal a pourtant un domicile suffisamment identifié pour qu’un médecin ou des représentants d’institution puissent s’y rendre. Par ailleurs, il exerce un métier dont il possède l’attirail ; certes son savoir-faire est insuffisant (il barbouille de mastic les vitres qu’il remplace) et sa déontologie douteuse (il fait d’abord casser les carreaux par son petit acolyte avant de venir proposer ses services), mais il est clairement vitrier, fût-il un piètre artisan. Un lieu de résidence, un métier, voilà qui s’oppose à la notion de vagabondage.
En fait, très longtemps, jusqu’aux Temps modernes (1935), le dernier film où son personnage est muet même si le film est parlant, le héros incarné par Chaplin s’appelle le plus souvent ainsi. Pourtant, dans The Vagabond (1916), il incarne « un violoniste », dans Charlot fait une cure (The Cure, 1917), « un gentleman éthylique », ou dans un film qui précède de peu Le Kid, Une idylle aux champs (1919), « l’employé en vacances », etc. Voilà une incohérence qui aide à prendre de la distance avec certaines interventions qui ne sont pas toujours le fait du réalisateur : il en va de même pour les affiches, qui, pour intéressantes qu’elles soient, n’apprennent pas grand-chose sur la conception du film qu’aurait le cinéaste puisqu’il ne les choisit pas lui-même. Gageons que Chaplin fait exception sur ce point : considéré, de son vivant même, comme le plus grand cinéaste de tous les temps, il disposait d’une liberté d’action dont très peu de cinéastes ont pu se targuer.
Alors, va pour « vagabond », d’autant plus que dans Le Kid, Charlie Chaplin reprend l’intégralité de la panoplie de ses personnages du muet, petit chapeau plus ou moins cabossé, vêtements proches de la guenille, godillots et canne. La continuité et l’identification avec les précédents rôles de Charlot se font au premier coup d’œil : on retrouve ici un paramètre majeur du personnage que Chaplin lui-même appelait « le petit homme », la pauvreté, celle qui fait ramasser les mégots des autres et s’en contenter en guise de cigarette. En revanche, il faut bien constater que le rapport au métier de vitrier disparaît bien vite dans le film (comme dans tant de fictions où, une fois la profession d’un personnage sommairement caractérisée, on n’en parle plus).
Consulter le texte intégral sur la plateforme numérique NANOUK
Une petite fille réfractaire
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Carole Desbarats
L’Académie des oscars a commis un contresens en décernant l’oscar du second rôle féminin à Tatum O’Neal. Comment penser que, dans La Barbe à papa, le personnage d’Addie soit secondaire ? Non seulement elle est omniprésente, mais a minima elle peut être considérée comme la partenaire de Ryan O’Neal, comme Bonnie est celle de Clyde ou Katharine Hepburn celle de Cary Grant dans les comédies de Hawks… On retrouve là un des grands travers du cinéma qui « oublie » régulièrement les noms des petits acteurs ou ne leur donne pas la place qu’ils méritent.
Dans le cas du film de Peter Bogdanovich, l’erreur est révélatrice d’un éventuel déni : n’a-t-on pas souvent l’impression que, au grand dam du politiquement correct, c’est la petite fille qui y mène les opérations, de l’arnaque à l’organisation d’une fuite ? Peut-être même cette maîtrise est-elle troublante. On est loin des petites filles modèles qu’affectionne le cinéma et en particulier le cinéma hollywoodien classique, celles qui font de charmants « mots d’enfants », qui sont bien coiffées, pimpantes, hardies dans la limite de la décence, et surtout si féminines déjà, de vraies « petites bonnes femmes » comme le disait le titre original des Quatre Filles du docteur March, de Louisa May Alcott : Little Women. En 1868.
Addie est taciturne, coiffée et habillée sans grâce, presque à la garçonne et, pire encore, elle ne cède rien, jamais, comme le ferait une femme que la vie a endurcie et qui résiste. De sa voix éraillée, elle répond du tac au tac et pas avec la joliesse d’une charmante réplique délicieusement enfantine. En effet, quand Addie rétorque à Moze que, certes, elle ne sait pas ce que sont les scrupules mais que si lui en a, c’est qu’il les a volés, elle adopte la tranquille assurance de ceux qui ne se laissent pas faire, ce qui rappelle plutôt la piquante Katharine Hepburn de L’Impossible Monsieur Bébé que la « charmante » Shirley Temple.
En fait, le personnage d’Addie est corrosif : elle est à peu près dépourvue de naïveté, en tout cas de celle que l’on attribue aux enfants de son âge. Sauf quand elle joue à imiter ce qu’elle imagine avoir été les attitudes de sa mère (qui travaillait dans un bar), elle est d’une gravité étonnante. Mieux, ce qui surprend, voire dérange, est l’absence d’illusions qui la caractérise. À côté d’elle, son père présumé est tout de sucre candi, ce qui explique qu’il se laisse enjôler par Trixie et ne voie que du feu dans sa stratégie si féminine, là où Addie est parfaitement au clair avec ce qui se passe.
Cette lucidité dépourvue de la moindre illusion sur la façon dont va le monde et cette exigence de franchise qui en découle sont originales, non dans la vie, mais dans la représentation cinématographique.
Reprenons : Addie ne sourit pour ainsi dire pas pendant la première moitié du film. Elle ne pleure pas non plus : le film commence au bord de la tombe de sa mère. Le visage de l’enfant est parfaitement impassible. Les codes sont d’emblée mis à mal. On imagine les grosses larmes qui, en de pareilles circonstances fictionnelles auraient roulé sur les joues rebondies de Shirley Temple, « la petite fiancée » de l’Amérique. Ici, Tatum O’Neal est plus proche d’un autre personnage d’enfant impavide, pas grognon, non, sans expression : le petit Max Baissette de Malglaive dans le film Versailles, de Pierre Schoeller. Le stéréotype est fracassé : les enfants peuvent-ils être tellement malheureux qu’ils ne sourient même pas à travers leurs larmes ? Ou faut-il dire qu’ils n’essaient même pas de séduire les adultes tant ils ont perdu confiance en eux ?
Consulter le texte intégral sur la plateforme numérique NANOUK
Sacha et la glace
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Hélène Deschamps
La banquise comme page blanche
« Une ligne noire et sinueuse comme un trait de plume sur un papier blanc apparaissait, plus large près du bateau »
Tous les explorateurs partis à la conquête des mers et des terres les plus extrêmes de la planète s’accordent pour témoigner que la réfraction de la lumière sur la banquise leur joua des tours : les mirages sont fréquents sur la glace. Apparitions fantastiques, illusions d’optique sont les compagnes de voyage de ces intrépides aventuriers.
Le film dans le film
Le générique d’ouverture de Tout en haut du monde, présente un inventaire : des documents, (photographies, cartes, relevés et calculs inscrits sur des pages blanches), des objets (maquette de bateau, encrier, porte-plume, règle, sextant), des livres et des dessins jonchent le bureau de Sacha Tchernetsov, petite fille d’Oloukine, hardi capitaine ayant appareillé vers son rêve, le pôle Nord.
Mais cet inventaire liminaire d’objets inanimés recèle deux animations littéralement incrustées. La première apparaît dans un dessin d’enfant : à l’arrière-plan, fixes, une mouette, une petite maison et un hangar sur une île ; en amorce, la poupe d’un bateau, le Davaï, tandis qu’au premier plan dansent les flots de l’océan. Le mouvement côtoie l’immobilité. L’animation partielle de ce dessin d’enfant condense l’esthétique singulière de Tout en haut du monde,dont la puissance formelle s’accomplit grâce à cette économie dans un style graphique extrêmement simple, voire dépouillé.
La seconde incrustation est contenue dans une page blanche posée sur le bureau : un dessin doué d’un pouvoir d’animation autonome. Lorsqu’on s’approche de lui, ce dessin-fantôme est déjà animé. Des rafales de neige, poussées par un vent furieux, balaient une vaste étendue blanche tandis qu’un homme, seul, de dos, s’éloigne lentement vers l’horizon. Qui est cet homme ? Oloukine ? À ce moment-là du générique, le nom de Rémi Chayé apparaît. Ce caméo serait-il alors un autoportrait de l’artiste en quête d’inspiration ? Son avancée solitaire dans le silence des champs glacés figurerait-elle la traversée de son désert intérieur ? La banquise, page blanche, évoquée par Sir Ernest Shackleton, rappelle l’écran blanc, le vide, le rien. La création commence là.
Lire l’intégralité du texte dans la plateforme NANOUK
Merveilles de l’imagination
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Marie Diagne
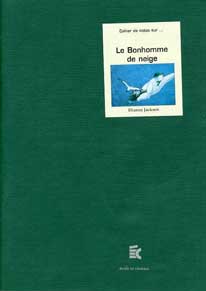 La première séquence du Snowman n’est composée que d’un seul plan, fixe, filmé en prise de vue réelle. Un homme y traverse le cadre, tandis qu’on entend une voix masculine, adulte, qui raconte : « Un jour, il s’était mis à neiger, à neiger comme je ne l’avais jamais vu. […] J’ai décidé de construire le bonhomme de neige. » Puis, l’image photographique devient dessin, le titre du film apparaît en fondu et le récit, annoncé par la voix masculine initiale, commence. Nous découvrons, isolée dans une campagne enneigée, une maison. Dans une chambre, un enfant dort encore. La voix du début – premier niveau de narration – annonce un souvenir – deuxième niveau de narration – dans lequel on plonge avec la disparition de la « bande paroles » et le changement de technique cinématographique. La relation d’un univers à l’autre est assurée, outre les éléments que la voix annonce – « J’ai décidé de construire un bonhomme de neige » – par la bande musique. Le thème principal y est amorcé sur la fin du plan en prise de vue réelle, il entre sous la voix et se poursuit crescendo sur les premiers plans animés. Pourtant, cette fluidité initiale – passage d’une technique à l’autre en fondu, continuité narrative et musicale – ne laisse pas sans interrogation. Ainsi le transfert initial de l’image en prise de vue réelle à l’image animée est-il unique dans le film, qui se clôt sur le plan dessiné du petit garçon devant son bonhomme de neige fondu. Ce que raconte ce plan reste, a priori, problématique : après son vol avec le bonhomme de neige et sa rencontre avec le Père Noël, le petit garçon se réveille, se précipite à l’extérieur et découvre que son bonhomme a fondu. Mais il sort de la poche de sa robe de chambre une écharpe bleue tachetéede blanc que ce même Père Noël lui a offerte… A-t-il rêvé ? L’intérêt de cette question ne réside probablement pas dans sa réponse mais dans le doute qu’elle soulève et que la réalisatrice affirme avec le choix de la dernière séquence de son film. En effet, aucun élément n’y invite le spectateur à quitter ce que la voix initiale évoque comme un souvenir : sur l’image gelée du petit garçon face au tas de neige, son écharpe à la main, le générique final se déroule…
La première séquence du Snowman n’est composée que d’un seul plan, fixe, filmé en prise de vue réelle. Un homme y traverse le cadre, tandis qu’on entend une voix masculine, adulte, qui raconte : « Un jour, il s’était mis à neiger, à neiger comme je ne l’avais jamais vu. […] J’ai décidé de construire le bonhomme de neige. » Puis, l’image photographique devient dessin, le titre du film apparaît en fondu et le récit, annoncé par la voix masculine initiale, commence. Nous découvrons, isolée dans une campagne enneigée, une maison. Dans une chambre, un enfant dort encore. La voix du début – premier niveau de narration – annonce un souvenir – deuxième niveau de narration – dans lequel on plonge avec la disparition de la « bande paroles » et le changement de technique cinématographique. La relation d’un univers à l’autre est assurée, outre les éléments que la voix annonce – « J’ai décidé de construire un bonhomme de neige » – par la bande musique. Le thème principal y est amorcé sur la fin du plan en prise de vue réelle, il entre sous la voix et se poursuit crescendo sur les premiers plans animés. Pourtant, cette fluidité initiale – passage d’une technique à l’autre en fondu, continuité narrative et musicale – ne laisse pas sans interrogation. Ainsi le transfert initial de l’image en prise de vue réelle à l’image animée est-il unique dans le film, qui se clôt sur le plan dessiné du petit garçon devant son bonhomme de neige fondu. Ce que raconte ce plan reste, a priori, problématique : après son vol avec le bonhomme de neige et sa rencontre avec le Père Noël, le petit garçon se réveille, se précipite à l’extérieur et découvre que son bonhomme a fondu. Mais il sort de la poche de sa robe de chambre une écharpe bleue tachetéede blanc que ce même Père Noël lui a offerte… A-t-il rêvé ? L’intérêt de cette question ne réside probablement pas dans sa réponse mais dans le doute qu’elle soulève et que la réalisatrice affirme avec le choix de la dernière séquence de son film. En effet, aucun élément n’y invite le spectateur à quitter ce que la voix initiale évoque comme un souvenir : sur l’image gelée du petit garçon face au tas de neige, son écharpe à la main, le générique final se déroule…
Le Petite Vendeuse de Soleil
Conte cruel de la jeunesse
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Marie Diagne

La Petite Vendeuse de Soleil s’ouvre sur une séquence d’arrestation violente et sans preuve d’une femme qui, pour prouver sa bonne foi, se dévêt dans une rue fréquentée de Dakar. Ce personnage ne réapparaîtra qu’à la dix-huitième minute dufilm (d’une durée totale de 43, soit plus des deux tiers écoulés). Pourtant, cette séquence marque le spectateur. Qu’a-t-on compris de cette arrestation ? On reste interloqué devant ces badauds réjouis, la fureur de cette femme à demi-nue derrière des barreaux. Mais là où d’ordinaire les séquences suivantes répondraient progressivement aux affects ainsi provoqués, le récit de Mambety impose la rupture. Le titre annonce un personnage distinct, La Petite vendeusede Soleil, et un récit autrement attrayant voire « gentillet ». On entre dans un autre parcours, celui d’une fillette handicapée qui se rend à Dakar pour mendier. L’invitation du cinéaste est claire : quand ces deux personnages vont-ils se rencontrer ? Quelle place cette première séquence occupe-t-elle dans le récit principal ? Plus l’histoire se déroule, moins on voit comment va enfin y entrer la femme arrêtée du début. Une tension est créée : on est déçu de ne pas suivre cette femme, plutôt que cette enfant dont on nous a déjà raconté l’histoire cent fois, semble-t-il. Nous suivons la petite Sili mais,en creux, telle une image rémanente, la séquence d’ouverture, violente et laissée sans suite, nous accompagne. Et si le projet cinématographique de Mambety était contenu dans cette tension initiale ?
Aux prises avec Dakar
Le jour se lève, une silhouette s’avance vers nous. Elle est vêtue de rose, telle une nouveau-née, une enfant qui de la vie a tout à expérimenter. « Sili La Rose », comme aimait l’appeler Mambety, quitte sa cité natale, une banlieue de baraques délabrées, pour rejoindre Dakar.
La nécessité de se rendre dans la ville – « pour chercher de quoi nourrir ma famille », explique la fillette – ne se résout pas dans un acte anodin. Atteindre Dakar ressemble bien plus à un voyage périlleux qu’à un simple déplacement quotidien. Une fois sortie de sa cité, une succession d’obstacles jalonne le trajet de Sili, et suggère une ville hostile, difficile à atteindre. La distance à parcourir se double du danger de la circulation : lorsqu’elle traverse la route pour la première fois, une voiture arrive à sa hauteur au même moment à vive allure ; on la voit déjà renversée. Le jeune garçon qui va l’emmener dans sa charrette l’avertit : « Ils ne me laisseront pas entrer avec mon cheval. » Dakar devient forteresse avec entrées contrôlées. Le sous-entendu est clair : une fois face à la ville, elle devra y entrer et s’y débrouiller seule. La zone frontalière des réfrigérateurs affiche le seuil d’une société de consommation et sa tentation, là où Sili vient mendier pour survivre. Son répondant sera la vitrine du pâtissier Laëtitia, à l’intérieur du quel Sili ne pénètre pas. Une contre-plongée sur un building écrase la petite, comme entrée dans la gueule de loup. L’image d’une arrestation incompréhensible flotte. Le heurt est évident, la solitude de Sili affichée, parallèlement à la femme du début. C’est ce dont nous informe, comme pour conclure son arrivée dans la ville, le plan d’ensemble qui isole Sili au cœur du marché, présentant une main pour l’aumône. La mise en place tendue de la fillette dans la ville tisse une toile autour de ses béquilles problématiques, et laisse en suspens une chute. Pourtant, les maux de Dakar semblent étonnamment étrangers à Sili : elle traverse la route l’allure décidée, en ignorant complètement la voiture qui passe si dangereusement près d’elle,alors même que le regard du casseur de pierre indique le danger au spectateur. De même, le jeune garçon l’emmène dans sa charrette sans qu’elle ait eu à en formuler la demande. Et quand, comme une surenchère, au marché, après l’agression du jeune Moussa, elle se dirige vers la bande des garçons pour dénoncer leur sauvagerie, on se dit que, cette fois, elle en fait trop. Le point culminant est atteint, la chute tant attendue se produit.
Petites z’escapades
Un parti pris pour une série de télévision (série Mon âne)
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Marie Diagne
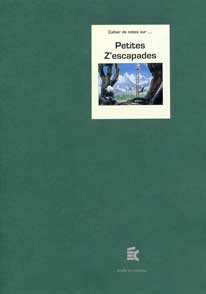
Mon Âne est une série de vingt-six films courts, chacun d’environ deux minutes trente, réalisés en deux parties. Le programme des Petites Z’escapades propose un épisode de chacune d’entre elles. Ainsi Meunier, tu dors appartient-il à la première et Jean de la lune à la seconde. Cette série s’inscrit dans une certaine tradition du film d’animation : des chansons populaires, transmises de manière essentiellement orales, y sont mises en scène et leur texte apparaît dans le bas de l’écran, défilant au rythme de la voix qui les entonne. Co-produits et diffusés par la télévision, ces vingt-six films n’en gardent pas moins des partis pris de réalisation, revendiqués comme tels. Ainsi, la présence de l’âne et le choix d’un décor qui, de la première partie de la série à la seconde, affirme son aspect plat et fermé, fonctionnant tel que dans un théâtre de marionnettes. Ainsi également, la présence du texte des chansons. Pascal Le Nôtre crée un personnage intermédiaire entre la chanson et le spectateur, l’âne. Cette intervention d’un personnage étranger au récit initial des chansons pose évidemment un réel problème qui, tel qu’il est résolu par le réalisateur, nous informe du principe de sa mise en scène. « Souvent, dans une classe, le personnage le plus fort, affectivement, c’est le cancre. Je suis bien sûr influencé par Jacques Prévert … Le cancre, c’est celui qui se met un peu à part, qui a souvent une relation privilégiée avec l’enseignant, et extrêmement privilégiée avec le groupe. De ce fait, c’est un personnage à quatre vingt dix pour cent sympathique, qui entraîne immédiatement une certaine adhésion. Lorsque je me suis lancé dans cette aventure de chansons, je me suis confronté à des univers certes extraordinaires, mais très divers. Il fallait trouver une certaine unité. J’ai choisi un âne, qui n’est pas un personnage très utilisé, ou alors pour s’en moquer, parce que c’est un animal qui ne comprend rien, qui fait beaucoup de bruit, qui est têtu, obstiné … Bref : l’âne a vraiment toutes les caractéristiques de l’antihéros ! Et il ne chante pas. Dans toutes les histoires, sauf une où il chante deux ou trois mots, ce qui lui vaut d’ailleurs d’être assommé parce qu’il chante faux, cet âne reste parfaitement ”à côté de la plaque”, c’est-à-dire à côté de l’histoire. Il a, me semble-t-il, ce comportement révélateur des enfants de deux ou trois ans d’être attentif à tout ce qui se passe,et plus particulièrement à certains détails. J’ai toujours pensé, peut-être à tort, que les enfants aiment qu’on leur raconte plusieurs fois la même histoire pour qu’ils puissent, dans chaque finesse du texte, en saisir un détail et le déguster pendant qu’on poursuit le récit. La fonction de l’âne est donc celle-ci : se saisir de prétextes à l’intérieur de la chanson pour pouvoir s’amuser avec et perdre son temps ; faire tout à fait autre chose que l’action qui continue de se dérouler.» Ainsi, ce sont des détails des différentes actions accomplies par l’âne qui le lient au récit principal de la chanson. Dans Jean de la lune, une fois que l’âne a perdu de vue le petit être de chêne, deux récits se déroulent alors de manière parallèle et sont montés comme tels, jusqu’à la gaffe finale de l’âne. Systématiquement, un élément de la chanson engendre la séquence suivante mettant en scène l’âne : par exemple, c’est le même champignon qui est salué par le petit être puis arraché et croqué par l’âne. Par exemple encore, ce sont les mirlitons des merles et des bouvreuils, nommés dans le texte de la chanson, qui permettent d’enchaîner sur l’âne finissant de tailler une flûte dans une branche d’arbre.
La jointure du récit mettant en scène l’âne avec celui de Meunier, tu dors est plus déroutante : certes, l’âne tente en vain de réveiller le meunier mais parallèlement, il fabrique des crêpes. Pourtant, une fois compris en quoi consiste ce lien qui unit ces deux récits, on saisit le double objectif pédagogique de cette série : certes il s’agit bien de participer à cet effort de transmission d’un patrimoine essentiellement oral. Mais l’âne, en prélevant certains éléments du récit de la chanson, en fait la matrice de péripéties extérieures à ce récit premier dont on peut tirer un apprentissage : on ne mange pas n’importe quel champignon dans la forêt, les escargots rentrent dans leur coquille lorsqu’ils ont peur, etc. Cette tentative didactique, un peu abrupte, apparaît comme une volonté ludique d’élargir l’univers de la chanson tout en se raccrochant à celui de l’enfant. « Pour Meunier, tu dors, j’étais très handicapé par le scénario : c’est très beau, un personnage muet dans une histoire, ici parce qu’il dort. On est d’ailleurs ainsi attentif au moindre geste de ce meunier. Il dort, alors même qu’il a une responsabilité. Le vent va tout démolir, mais son travail ne le préoccupe pas. Le sujet est très intéressant, mais ça laisse un personnage tout seul. Je me suis alors demandé si les enfants, lorsqu’ils ont de la farine dans les mains, comprennent que celle-ci vient du blé. Le lien entre le travail du meunier et la farine s’est perdu. Je trouvais donc drôle que l’âne ne s’intéresse pas au travail du meunier mais directement à son résultat : il prenait la farine et faisait des crêpes. On participait à un récit épicurien : quand une roue tourne, simplement pour nous rappeler que la vie passe vite, que ce meunier a certainement des raisons de dormir, et que nous sommes pris dans ce tourbillon … Et bien Carpe Diem ! Mangeons des crêpes ! Mais, si l’on comprend bien la fébrilité de l’âne, et la passivité du meunier, je ne suis pas sûr que la relation entre ces deux récits en parallèle fonctionne bien. Il est peut-être surprenant de voir cet âne réaliser avec brio de la pâte à crêpes, alors que dans les autres films il ne fait rien d’aussi abouti.»
écrit par Stéphane Dreyfus et Stéphane Bataillon
Le poème et l’image
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Stéphane Bataillon et Stéphane Dreyfus
En sortant de l’école fait figure d’ovni pour qui connaît les contraintes du marché de l’animation pour enfants destiné à la télévision. La série animée, objet de commande visant à faire le plus d’audience et à attirer des fabricants de produits dérivés, n’a bien souvent rien de la performance artistique – quand elle n’a pas été créée uniquement pour vendre une gamme de jouets… Prendre comme sujet la poésie, genre littéraire qui, même sur son propre marché, ne vaut pas grand-chose en termes de poids économique (à peine 1 % de la vente totale de livres en France) est un risque certain.
écrit par Rochelle Fack
Le cinéma a presque 120 ans. Son évolution n’a pas toujours été aussi fulgurante qu’à ses débuts, où l’innocence des spectateurs mêlée aux expérimentations de ses pionniers, faisait de lui un lieu où « l’inexprimé pouvait perpétuellement s’accroître ». Avec les années, son territoire s’étendit. Le cinéma devînt une économie. Il se mécanisa, se politisa, se nationalisa. Il fit de la propagande ou du spectacle, parfois les deux. Partout, il connût des crises. Il en connaît encore, l’adolescent ! Aujourd’hui encore, il s’aventure, se popularise, se radicalise et même, se dématérialise. Victime de son succès, de son commerce, il repousse les limites et se projette en 3D. Son évolution est complexe, mondiale, intriquée dans celle des représentations, des peuples, des territoires, des corps, de l’économie de marché. Difficile de l’embrasser d’un regard, d’une pensée. Difficile aussi de dire précisément, derrière son invention technique, à quel moment, de quelle façon, le cinéma devînt un art. Tout de suite !, disent sans réserve les cinéphiles. Quand tel ou tel métrage fut réalisé, quand tel auteur apparut, telle projection eut lieu, discutent les historiens. Le programme des Pionniers du cinéma ne tranche pas la question, mais met en relief en quoi les premiers films de l’histoire constituaient des tentatives osées. Certaines sont devenues des figures de mise en scène classiques. D’autres – c’est le plus euphorisant de cette étrange histoire – demeurent toujours licencieuses…
Imaginez
L’invention du Cinématographe par les frères Lumière, officiellement marquée par la projection du 28 décembre 1895 dans le salon indien du Grand Café à Paris, fut précédée par un nombre conséquent de recherches sur l’image en mouvement qui donnèrent lieu à l’élaboration de nombreux procédés techniques dits du « précinéma ». Mais si sa mise au point est connue, dans la mesure où elle a découlé de travaux qui lui ont précédés, sa conceptualisation esthétique – les changements qu’elle entraîna en terme de représentation, de création, de narration –, est plus impalpable, notamment parce qu’intriquée dans une histoire des représentations et des sociétés. Quel récit faire de cette naissance-là ? – non pas celle d’un procédé technique, mais d’un art ? Un récit contradictoire, sans doute ; récit nourri d’un nombre très important de films, dont tous ne nous sont, de surcroît, peut-être pas encore apparus ! Certains ont disparu. Certains, après qu’on les ait cru perdus, ont été retrouvés. D’autres n’ont peut-être pas encore été retrouvés, d’autres attendent d’être restaurés. Il y a aussi ceux, nombreux dans cette histoire, qui ne se sont pas tournés . Imaginez : la naissance d’un art entraînant une métamorphose du regard, mais encore davantage, celle de son appréhension… André Bazin ne qualifiait-il pas le cinéma de « momie du changement » ?
Ce qui apparaît dans le programme des Pionniers, c’est que durant les quelques années qui suivirent l’invention du Cinématographe, le cinéma fut un essaim d’idées formelles, multidirectionnelles, d’une liberté totale. Sans doute, les histoires racontées en images manquaient-elles, dans un monde où il y avait autant d’yeux ! Le cinéma se confronta immédiatement aux questions d’illusion, d’incarnation, de croyance et de représentation, qui se posaient depuis longtemps en peinture, au théâtre et en photographie. Il y ajouta la question, plus littéraire, du récit, non sans exprimer avec force son penchant pour l’animation, la vitesse, l’équilibre, la suspension. La naissance de cet art est réjouissante à imaginer. Car peut-on faire autre chose qu’imaginer la conversion d’une pure technique en regard ?
Un transport en commun
La quête du cinéma
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Fack Rochelle

Ouvrir sur le monde
Deweneti (qui signifie « bonne année » en wolof), et Un transport en commun s’ouvrent par un panoramique sur un paysage de Dakar. D’origine franco-sénégalaise, Dyana Gaye a grandi en France et passé, depuis qu’elle est enfant, de nombreuses vacances au Sénégal. Comme une chaîne discontinue de souvenirs, c’est au Sénégal, et particulièrement à Dakar, que se projette, depuis qu’elle est petite, son imaginaire. Ses deux films s’ouvrent donc sur cette ville à la fois connue et fantasmée, ou plutôt, sur l’un de ses points de départ, là où au bazar d’un carrefour stratégique s’allie la promesse de l’ailleurs et du mouvement. Les deux gares routières, l’une d’autobus et l’autre de taxi-brousses, sont d’immenses parkings ensoleillés où l’activité est dense mais aussi déjà, à l’aube, comme lasse et ralentie. La vie y apparaît constituée comme une routine, avec ses codes et ses secrets, elle s’offre d’emblée de manière documentaire, comme une « fenêtre ouverte sur le monde », éveillant la curiosité, l’envie d’observer et de comprendre comment ce territoire fonctionne, quelles fictions peuvent y naître.
Dans Deweneti, le premier panoramique d’ouverture plonge sur la ville, tel un oiseau qui décide de descendre chez les hommes après avoir un temps plané. Il est plus dramatisé que celui d’Un transport en commun, où la caméra s’en tient à son mouvement gauche-droite régulier, qui est aussi plus lent, plus stable, plus « objectif ». Mais dans les deux cas, la couleur est annoncée : s’il s’agit de raconter des histoires fictionnelles, et cela dans des formes narratives très constituées et stylisées (le conte pour Deweneti, la comédie musicale pour Un transport en commun), l’imaginaire élaboré dans ces histoires n’aura de cesse de s’appuyer sur le réel, et la dramaturgie de ces films de fiction, de se nourrir de la richesse des hommes et de leur ville comme dans un film documentaire. Dès qu’elle a entrepris de tourner à Dakar, Dyana Gaye a su qu’elle n’imposerait pas son tournage comme une perturbation aux gens qui vivent là. « C’est une difficulté que de tourner en décor naturel à Dakar, une comédie musicale de surcroît, en play-back ! Il faut constamment composer avec le réel. C’est une contrainte mais c’est surtout une incroyable richesse. Le réel s’inscrit dans la fiction et vient nourrir le pan documentaire du film. Je fais rarement de casting de figurants en amont. Je les choisis et on les embauche sur place, le jour du tournage, dans un décor qui est toujours plein de vie. On compose avec un lieu et avec les gens qui y vivent, qui y travaillent ou qui sont simplement de passage. On les implique, on favorise l’échange. » Aussi, sur ce genre de tournage, inutile de demander le « silence plateau ». D’une part, parce que cela serait pratiquement impossible à obtenir, mais aussi parce que selon la réalisatrice, il est bienvenu, et même souhaitable, que tout élément de fiction se frotte au réel afin de tester sa résistance, sa crédibilité.
Le monde et son mystère
Le Monde vivantExtrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Jean-Charles Fitoussi
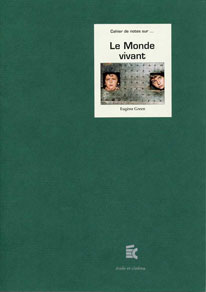 Voici un chevalier sans peur et une demoiselle à délivrer, voici un oracle, voici un ogre, voici des enfants capturés, voici un arbre enchanté qui parle et qui saigne, voici des animaux, des épées, des combats et des songes, des lévitations, des morts et des résurrections… Mais voilà que les chevaliers portent des jeans (ou plutôt des pantalons en « toile de Gênes à la mode deNîmes », comme les nomme le réalisateur), voilà que les sorcières sont lacaniennes, que les ogres conservent les enfants au congélateur, que l’on n’oublie aucune liaison de la langue française ni aucun subjonctif, présent ou imparfait, que les lois Jules Ferry interdisent aux ogres d’être polygames – et que tout cela semble à la fois le plus étrange et le plus naturel du monde. Ainsi va Le Monde vivant, par de drôles de chemins qui déroutent en allant tout droit – tout comme Dieu qui, selon Claudel, écrit droit avec des lignes courbes. Si c’est un conte, il se passe de nos jours. Et si c’est un film d’actualité, il est aussi d’un autre âge. Il va faloir faire avec les paradoxes – à moins de réaliser que c’est nous et nous seuls, spectateurs adultes, qui voyons des paradoxes là où ne règne que simplicité, et jeu d’enfant. Pourquoi les chevaliers ne porteraient-ils pas de jeans, ne chausseraient-ils pas des chaussures antibaves? Qui l’interdit ? Pourquoi n’entrerions-nous pas dans les chapelles par lévitation ? Qui l’en empêche ? Il suffit d’être léger, très léger… Commençons par faire comme font les enfants qui posent les règles de leurs jeux, ou comme Don Quichotte qui ne cesse de répondre à son écuyer : « Tout est possible, Sancho. » Oublions-nous, oublions ce que nous croyons savoir, et ouvrons-nous, ne serait-ce qu’un moment, à la possibilité d’être enchanté. Il en va, peut-être, de notre vie et de notre mort.
Voici un chevalier sans peur et une demoiselle à délivrer, voici un oracle, voici un ogre, voici des enfants capturés, voici un arbre enchanté qui parle et qui saigne, voici des animaux, des épées, des combats et des songes, des lévitations, des morts et des résurrections… Mais voilà que les chevaliers portent des jeans (ou plutôt des pantalons en « toile de Gênes à la mode deNîmes », comme les nomme le réalisateur), voilà que les sorcières sont lacaniennes, que les ogres conservent les enfants au congélateur, que l’on n’oublie aucune liaison de la langue française ni aucun subjonctif, présent ou imparfait, que les lois Jules Ferry interdisent aux ogres d’être polygames – et que tout cela semble à la fois le plus étrange et le plus naturel du monde. Ainsi va Le Monde vivant, par de drôles de chemins qui déroutent en allant tout droit – tout comme Dieu qui, selon Claudel, écrit droit avec des lignes courbes. Si c’est un conte, il se passe de nos jours. Et si c’est un film d’actualité, il est aussi d’un autre âge. Il va faloir faire avec les paradoxes – à moins de réaliser que c’est nous et nous seuls, spectateurs adultes, qui voyons des paradoxes là où ne règne que simplicité, et jeu d’enfant. Pourquoi les chevaliers ne porteraient-ils pas de jeans, ne chausseraient-ils pas des chaussures antibaves? Qui l’interdit ? Pourquoi n’entrerions-nous pas dans les chapelles par lévitation ? Qui l’en empêche ? Il suffit d’être léger, très léger… Commençons par faire comme font les enfants qui posent les règles de leurs jeux, ou comme Don Quichotte qui ne cesse de répondre à son écuyer : « Tout est possible, Sancho. » Oublions-nous, oublions ce que nous croyons savoir, et ouvrons-nous, ne serait-ce qu’un moment, à la possibilité d’être enchanté. Il en va, peut-être, de notre vie et de notre mort.
Perdre connaissance
Je me souviens avoir entendu quelqu’un citer, lors de la présentation d’un film au public cannois, un mot qu’il attribuait à Jean-Luc Godard, mot sensé fournir le sésame à une bonne perception d’un certain nombre de films, dont celui qui allait bientôt commencer : il s’agissait, pour bien sentir, de « perdre connaissance ». Je ne saurais dire combien de spectateurs ont pris le mot dans un seul de ses sens et, très obéissants, se sont évanouis pendant la projection (il en restait, de fait, assez peu quand les lumières se sont rallumées). De mon côté, j’optai plutôt (malgré moi) pour l’endormissement – sachant pourtant que le présentateur n’en demandait pas tant. Et, de cette séance et de ce film dont j’ai oublié jusqu’au titre, je ne me souviens plus que de cette parole préliminaire. Mais ne serait-elle restée en mémoire qu’en vue de faire mentir le célèbre proverbe « les paroles s’envolent, les écrits restent », elle servirait déjà la cause du Monde vivant, film tout entier habité par cette idée selon laquelle la parole est la réalité la plus tenace, la plus prégnante, la moins susceptible de s’envoler – bien qu’elle paraisse, à l’inverse de l’écrit, si fugace, impalpable et invisible. Aussi, dès le premier plan du film, la mère de Nicolas est-elle sûre, contrairement à son mari, que leur fils ne reviendra pas : « Ce qui est dit est dit. » Mais plus encore, cette recommandation est peut-être la meilleure qui soit pour aborder ce film d’Eugène Green : perdre connaissance – et commencer à écouter. Oublier ce qui fut appris à l’école ou imprimé par l’habitude, pour s’ouvrir à une réalité bien plus vaste qu’on ne se la représente. Il n’est dès lors pas étonnant que les enfants puissent réserver au film un meilleur accueil que les adultes : ils ont moins à désapprendre, moins de connaissances à perdre. Toute la première séquence expose ce préalable: il faut sortir de chez soi, quitter les quatre murs de la maison, pour rejoindre ce que l’on apercevait par la fenêtre, aller vers cette lumière jusqu’ici encore masquée par les feuillages. Rejoindre le monde vivant suppose une espèce de deuil – est-ce pour cela que retentit dans toute la première séquence le Dies Irae, traditionnellement chanté pendant la messe des morts ? Nicolas laisse la maison vide (sa chambre évoque une cellule), et arrive jusqu’à une lisière. Son regard est alors captivé par la vision d’un sanglier. Et ce sanglier renifle. Il sent. Il semble être le gardien du monde vivant : le carton du titre du film trouve place juste après cette apparition, comme si cette lisière et ce sanglier signalaient le seuil d’un monde nouveau, le monde vivant. Nicolas franchit cette frontière. C’est par lui qu’il nous sera donné de découvrir ce monde, de voir ce qui l’oppose, ce nouveau monde, vivant, à l’ancien, mort. Une indication est donnée par le carton qui suit le titre du film et le nom du réalisateur. On y lit une citation de Maître Eckhart, théologien de la fin du XIIIe siècle et instigateur de ce que l’on a appelé la mystique rhénane : « Si Dieu manquait à sa parole, sa vérité, il manquerait à sa divinité, et ne serait pas Dieu, car il est sa Parole et sa vérité. » La proposition peut surprendre, car on a l’impression de lire une sentence logique comme une démonstration, mais celle-ci, à l’examen, prend la tournure d’une tautologie, voire d’une pétition de principe : puisque Dieu est identifié à sa Parole et à savérité, alors Dieu ne peut manquer à sa parole ou à sa vérité sans quoi il ne serait pas ce qu’il est, Dieu, Parole, Vérité – étant considéré comme acquis que ces trois mots désignent au fond une seule et même chose. Comme si l’on disait : le bleu ne peut pas être vert, puisque s’il l’était, il ne serait pas bleu, car le bleu est bleu. Si l’on s’accorde sur l’identification de Dieu à sa Parole, sa vérité, alors la proposition est évidente, et se résume à : Dieu est Dieu, Dieu ne peut pas ne pas être Dieu…
écrit par Jean-Michel Frodon
Quatre cents ! C’est beaucoup. Mais assurément le premier long métrage de François Truffaut a frappé un grand coup, et même plusieurs. Il était devenu très jeune une figure en vue de la dénonciation des conformismes du cinéma français en même temps que de la revendication vigoureuse d’un amour éperdu du cinéma. Cela ne prouvait nullement que, devenant réalisateur, il saurait transformer son incontestable talent de critique et de pamphlétaire en talent de cinéaste. Non seulement il y parvient avec une évidence qui, au moins sur le moment, laisse ses nombreux adversaires sans voix mais il signe une œuvre riche de multiples propositions, et qui aurait des suites considérables.
Autofiction. Une des grandes innovations des 400 Coups, à laquelle on prête peu attention tellement elle semble aujourd’hui évidente, est son caractère autobiographique. Sans doute, comme les romanciers, les auteurs de films sont-ils souvent présents dans leurs films, de manière plus ou moins indirecte. Au cinéma, il était inédit de venir ainsi raconter son enfance, certes sous un nom d’emprunt, mais de manière explicitement très proche de ce qui avait été l’histoire vécue dans son enfance par le scénariste-réalisateur.
Scénariste-réalisateur, cela aussi semble aller de soi, et de ce côté les exemples abondent, mais ici la prise en charge par un artiste de la continuité écriture-mise en scène en relation avec sa propre existence est sans comparaison avec, par exemple, les films des autres réalisateurs de la Nouvelle Vague. Si tous revendiquent de raconter des histoires proches d’eux-mêmes, si on trouvera des échos entre la vie de Claude Chabrol et les personnages du Beau Serge et des Cousins, ou entre la vie d’Eric Rohmer et le milieu décrit par Le Signe du lion, ou entre le personnage d’Adieu Philippine et Jacques Rozier (mais pas grand chose chez Godard ou Rivette, sans parler de Resnais ou Varda, à l’exception des lieux), aucun ne colle à sa propre biographie comme Truffaut avec Les 400 Coups. Le film inaugure, au cinéma, ce qu’on appellera plus tard l’autofiction – ce n’est pas une autobiographie puisque le personnage s’appelle Doinel et non Truffaut, et qu’il n’y a aucun engagement de véracité. Pourtant, de la situation de famille compliquée (naissance non désirée de père inconnu, père adoptif) et restée cachée aux yeux de l’enfant qui la découvre par hasard et en souffre à la fréquentation des lieux d’enfermements, et même le vol de la machine à écrire, les principales péripéties du film appartiennent en effet à la vie de son auteur.
Outre le parcours familial et psychologique, et la présence du copain, René, directement inspiré de son ami Robert Lachenay (auquel Truffaut restera toujours fidèle, et qui figure au générique comme assistant régisseur), outre le quartier de Paris qui fut effectivement celui de son enfance, deux autres dimensions importantes de la personnalité de François Truffaut son mobilisées de manière affirmée : l’amour des livres, de l’écriture, de Balzac en particulier, et bien sûr la passion du cinéma, du cinéma comme lieu refuge, comme espace transgressif lorsque les élèves qui font l’école buissonnière s’y précipitent, mais aussi comme possible lieu d’un bonheur impossible, quand le père emmène femme et enfant pour une parenthèse joyeuse au Gaumont Palace, illusoire bulle de réunion heureuse de la famille.
Ecce Homo
Nanouk l’Esquimau
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Pierre Gabaston
 Plutôt que de chanter toujours la même antienne, « Flaherty est le père du documentaire » – répétez après moi ! C’est un alexandrin, la césure est après Flaherty (source de tous les mal-entendus) – écrivons autrement l’histoire d’un commencement : Nanook of the North est une matrice suprême. Flaherty’s Nanook/Matrix. Quand il rédige avec fièvre les linéaments de son récit pour donner corps à ses intentions, mots enlevés de verve, pochade en prose – sa fresque est pressante, ils’accommode mal de son impatience –, Flaherty se doute-t-il qu’il établit, là, l’américanissime thématique hollywoodienne – Walsh l’exaltera jusqu’à l’incandescence avec Objective, Burma ! – ordonnée autour d’un noyau narratif qui aimante et irradie chaque geste – chaque geste – de ses Inuits : le déplacement d’un petit groupe humain dans un environnement hostile ? Ce petit collectif, isolé dans un milieu extrême, menace obsédante pour sa survie, est une famille. Flaherty n’imagine pas de plus beau sujet, plus décanté, plus dramatique. Peu ou pas d’enfants qui découvriront le film vous diront le contraire. Ceux qui le connaissent, qui l’ont déjà vu, laisseront éclater leur joie à l’idée de le revoir encore une fois. Nanouk ! L’homme du Pôle magnétise les enfants. Que cette famille ne les laisse pas indifférents nous éclaire sur leurs désirs. Pourquoi se soudent-ils autour de celle de Nanouk ? Elle vit une vie surprise à son origine, filmée sous une lumière directe ; le soleil source de la vie (et de toute philosophie). Le moindre de ses actes apparaît indispensable à son existence. Pas un geste superflu n’embrouille ses rapports au monde. Gestes quotidiens et cependant fondamentaux. Gestes exemplaires. Ils magnifient le génie de ce petit groupe humain. Une famille peut-elle devenir épique ? Cet univers de l’extrême nécessité les sidère. Nanouk est au monde. Tout simplement. Il s’accorde à la place qui lui a été faite. Il l’accepte. Il accomplit ce pourquoi il a été fait. Sans tricher, sans mensonge. L’affectivité de chacun s’harmonise avec un geste authentique, rien moins que vital. Pas de désirs inutiles, pas de chantage affectif, rien qui poisse psychologiquement, ni culpabilise. Et puis que voient-ils aussi ? Un père qui prend le temps de jouer avec ses enfants ! À peine vient-il de finir la construction de leur maison. Mon élève Sylvester, ombre portée de son île Marie-Galante, vidé de toute mémoire immédiate – tous les matins, nous remplissons ensemble le tonneau des Danaïdes – , se remémore, plus de dix mois après avoir laissé Nanouk à sa mélancolie du Grand Nord, toutes les séquences du film ! Avec une précision de gestes qui en dit long sur sa soif d’y voir clair dans ses émotions pour (re)donner du sens à sa vie. Un sourire fend son visage quand il raconte la construction de l’igloo. Mais là n’est pas l’essentiel pour lui. Une émotion s’élève du fond de son âme quand il se penche vers le sol pour imiter Nanouk taillant le bloc de vraie glace qui deviendra la fenêtre. Elle étrangle les mots dans sa gorge quand il cherche son vocabulaire sommaire pour aller jusqu’au bout de son frémissement. Nanouk rajoute le dernier élément qui l’émerveille : un écran de glace, scellé perpendiculairement à la fenêtre, renvoie la lumière à l’intérieur de l’igloo. Nanouk se montre l’égal d’un Titan. Il capte et détourne la lumière du Soleil. Il l’infléchit vers l’intérieur de l’igloo. Admirable séquence, en effet. Elle doit moins à un film documentaire et davantage à l’imaginaire flamboyant de Robert Flaherty.
Plutôt que de chanter toujours la même antienne, « Flaherty est le père du documentaire » – répétez après moi ! C’est un alexandrin, la césure est après Flaherty (source de tous les mal-entendus) – écrivons autrement l’histoire d’un commencement : Nanook of the North est une matrice suprême. Flaherty’s Nanook/Matrix. Quand il rédige avec fièvre les linéaments de son récit pour donner corps à ses intentions, mots enlevés de verve, pochade en prose – sa fresque est pressante, ils’accommode mal de son impatience –, Flaherty se doute-t-il qu’il établit, là, l’américanissime thématique hollywoodienne – Walsh l’exaltera jusqu’à l’incandescence avec Objective, Burma ! – ordonnée autour d’un noyau narratif qui aimante et irradie chaque geste – chaque geste – de ses Inuits : le déplacement d’un petit groupe humain dans un environnement hostile ? Ce petit collectif, isolé dans un milieu extrême, menace obsédante pour sa survie, est une famille. Flaherty n’imagine pas de plus beau sujet, plus décanté, plus dramatique. Peu ou pas d’enfants qui découvriront le film vous diront le contraire. Ceux qui le connaissent, qui l’ont déjà vu, laisseront éclater leur joie à l’idée de le revoir encore une fois. Nanouk ! L’homme du Pôle magnétise les enfants. Que cette famille ne les laisse pas indifférents nous éclaire sur leurs désirs. Pourquoi se soudent-ils autour de celle de Nanouk ? Elle vit une vie surprise à son origine, filmée sous une lumière directe ; le soleil source de la vie (et de toute philosophie). Le moindre de ses actes apparaît indispensable à son existence. Pas un geste superflu n’embrouille ses rapports au monde. Gestes quotidiens et cependant fondamentaux. Gestes exemplaires. Ils magnifient le génie de ce petit groupe humain. Une famille peut-elle devenir épique ? Cet univers de l’extrême nécessité les sidère. Nanouk est au monde. Tout simplement. Il s’accorde à la place qui lui a été faite. Il l’accepte. Il accomplit ce pourquoi il a été fait. Sans tricher, sans mensonge. L’affectivité de chacun s’harmonise avec un geste authentique, rien moins que vital. Pas de désirs inutiles, pas de chantage affectif, rien qui poisse psychologiquement, ni culpabilise. Et puis que voient-ils aussi ? Un père qui prend le temps de jouer avec ses enfants ! À peine vient-il de finir la construction de leur maison. Mon élève Sylvester, ombre portée de son île Marie-Galante, vidé de toute mémoire immédiate – tous les matins, nous remplissons ensemble le tonneau des Danaïdes – , se remémore, plus de dix mois après avoir laissé Nanouk à sa mélancolie du Grand Nord, toutes les séquences du film ! Avec une précision de gestes qui en dit long sur sa soif d’y voir clair dans ses émotions pour (re)donner du sens à sa vie. Un sourire fend son visage quand il raconte la construction de l’igloo. Mais là n’est pas l’essentiel pour lui. Une émotion s’élève du fond de son âme quand il se penche vers le sol pour imiter Nanouk taillant le bloc de vraie glace qui deviendra la fenêtre. Elle étrangle les mots dans sa gorge quand il cherche son vocabulaire sommaire pour aller jusqu’au bout de son frémissement. Nanouk rajoute le dernier élément qui l’émerveille : un écran de glace, scellé perpendiculairement à la fenêtre, renvoie la lumière à l’intérieur de l’igloo. Nanouk se montre l’égal d’un Titan. Il capte et détourne la lumière du Soleil. Il l’infléchit vers l’intérieur de l’igloo. Admirable séquence, en effet. Elle doit moins à un film documentaire et davantage à l’imaginaire flamboyant de Robert Flaherty.
La Prisonnière du désert
Le Prisonnier du désir
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Pierre Gabaston

Où l’explicit réfléchit l’incipit
Après plusieurs années de recherche acharnée Ethan retrouve Debbie, kidnappée par les Comanches, et la ramène chez les Jorgensen. Descendu de cheval, il prend Debbie dans ses bras et la dépose sur les planches de leur auvent. Le vieux couple l’aide à gagner l’intérieur en rasant de face la caméra. Ethan reste seul sur le seuil, s’écarte pour laisser passer Laurie et Martin. Il regarde le jeune couple réconcilié comme l’image d’un bonheur dont lui-même n’a jamais su saisir le moment. A-t-il trop idéalisé Martha, comme une femme au foyer ? Pourquoi son frère Aaron lui a-t-il soufflé Martha ? N’a-t-il pas su lui avouer sa passion ravageuse ? Questions sans réponses, trous noirs de l’histoire, connaissance perdue. Sa grande carcasse redouble le bord droit du cadre de la porte et remarque dans l’espace du plan le jeune couple. Il le consacre, en devient son premier témoin. Il voit Martin avec Laurie, il revoit Martha en Laurie. Mais Martin a pu s’enhardir pour voler Debbie sous le tipi de Scar. Il y a pire, Scar connut Martha et Debbie, il y a de quoi devenir fou… Muet, mélancolique, Ethan se retourne, pris dans son cadre, et s’en retourne, repris par le désert, indéfiniment. Il repart, sans être aimé quelque part. Étonnant effet de réel à cet instant. Ethan sort de lui-même et reste lui-même dans la sortie de lui-même. Le désert l’arrache à tout ce qui n’est pas d’une essence, le désert le réduit aux passions essentielles. Son effacement dans l’éternité matérielle d’un film est son apothéose. Il s’absorbe dans la fresque ocre d’un Mythe. Faut-il imaginer Ethan heureux ?
Il nous tourne le dos. La Prisonnière du désert s’arrête là. Cette œuvre n’est pas une révélation pour un au-delà, mais une direction pour notre gouverne en ce monde-ci. Martha/Laurie : pulsions. Deux mouvements identiques aux finalités contraires. Martha s’arrête dans son élan pour Ethan. Laurie court libre vers Martin. Elle s’engage sans retenue dans le champ dégagé du format Vista Vision. Martha/Laurie : reprises de dos par la caméra. L’une biffée (croix des bretelles dans son dos), l’autre blanche et ouverte. L’impulsion comprimée de Martha, pour qui un interdit endigue son mouvement à l’arrivée d’Ethan, se déplace et se libère avec Laurie qui bondit et franchit la rampe de la scène familiale, sort de son cadre en deux plans. Plus de frein au transport de son cœur. La beauté humaine éclate, se cristallise soudain dans un élan de vie de quelques secondes, dans ce film de Ford Laurie s’affranchit du temps de l’histoire à travers un espace maintenant réduit et à nouveau parcouru. Écrasée par le vide qui assiège sa maison Martha hallucine le retour d’Ethan et, de la fiction, le fait revenir à la vie. Ainsi naît la réalité de l’histoire avec Ethan perdu et retrouvé : sort précurseur de celui de Debbie, perdue, elle aussi, et retrouvée. Ils reviendront réunis. Jusqu’au clivage tragique de ce dernier plan fixe qui à la fin du film les fissure et les sépare à jamais. Debbie rentre, mais pas Ethan. Vacant, disponible, Ethan regagne la profondeur de champ qui l’avait vu poindre, mais cette fois il la remonte en sens inverse, errant dans un espace ouvert à une histoire sans fin. Il fut l’infatigable arpenteur qui traça les sillons de l’histoire. À nous, maintenant, de savoir écrire le scénario de l’Histoire. Ethan face à nous. Plus de retournement à 180° sur l’axe de la projection de son désir. Différence essentielle avec l’ouverture du film. Ethan entrait dans le décor de son rêve nostalgique de survivant de l’Histoire, le foyer des Edwards : épée en main, Ethan de guerre revient habiter un canevas brodé aux formes un peu mièvres d’une douce imagerie populaire. Deux éléments fondamentaux composent ce tableau. La longue tableau tour de laquelle se ressoude une famille pour le rituel des repas. Et l’âtre, pour un Ethan s’imaginant prendre son temps, brûlant nonchalamment des bûches dans la cheminée. Ethan s’est-il perdu dans l’illustration d’un livre des cérémonies édifiantes à l’imagerie de chromo ?
Zéro de conduite
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Pierre Gabaston

Film de rage. Transport de Zéro de conduite. Six ans plus tard, ce même emportement gagnera La Règle du jeu de Renoir – l’autre franc-tireur du cinéma français. Zéro de conduite appelle à la révolte. Quatre « rebelles sans cause » se lancent à l’assaut du ciel. Au-delà du faîte du toit de leur collège, vers quels vertiges chavirent-ils quand ils lèvent leurs bras ? Plus vite qu’ils ne le pensent, quand ils auront vingt ans, ils croiseront leurs aînés satisfaits de leurs combinaisons putrides ; règles de tous leurs jeux. Deviendront-ils comme eux ? Ils auront l’âge idéal pour répondre à d’autres appels. La ligne Maginot… un autre imaginaire. Il n’est qu’une mesure pour estimer le troisième film de Jean Vigo : sa démesure et rugir avec les insurgés. Ou alors, confondons-nous en contorsions dans la courée des « bourgeois sphériques », rejoignons la guignol’s banddes « personnages considérables » pour parler comme Ubu. « À la trappe ! À la trappe !» Il est des films qui tranchent comme une lame. À nous de choisir.
Ce « point de vue » en cinq lettres, merdre alors !
Six lettres et 14 834 signes.
Commençons par le commencement, sans souci de logique, et regardons cet incipit sulfureux : soubassement volcanique. Ce collégien assis dans un compartiment de train, en uniforme, en casquette et capote à boutons dorés, serrant de ses doigts un paquetage, ne nous rappelle rien ? Vigo revenant un soir de cafard dans son bahut de Chartres pour de longues semaines. Oui, oui, bien sûr, mais cette image-écran de Caussat et Bruel – partie pour le tout – remémore ces milliers et ces milliers d’ouvriers, paysans, ramoneurs, maîtres d’école, chausseurs sachant chausser, poètes assassinés munis de leurs papiers (« J’ai reçu deux éclats d’obus/Et la médaille militaire »), ou déjà surréel (« Je serai ennuyé de mourir si jeuneneu, Ah ! puis MERDE. »), Boudu en personne suspendu à la chanson qu’il dégoisa montant au front (« Sur les bords de la Rivieraaa… »), étudiants en médecine qui reviendront complètement dadas : tous prirent le train, déracinés d’eux-mêmes, dépossédés de leur existence pour abreuver de leur saignée les sillons de Champagne ou d’Argonne. On s’éloigne du sujet ? Nous y sommes en plein, selon Vigo. Avant la caserne, il y eut l’école. Or l’école de Jules Ferry ne fut pas toujours en crise. Établie sur le traumatisme de la Commune – plus jamais ça ! – elle forma le poilu de 14. Tous prirent leur élan. Comme un seul homme. Tout de même. Pète-Sec accueillant sa troupe à la gare, en quoi diffère-t-il d’un serre-patte venu chercher les bleubites sur un même quai ? Et Bec-de-Gaz, supervisant les recrues alignées devant leur lit dans la chambrée ? Et le Principal, passant en revue son contingent avant sa parade en ville ? Rassemblement ! Corps au garde-à-vous dominés par ce haut mur en pierres bouchant toute perspective. Vigo ne filme plus une cour de récréation mais une cour de caserne lors d’une prise d’armes avec sa chair à canon bien sanglée, en tenue réglementaire. Pète-Sec y veille. La malice de Vigo infléchit leur charge. « Sus à la femme ! », en ville. La classe en folie suit Huguet qui court après une femme. Moment d’anthologie. Vigo filme toujours l’idée de l’imaginaire. Caussat et Bruel, Bruel et Caussat coupés de leur glèbe – d’où viennent-ils ? –, mis dans le train de la mission à fossiliser leur être où ne pas être. Immobiles, ils déraillent soulevés par leurs attractions-impulsions, s’enfument de leur griserie. Repris sur le quai givrant d’une gare (à leur âme). Transfert-dortoir – ellipse. Je ne veux voir qu’un lit ! Et pas de linceul en portefeuille ! Chaque chose en son temps. Quoi de plus empressé pour deux enfants qui se retrouvent à la fin de l’été que d’échanger leurs émois des grandes vacances ? Ils furent la matière des rédactions de nos (lointaines) rentrées. Racontez ! Quoi de plus spontané que de brandir sa nouvelle trousse outillée, faut voir !, de comparer, de relever fièrement ses pieds avec au bout ses nouvelles chaussures, de gonfler son T-shirt orné d’une grosse araignée argentée ? T’as vu ? Caussat et Bruel sont des collégiens ordinaires. À qui n’échappe pas cette excitation érogène. Cette rédaction-là, jamais ils ne pourront l’écrire. C’est la seule qui vaille à leurs yeux. La seule qu’ils voudraient détailler. Ils ont mûri, ils ne sont plus les mêmes à la veille de cette rentrée, ils se le disent en une surenchère de (presque) surmâles – débitrice d’une séquence du cinéma muet dont Zéro de conduite va s’étirer. Et pour de longues années ne pas s’en remettre.
écrit par Bernard Génin
On connaît la célèbre phrase de Pascal dans une de ses lettres aux Jésuites: « Excusez-moi, je n’ai pas eu le temps de fairecourt. » Preuve que faire court et limpide demande bien plus de temps qu’être long et verbeux. Avec Azur et Asmar, MichelOcelot a pris le temps de « faire court ». Il a même supprimé quelques passages qui lui tenaient à cœur pour ne pas dépasser le timing prévu (une heure trente). Quand il commence ce film, il est au sommet de sa popularité. Le succès de Kirikou et la Sorcière l’autorise à avoir des exigences. La première sera de travailler avec son équipe en un lieu unique. On sait que, en raison de la quantité de travail qu’ils requièrent, les longs métrages d’animation français sont exécutés dans différents studios, l’animation étant le plus souvent exécutée en Asie, où son coût est dérisoire. Pour Michel Ocelot, les allers-retours dans cinq pays différents pour finaliser Kirikou et la Sorcière avaient été vécus comme un cauchemar. Tous les artistes réunis sur Azur et Asmar ont donc travaillé sur place, à Paris. Quant au budget du film (dix millions d’euros), il est le double de celui de Kirikou. Le cinéaste s’est donc donné les moyens de maintenir le cap sur ce qui semble être les lignes de force du film : équilibre, simplicité, limpidité. On peut en ajouter d’autres, sur la forme comme sur le fond : symétrie, égalité, harmonie. Tout est dit. On verra comment, à plusieurs reprises, au fil du récit, la symétrie et l’équilibre seront rompus, pour être aussitôt rétablis par Jeanne.
Le ton d’Azur et Asmar est celui d’un conte initiatique, puisant abondamment dans le merveilleux (les héros usent de clés magiques, ils sont entourés d’elfes), ainsi que dans le roman d’apprentissage et le récit de chevalerie (comme dans les chansons de geste d’antan, ils sont nobles et en quête de la main d’une belle dame). But de l’entreprise ? Célébrer la civilisation islamique du Moyen Âge, brillante et ouverte. Mais aussi donner au récit une résonance contemporaine, parler à travers la fable de la France d’aujourd’hui, de l’animosité entre Français de souche et immigrés maghrébins. « Cette situation me révolte, déclare Michel Ocelot. Il faut se tendre la main. » (Le Figaro, 25 octobre 2006)
Une vie de chat
Un film noir en couleurs
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Bernard Génin

En 1999, Kirikou et la sorcière, un dessin animé français de long métrage remporte un succès public inattendu et international ! A Chicago, par exemple, il reçoit un double prix : celui du « Jury enfants » et celui du « Jury adultes ». En Grande Bretagne, Jamie Russell, critique à la BBC, remarque : « Les différents niveaux de significations de l’histoire la rendent accessible aux jeunes enfants comme aux adultes ». Un a priori répandu a longtemps voulu que le dessin animé de long métrage s’adresse uniquement aux enfants. Les studios Disney, qui dominèrent le marché pendant des décennies, étaient les champions du film
« familial », mais pour enfants d’abord, souvent basé sur des contes de fée, distrayant, manichéen, obéissant à des canons esthétiques contestables et surtout éloigné de la vraie vie. Mais réunir dans la même salle parents et enfants devant un spectacle intelligent, ni abrutissant ni violent, et qui, en plus, véhicule discrètement des valeurs humanistes, c’est plus difficile. Voilà ce qui frappe dans Une vie de chat : ce tranquille mélange des genres – jamais vu en animation – où l’on trouve le film noir (braquages, agressions, suspense, poursuites), le récit initiatique (une petite fille mutique retrouve la parole), la comédie burlesque (avec des gangsters plus comiques que dangereux) et même un soupçon de fantastique (étranges apparitions de Costa en poulpe rouge, puis du colosse de Nairobi dans l’esprit dérangé de Costa). Jamais le résultat ne semble le produit d’une recette. Les auteurs ont trouvé le bon dosage et l’originalité du film lui vaudra non seulement d’être salué par une presse unanime, mais de concourir aux oscars 2011
(voir « Autour du film »). C’est de ce mélange des genres et des tonalités (comique, poétique, picturale, dramatique etc.) que nous allons traiter, en examinant comment les codes du film noir ont été rendus accessibles aux enfants.
écrit par Jean-Marc Génuit
Une Odyssée saoudienne
« Ce qui compte c’est se libérer soi-même, découvrir ses propres dimensions, refuser les entraves »
Une chambre à soi, Virginia Woolf
Mis en scène par la première et unique réalisatrice saoudienne de l’histoire du septième art, Wadjda s’offre comme l’émouvant portrait d’une enfance intrépide mue par la force de son désir et qui s’efforce d’élargir son champ des possibles. Éloge du « génie propre à l’enfant » , le récit initiatique d’Haifaa Al-Mansour s’accorde à la quête émancipatrice de Wadjda, fillette audacieuse d’un quartier populaire de Riyad qui ne cessera d’opposer la sincérité de ses « émotions indisciplinées » au conservatisme de l’imaginaire théocratique.
Héritier d’une foisonnante lignée de films « réalistes », Wadjda dévoile une inspiration documentaire où le geste de mise en scène s’évertue à « saisir » le réel pour insuffler son mouvement et ses effets de vérité à la trame fictionnelle. Ici, l’atmosphère et la topographie faubouriennes d’une cité urbaine participent à donner son « grain de réalité » à l’œuvre en s’imposant comme une présence structurante qui suscite une forte « impression de réalité ». Matière première qui « fait signe », cet environnement sans qualités particulières où les terrains vagues et les chantiers immobiliers ne manquent pas nourrit la dramaturgie narrative de sa force d’incarnation et d’authenticité. L’espace de la ville s’expose ainsi comme la chair, le vif du sujet d’une fiction écartant les visions pittoresques afin de restituer les scènes ordinaires, les espaces de vies, les identités visuelles, les croyances et autres habitus culturels propres à un « échantillon de civilisation » de la péninsule arabique.
Au rythme de sa narration classique, ce récit saoudien réalisé dans le prolongement du « Printemps arabe » livre en effet un point de vue culturellement situé. La réalisatrice s’applique à mettre en scène sans jugement de valeur les traditions culturelles à travers lesquelles la société saoudienne contemporaine se représente et se perpétue. Sans engager sa dramaturgie sur la voie d’une diatribe féministe qui attaquerait la légitimité de la doctrine patriarcale monarchique, son « éthique », sa symbolique ou encore ses valeurs, Haifaa Al-Mansour en dévoile les effets de pouvoir et de domination. Elle révèle les fictions identitaires et les fondements moraux à travers lesquels les consciences sexuées en Arabie Saoudite sont pressées de se penser, de s’éprouver et se construire.
Elle représente dans son film cette vision fondamentalement inégalitaire de la société forgée et soutenue par un régime qui promulgue l’hégémonie masculine au rang de principe intangible et qui infériorise juridiquement les femmes en les plaçant sous l’autorité civile d’un tuteur masculin. La réalisatrice met ainsi en évidence l’existence d’une politique des identités extrêmement codifiée qui se trouve à l’origine d’une déroutante « ségrégation des genres » prohibant la mixité dans les lieux dits publics ainsi que dans la plupart des sites d’activité professionnelle malgré certaines modifications apportées au Code du travail en 2006.
écrit par Camille Girard
En confiant le scénario à Daniel Pennac, Didier Brunner choisit, non pas un scénariste, mais un écrivain. Il opte pour quelqu’un qui ne sait pas nécessairement écrire pour le cinéma mais qui sait très bien en revanche inventer des histoires. Pennac ne s’en prive pas, il atomise l’univers tendre et poétique des albums pour imaginer un monde brisé en deux. Il sépare des personnages que l’on pensait inséparables, il oppose, il bouleverse, il fracture, bref il met tout « sens dessus dessous ». De qui d’autre pouvait venir pareille offense ? Seul un ami, un intime pouvait savoir que pour Gabrielle Vincent, la politesse et les convenances n’étaient pas sa tasse de thé. Quand Benjamin Renner et ses acolytes belges découvrent le scénario, ils sont effarés. Ernest n’est plus le monsieur Lebon des albums, il n’a plus cette âme de père bienveillant, de tuteur au grand cœur, non, il est maintenant un pair pour Célestine, qui elle, n’est plus l’enfant qui doit tout apprendre de l’adulte. Chacun son monde, chacun son destin, à chacun sa solitude. Entre les deux personnages, il ne sera plus vraiment question d’amour filial. Leur rencontre improbable, contingente, sera celle d’une réalité crue, d’un drame banal évité de justesse, Ernest sera à deux doigts de dévorer Célestine. Le pire écarté, les deux personnages devront se retrouver, composer à partir de ce réel terrible, et s’inventer une nouvelle forme de relation. Dès lors, Ernest et Célestine ne pouvaient plus être les mêmes (que dans les albums), Benjamin Renner brouillonne, crayonne, il laisse les personnages se re-dessiner tout seul. Peu à peu, croquis après croquis, ses personnages deviennent « animables », ils prennent leur autonomie, ils renaissent sous les apparences d’une vérité irréfutable.
L’adaptation cinématographique est un terme qui porte mal son nom, un vieux malentendu laissant vivace cette idée trompeuse qui voudrait que l’on retrouve dans un film ce que l’on a aimé dans un livre. La réussite du film de Benjamin Renner et Daniel Pennac est la démonstration brillante qu’une adaptation cinématographique n’est justement pas une opération qui vise à transposer ou à traduire une œuvre littéraire. Convoquer dans un film ce qu’il y a dans un livre et en fixer définitivement une représentation conduit en général à de grandes déceptions. Et dans notre cas, aurait immanquablement abîmé la relation forte et singulière que Gabrielle Vincent avait su tisser avec ses lecteurs. Osant au contraire une ré-écriture audacieuse à partir de l’univers de l’auteure, les réalisateurs ont su, avec beaucoup de panache, dévoyer les attentes des lecteurs et ainsi préserver intact le lien qui les unissait avec les albums. Par une relecture radicale mais un geste artistique d’une grande délicatesse, ils ont su remettre en œuvre, prolonger l’éclat et faire renaitre des personnages, non pas en les adaptant, mais – pour reprendre un thème centrale de l’auteure – en les adoptant. Le film de Benjamin Renner et Daniel Pennac n’est donc pas une adaptation au sens malheureux du terme mais plutôt une adoption, une « adoptation » cinématographique, et de ce fait, le seul hommage possible pour celle qui en était l’origine.
E.T. l’extraterrestre
L’enfance-fiction
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Camille Girard
Ce n’est certainement pas un hasard si E.T est venu tardivement trouver une place dans le catalogue École et cinéma. Il fallait peut-être attendre le temps nécessaire pour admettre enfin que pour la génération qui est la mienne, celle qui avait plus ou moins l’âge de Elliot au début des années 80, ce film avait réellement marqué notre époque. Où était donc E.T depuis toutes ces années ? S’était-il réfugié dans la maison des Enfants de cinéma parmi les peluches et les péloches du catalogue, sans qu’aucun adulte ne se doute de sa présence ?
Je me souviens de la première fois où j’ai vu E.T au cinéma, mon grand-frère m’y avait accompagné, j’avais huit ans. J’en suis resté, comme la plupart des enfants, profondément marqué, restant longtemps confronté à un incompréhensible inscrit au plus profond de mon corps et de mon esprit. D’un côté, j’étais conquis par l’histoire merveilleuse, par l’onirisme d’une rencontre parfaite entre un jeune garçon et un extraterrestre, de l’autre je restais intensément perturbé, comme commotionné, par l’image de l’angoisse que représentaient les effets morbides de cette rencontre. Si Spielberg jouit d’un crédit inépuisable auprès des adultes qui ont grandi avec ses films, ce n’est pas tant qu’il s’adresse à une génération qui jouaient avec des talkies-walkies plutôt que d’échanger sur facebook mais bien parce qu’il a toujours su avec talent nous prendre par la main pour nous conduire au plus profond de nos angoisses.
Le cinéma prend parfois les effets d’un jeu de cache-cache à la manière de l’enfant qui se trouve soudain saisi de peur, au moment pourtant, où il est sur le point de trouver l’autre qui s’est caché. L’art du cinéma, et celui de Spielberg en particulier, recèle de ses instants inquiétants et indéfinissables où l’on s’étonne à se surprendre soi-même. E.T est un film de science-fiction qui a pour seuls territoires une maison, une forêt et un ciel étoilé. Il est film de l’intime tout autant que de l’étrange, du quotidien, de la famille tout autant que de l’ailleurs et de l’extraordinaire. Dans ce sens, E.T, peut-être plus que n’importe quel autre film de Spielberg, opère sans cesse d’énigmatiques rapprochements, il nous donne, sans que l’on sache pourquoi, ce qui en définitive nous échappe. Une fois la séance de cinéma terminée, les images du film se volatilisent pour se mêler peu à peu à celles de notre vie réelle, puis, prenant les formes d’une curieuse ponctuation, nous offrent comme un supplément d’âme à l’incompréhensible de nos existences.
Trois portraits, trois rencontres
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
Un art du regard
Le portrait, c’est un art du regard et de l’observation. Dans Beppie, Espace et La Sole…, l’ambition des cinéastes consiste moins à définir ou analyser des personnages (comme ça aurait été le cas dans un reportage) qu’à nous offrir du temps avec eux, en les accompagnant du regard et en les écoutant. Aucun de ces films ne prétend à l’exhaustivité. Ce ne sont pas des portraits objectifs. Ce sont des rencontres dans lesquelles s’exercent trois formes de subjectivité. Il n’empêche que ce sont des documentaires car ces regards témoignent d’une réalité. Mais cette réalité est propre à la relation des cinéastes aux gens qu’ils filment. Dans un film, nous voyons l’action d’un regard, enregistré et matérialisé dans des plans. C’est ce lien invisible dans la vie de tous les jours que le cinéma rend palpable, physique. Grâce aux films documentaires, on peut voir dans le regard d’un autre ! Nous sommes si habitués à voir des images que nous oublions le caractère proprement fabuleux de cette invention rendue possible grâce au cinéma. Mais il faut se frotter les yeux et s’en souvenir. Ce partage est unique. Ainsi placés dans le regard de Johan van der Keuken, d’Éléonor Gilbert et d’Angèle Chiodo, nous sommes conviés à regarder ce que d’autres personnes (ces cinéastes) ont regardé, et de façon très concrète nous sommes conviés à rentrer dans leurs yeux. Qu’est-ce que leurs yeux ont vu que les films nous donnent à voir ? Trois personnages : deux fillettes d’une dizaine d’années et une grand-mère de plus de quatre-vingt-dix ans. Comment ces yeux regardent-ils ces trois personnages ? Avec bienveillance, humour, tendresse, et surtout avec cœur. Dans les trois films, il s’agit d’approcher la vérité cachée d’une personne, de chercher à la comprendre sans prétendre la connaître, d’accéder au mystère de l’autre. À l’image de La Sole entre l’eau et le sablequi joue sur une référence de documentaire scientifique pour exprimer sa soif d’exploration : « Partons à la rencontre de la sole… », ces portraits se présentent comme des découvertes. D’abord physiques. On voit d’ailleurs que Johan van der Keuken et Angèle Chiodo ont un vrai plaisir à détailler les corps de Beppie et de la grand-mère en filmant à plusieurs reprises des mains (paume ouverte et poing fermé), des pieds, des jambes… Mais ces trois films manifestent surtout une véritable passion pour les visages dont ils restituent une multiplicité d’expressions. Visage endormi, visage au réveil, visage masqué, visage maquillé, visage interdit, visage complice… dans La Sole entre l’eau et le sable. Visage rieur, visage déterminé, visage convaincu, visage révolté, visage abattu… dans Espace. Plus encore, dans Beppie, Johan van der Keuken fait du visage de la fillette le cœur du film, privilégiant très souvent les gros plans aux plans d’ensemble – qui apporteraient au spectateur des éléments de contextualisation. Ainsi, dans la salle de classe ou dans la salle des fêtes (où aura lieu la projection des dessins animés), on remarque que Johan van der Keuken maintient hors-champ les adultes et les autres enfants, et focalise toute son attention sur les expressions de Beppie, véritablement scrutées en une série de plans serrés. Beaucoup de cinéastes auraient jugé utile de placer un contrechamp pour montrer la situation, les professeurs, les lieux. Ce n’est pas le cas de Johan van der Keuken, qui par ce biais exprime avec force que son sujet n’est pas la situation ou le contexte, mais exclusivement la personne tout entière de Beppie, ses expressions enflammées, ses réactions. En voyant ça, on ne peut s’empêcher de penser au grand cinéaste danois Carl Theodor Dreyer (1889-1968) qui fit du visage filmé en gros plan l’axe esthétique de son œuvre. Convaincu qu’on pouvait voir l’âme d’une personne se dessiner sur le visage, il réalisa en 1927 La Passion de Jeanne d’Arc, film entièrement centré sur la figure de son interprète Renée Falconetti, visage-paysage creusé par l’amour de Dieu. Plus tard, Dreyer dira : « Quiconque a vu mes films saura quelle importance j’attache au visage de l’homme. C’est une terre que l’on n’est jamais las d’explorer. Il n’y a pas de plus noble expérience, dans un studio, que d’enregistrer l’expression d’un visage sensible à la mystérieuse force de l’inspiration ; de le voir animé de l’intérieur, en se changeant en poésie. » Cette profession de foi faite au cinéma de fiction pourrait tout autant valoir pour le documentaire. Car c’est bien cette puissance poétique que recherche Johan van der Keuken quand il filme le visage de Beppie exaltée par un dessin animé ou sous une douche, toute au plaisir jaillissant d’un jet d’eau.
Lire la suite dans la plateforme NANOUK
Recréer le modèle
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Rose-Marie Godier
Vigour :
Je me demande ce que vous avez bien pu repêcher !
Lestingois :
Je crois que c’est un homme !
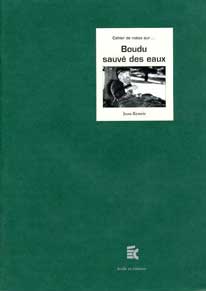 À maintes reprises, Jean Renoir s’est exprimé sur le caractère volontairement non-fini de ses films : il faut, dit-il, qu’un film soit fini par le public, puisque, plus généralement : « Les arts majeurs sont les arts qui permettent au public de participer à la confection de l’oeuvre d’art. » Cette exigence, qui fut celle des peintres impressionnistes, tend à faire du film, non pas le lieu clos d’une simple représentation, mais celui, ouvert, d’une rencontre. C’est dire aussi que chaque spectateur supplée à sa façon : « En réalité, poursuit Renoir, un film est autant de fois un film qu’il y a de spectateurs. Enfin, si le film est bon. Si le film est trop précis, pour chaque spectateur, c’est le même film. » Dans cette perspective, Boudu sauvé des eaux apparaît déjà comme un bon film, au vu de la multiplicité des commentaires qu’il a pu susciter jusque-là. De la pièce de René Fauchois au Boudu sauvé des eaux de Jean Renoir s’opère, nous l’avons vu, une transformation qui est aussi changement de registre. Parlant de l’adaptation, Renoir adopte une fois de plus un réflexe de peintre : « Après tout, ce qui nous intéresse dans une adaptation, ce n’est pas la possibilité de retrouver l’oeuvre originale dans l’oeuvre filmée, mais la réaction de l’auteur du film devant l’oeuvre originale. (…) On n’admire pas un tableau à cause de sa fidélité au modèle, ce qu’on demande au modèle, c’est d’ouvrir la porte à l’imagination de l’artiste. (…) Le véritable artiste croit que sa fonction se borne à copier le modèle. Il ne se doute pas, pendant qu’il travaille, qu’il est en train de recréer le modèle, que ce modèle soit un objet, un être humain, voire une pensée ». C’est dans cette recréation du modèle qu’on pourrait ainsi déceler tout ce qui constitue l’originalité de Jean Renoir.
À maintes reprises, Jean Renoir s’est exprimé sur le caractère volontairement non-fini de ses films : il faut, dit-il, qu’un film soit fini par le public, puisque, plus généralement : « Les arts majeurs sont les arts qui permettent au public de participer à la confection de l’oeuvre d’art. » Cette exigence, qui fut celle des peintres impressionnistes, tend à faire du film, non pas le lieu clos d’une simple représentation, mais celui, ouvert, d’une rencontre. C’est dire aussi que chaque spectateur supplée à sa façon : « En réalité, poursuit Renoir, un film est autant de fois un film qu’il y a de spectateurs. Enfin, si le film est bon. Si le film est trop précis, pour chaque spectateur, c’est le même film. » Dans cette perspective, Boudu sauvé des eaux apparaît déjà comme un bon film, au vu de la multiplicité des commentaires qu’il a pu susciter jusque-là. De la pièce de René Fauchois au Boudu sauvé des eaux de Jean Renoir s’opère, nous l’avons vu, une transformation qui est aussi changement de registre. Parlant de l’adaptation, Renoir adopte une fois de plus un réflexe de peintre : « Après tout, ce qui nous intéresse dans une adaptation, ce n’est pas la possibilité de retrouver l’oeuvre originale dans l’oeuvre filmée, mais la réaction de l’auteur du film devant l’oeuvre originale. (…) On n’admire pas un tableau à cause de sa fidélité au modèle, ce qu’on demande au modèle, c’est d’ouvrir la porte à l’imagination de l’artiste. (…) Le véritable artiste croit que sa fonction se borne à copier le modèle. Il ne se doute pas, pendant qu’il travaille, qu’il est en train de recréer le modèle, que ce modèle soit un objet, un être humain, voire une pensée ». C’est dans cette recréation du modèle qu’on pourrait ainsi déceler tout ce qui constitue l’originalité de Jean Renoir.
La pièce de René Fauchois qui, nous l’avons vu, comprenait à cette époque trois actes, se jouait dans un décor unique : l’intérieur de la librairie, où trônaient un buste de Voltaire par Houdon et une grande photographie de Victor Hugo par Nadar. Ce décor s’ouvrait au fond sur le quai, et une réserve y était aménagée : celle de la salle à manger. C’est dans cette salle à manger que Boudu séduisait Madame Lestingois, tandis que sur la scène principale le libraire traitait avec une ironie condescendante une cliente peu versée dans les belles-lettres. Notons que Renoir ne s’embarrasse pas de ces pudiques sous-entendus : c’est dans la chambre, devant la gravure du zouave, que Boudu mène à bien son affaire. Quant à la suffisance du libraire – qui pouvait, certes, faire rire aux éclats le public plus lettré du théâtre –, Renoir l’a gentiment déplacée sur Boudu : le rire est plus franc des Fleurs du mal au magasin de fleurs et aux Fleurs du jardin, jusqu’à la scène pédante de la pièce, où Lestingois écrasait de son savoir livresque une cliente, dont l’inculture risquait fort d’être partagée par un public plus populaire. C’est dire d’emblée que Fauchois et Renoir ne s’adressent pas à un même public.
Sidewalk Stories
Le retrait, le voile et l’énigme
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Rose-Marie Godier
« Au début d’un chant nous ne pouvons savoir
ce qui va suivre, mais en entendant le dernier son,
nous comprenons tout ce qui a précédé. »
Guido d’Arezzo, Micrologus, 1025.

C’est à la mort de Charlot que nous convia en 1952, dans Les Feux de la rampe, Charlie Chaplin : Charlot meurt, non pas sur scène, mais en coulisse et face au spectacle de la beauté du monde, face au corps en mouvement d’une ballerine, qui prolonge encore le souvenir du Petit Vagabond. Mais Charlot jamais ne fut un personnage ; comme Arlequin, et sous l’effet d’un curieux évhémérisme, il fut d’emblée un mythe. Chaplin le sait bien. Les mythes ne meurent pas, point n’est besoin de les ressusciter. Et si on les convoque, ce n’est pas à la manière dont on convoque les spectres, les doubles, ou les fantômes, mais à seule fin de révéler dans le tissu de notre modernité d’anciennes forces oubliées. Jean Renoir s’enthousiasmait pour les tragiques grecs, que le recours aux mythes, c’est-à-dire à des histoires que tout le monde connaissait, préservait de tout racontage d’histoires : « Dans une structure qui est toujours la même, on est libre d’améliorer ce qui est seul valable, le détail de l’expression humaine » . De la même manière envisageait-il la commedia dell’arte : jouer « à la cane », c’est-à-dire improviser sur des canevas, permettait l’expression la plus pure du « réalisme intérieur », qui faisait à ses yeux tout le prix de l’art cinématographique. Ainsi, en recourant au mythe du Petit Vagabond – celui qui dans Le Kid entreprenait d’adopter un enfant –, Charles Lane n’entreprend pas un film nostalgique, encore moins archaïsant ; si l’on ne peut s’empêcher de voir, derrière la silhouette de l’Artiste, celle de l’homme à la canne, c’est que dans Sidewalk Stories le présent se fait réminiscent.
Les deux films ne sont pas superposables, et dans le « bougé » qui s’opère entre l’Autrefois et le Maintenant, Sidewalk Stories propose aussi une figure rédimée de l’artiste : dans Le Kid, le mauvais père qui abandonne la femme et l’enfant, était peintre ; pour Lane, le peintre est figure de l’altruisme. Dans ce film, que le spectateur d’aujourd’hui ne peut envisager d’un regard innocent, et où, pour reprendre les mots de Walter Benjamin, « l’Autrefois rencontre le Maintenant dans un éclair pour former une constellation », une évidence s’impose : dès la rencontre entre l’Artiste et la fillette, dès l’adoption, est nécessairement inscrite pour nous leur finale séparation. Car, semblables aux spectateurs du théâtre grec, nous connaissons la fin. Et, de même que cette fin pesait sur la perception entière de la tragédie attique dès son commencement, de même la fin de la fable pèse-t-elle sur les images légères de Sidewalk Stories – non pas l’épilogue, qui reste une totale surprise, mais la fin de l’histoire d’amour entre les deux personnages. Sidewalk Stories se joue dans l’éphémère, dans un temps précieux, fragile : dans un temps orienté. Aussi le film échappe-t-il au burlesque, au temps accéléré et au « présent du ressenti, perpétuellement renouvelé », qui dans les films du genre autorise tout juste une « lecture à court terme » et provoque le rire. Dans Sidewalk Stories le réel n’est jamais loin, celui des rues, des commissariats, des asiles de nuit : le film, loin d’abstraire ses personnages de la réalité, entreprend de construire autour d’eux l’impalpable enclave du rêve et de la liberté. Assez loin du réel pour éviter l’émotion, et de l’irréel pour écarter le rire, la comédie progresse sur une ligne de crête – du moins jusqu’à sa toute fin. Et l’on peut se demander si Charles Lane ne s’est pas précisément servi de certaines formes établies, afin de donner du sens à certaines propriétés du cinéma.
Car Sidewalk Stories n’est pas un film muet : la montée sonore de la dernière séquence est là pour attester, non pas de l’absence du son dans toutes celles qui l’ont précédée, mais de son retrait. Et c’est bien de silence qu’il faut parler ici. Quelles forces anciennes Charles Lane entendait-il capter, quelles étaient les qualités du silence dont s’entouraient les films, jusqu’à ce qu’avec l’avènement du parlant, nous les nommions « muets » ? Ou, plus précisément, revenons à la question ouverte par Stanley Cavell : « A quoi a-t-on renoncé en renonçant au silence du cinéma ? »
Haut bas fragile
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Stéphane Goudet
Hiérarchie
 « On tait souvent la vérité, ainsi : que si l’on excepte Eisenstein, Boris Barnet doit être tenu pour le meilleur cinéaste soviétique » écrivait en février 1953 Jacques Rivette dans LesCahiers du cinéma (n° 20). De semblables éloges se trouvent sous la plume de Jean-Luc Godard en 1959 ou des historiens Georges Sadoul, Barthélémy Amengual, Bernard Eisenschitz, Noël Burch ou François Albéra, sans compter les tentatives de réhabilitation suscitées entre autres par les rétrospectives plus ou moins amples organisées en 1980 à Londres, en 1982 à La Rochelle, en 1985 à Locarno ou en 2000 à Moscou et 2002 à la Cinémathèque française à Paris. On peut même exprimer au sujet de Barnet une intime conviction : si le réalisateur (âgé de vingt-cinq ans !) de La Jeune Fille au carton à chapeau était mort à trente-quatre ans, soit juste après avoir achevé, en 1936, Au bord de la mer bleue, il serait unanimement salué, aux côtés de Jean Vigo par exemple, comme l’un des plus grands metteurs en scène de toute l’histoire du septième art, ayant réalisé deux autres chefs-d’œuvre au moins pendant cette période, La Maison de la rue Troubnaïaen (1928) et Okraïnaen (1933).
« On tait souvent la vérité, ainsi : que si l’on excepte Eisenstein, Boris Barnet doit être tenu pour le meilleur cinéaste soviétique » écrivait en février 1953 Jacques Rivette dans LesCahiers du cinéma (n° 20). De semblables éloges se trouvent sous la plume de Jean-Luc Godard en 1959 ou des historiens Georges Sadoul, Barthélémy Amengual, Bernard Eisenschitz, Noël Burch ou François Albéra, sans compter les tentatives de réhabilitation suscitées entre autres par les rétrospectives plus ou moins amples organisées en 1980 à Londres, en 1982 à La Rochelle, en 1985 à Locarno ou en 2000 à Moscou et 2002 à la Cinémathèque française à Paris. On peut même exprimer au sujet de Barnet une intime conviction : si le réalisateur (âgé de vingt-cinq ans !) de La Jeune Fille au carton à chapeau était mort à trente-quatre ans, soit juste après avoir achevé, en 1936, Au bord de la mer bleue, il serait unanimement salué, aux côtés de Jean Vigo par exemple, comme l’un des plus grands metteurs en scène de toute l’histoire du septième art, ayant réalisé deux autres chefs-d’œuvre au moins pendant cette période, La Maison de la rue Troubnaïaen (1928) et Okraïnaen (1933).
Comment expliquer alors que le nom (d’origine irlandaise) de Barnet demeure à ce point méconnu hors du cercle des plus exigeants cinéphiles, alors que ses films sont tout sauf élitistes? Une hypothèse s’impose : peut-être est-ce le destin de ses œuvres de rester dans l’ombre de l’histoire, comme un collier délié caché dans la mer bleue ? Tout plongeur qui l’aperçoit s’en croit le découvreur, reforme le collier et s’empresse de le remonter à la surface pour le faire admirer. Mais son collier, fatalement, se dénoue et les perles en chemin se dispersent à nouveau. Elles retournent à l’oubli, dont viendra les tirer un tout nouveau pêcheur, guère plus adroit que son prédécesseur. Tout se passe donc comme si l’œuvre de Boris Barnet avait vocation à rester dans l’obscurité (presque secrète) pour conserver intact son pouvoir de fascination, d’éblouissement. Comme si, en un sens, il fallait éviter à tout prix de reconnaître Barnet parmi les grands, pour que les spectateurs, adultes et enfants, loin d’obéir à la moindre injonction ou prescription socio-culturelle, rencontrent ses films quasiment par hasard et ressentent, en toute subjectivité, son génie comme une évidence, son oubli commeune injustice. Or l’œuvre de Barnet contribue évidemment à créer cette mythologie : le regard vierge des spectateurs s’accorde à l’ingénuité des personnages, révélés à eux-mêmes par une rencontre inattendue, ainsi qu’à l’œil du cinéaste, qui a su, comme personne et sans cynisme aucun, célébrer le charme et l’inventivité des amours naissantes.
Sympathie, empathie, décentrement
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
La démarche d’Emmanuel Gras se pose en antithèse du mouvement général du cinéma dans sa relation aux animaux. Si on la compare aux vues Lumière, il ne s’agit en rien d’objectiver les bêtes en les saisissant au sein d’une réalité factice (Cascade et Rentrée à l’étable), pas plus que de les disposer ou de les contraindre en (re)plaçant à l’intérieur d’un cadre (La Petite Fille et son Chat). Cela peut passer inaperçu mais le titre est un néologisme : on parle de « races bovines » ou de « bovins ». « Bovines » permet de ne pas réduire l’animal à sa fonction (comme « bétail » ou « vaches » l’auraient signifié). Le dessein n’est pas par ce biais de personnifier – ce serait la démarche anthropomorphique classique –, mais de requalifier une espèce pour bien signaler qu’il s’agit de la filmer en dehors des canons habituels de la représentation animale.
Le projet d’Emmanuel Gras est donc d’envisager les vaches pour elles-mêmes, dans leur existence et dans leur environnement propres, en dehors du domaine des humains. C’est le cinéma qui se dépayse pour aller à la rencontre des vaches, sur leur territoire, et non le contraire. En adaptant l’adage « l’œuf ou la poule ? » en « le film ou les bovines ? », la réponse est cette fois limpide : les « bovines ». Les protagonistes du film peuvent à loisir stationner longuement dans le cadre (et le montage l’accepter en étirant les durées pour entrer dans la temporalité des vaches), elles ont le droit de désinstaller les plans au fil de leurs mouvements et déambulations et même d’en sortir si bon leur semble. Si Emmanuel Gras veut suivre, il doit installer un nouveau cadre, ou bien user de panoramiques. Il accepte ainsi de se faire précéder par ce qu’il filme ; il ne dispose pas, il compose, s’adapte : ce sont les vaches qui commandent la mise en scène. Et dans ce fait de « suivre », on peut se demander aussi s’il n’y a pas « comprendre », comme on peut dire « je te suis » pour « je suis ton cheminement », c’est-à-dire « je te comprends ».
Le don de soi : Gepetto et Pinocchio
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Hervé Joubert-Laurencin
 Gepetto est incontestablement le personnage du sacrifice. Il incarne à la fois le héros de l’humilité et le martyr de la paternité, à la limite de la caricature. La beauté de son caractère réside dans sa traduction concrète : vendre sa casaque, ne garder pour soi que les restes de la poire, puis la céder à son affamé de fils, jusqu’à ses épluchures, se jeter littéralement à l’eau, puis dans la gueule du monstre. Pinocchio, quant à lui, apparaît d’abord comme une inversion de son père : un égoïste et un voleur qui prend ce qui ne lui est pas dû. Pourtant, très vite il est plutôt amené à perdre ce qui lui a été donné, et cela presque toujours parce que, cette fois en bon fils de son père, il a voulu, pour le bien, « donner tout ce qu’il avait » […] Enfin, il n’hésite pas à aliéner sa liberté, récemment découverte, en allant à l’école, dans l’espoir de retrouver son père, et se jette à l’eau, comme l’avait fait celui-ci, sans hésitation. Le père et le fils partagent donc la particularité de ne rien posséder et de donner beaucoup. Ce qui les rassemble est donc l’amour, dont une des définitions célèbres est, justement, de donner ce qu’on n’a pas.
Gepetto est incontestablement le personnage du sacrifice. Il incarne à la fois le héros de l’humilité et le martyr de la paternité, à la limite de la caricature. La beauté de son caractère réside dans sa traduction concrète : vendre sa casaque, ne garder pour soi que les restes de la poire, puis la céder à son affamé de fils, jusqu’à ses épluchures, se jeter littéralement à l’eau, puis dans la gueule du monstre. Pinocchio, quant à lui, apparaît d’abord comme une inversion de son père : un égoïste et un voleur qui prend ce qui ne lui est pas dû. Pourtant, très vite il est plutôt amené à perdre ce qui lui a été donné, et cela presque toujours parce que, cette fois en bon fils de son père, il a voulu, pour le bien, « donner tout ce qu’il avait » […] Enfin, il n’hésite pas à aliéner sa liberté, récemment découverte, en allant à l’école, dans l’espoir de retrouver son père, et se jette à l’eau, comme l’avait fait celui-ci, sans hésitation. Le père et le fils partagent donc la particularité de ne rien posséder et de donner beaucoup. Ce qui les rassemble est donc l’amour, dont une des définitions célèbres est, justement, de donner ce qu’on n’a pas.
Les Aventures du Prince Ahmed
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Hervé Joubert-Laurencin

Venez, garçons, venez fillettes,
Voir Momus à la silhouette.
Oui, chez Séraphin venez voir
La belle humeur en habit noir.
Tandis que ma salle est bien sombre,
Et que mon acteur n’est que l’ombre,
Puisse Messieurs votre gaîté
Devenir la réalité.
Première affiche du théâtre d’ombres de Séraphin (Versailles, 1722)
Rarement le début d’un film a une telle importance. Après cinq rapides cartons richement décorés dans un style orientaliste, teinté d’un très beau jaune paille, une nuance discrète qui retient encore un instant la puissance sourde de la couleur, un long prologue (séquences 2 et 3) présente une lutte entre l’inorganique abstrait : des formes mouvantes colorées qui apparaissent et disparaissent dans un mouvement permanent et souverain incompréhensible, et le figuratif géométrique : la danse de pantin savamment articulé du mage et, avant cela, l’habituelle présentation des personnages du conte, l’un après l’autre, comme il était de coutume de le faire dans la plupart des films muets des années 1920, avec leur portrait presque immobile et leur nom écrit. Ici pourtant le nom n’est pas accompagné de celui de l’acteur qui l’incarne. Et pour cause, il s’agit d’un film d’animation muet. L’élément décoratif habituel de l’intertitre avec la mention écrite du ou des noms ne succède pas à l’image du personnage filmé ni ne la précède au montage comme dans un muet classique, mais ils est présent avec lui dans le même plan, renforçant le caractère géométrique, informatif, narratif et net des figures, elles-mêmes simplifiées comme des pictogrammes, hypersignifiantes à l’instant qu’on les voit, très noires, très découpées. Et pour cause, il s’agit d’un film de silhouettes.
Cette lutte entre l’abstrait et le figuratif, l’inorganique flou et le géométrique coupant, ainsi que sa résolution : la naissance d’un récit rendu possible par la création d’un cheval volant, c’est aussi celle du génial compromis entre l’esprit de l’avant-garde allemande des années 1920, sensible en arrière-plan grâce à la présence, dans l’atelier de Postdam pendant trois années productives, des immenses Walther Ruttmann et Berthold Bartosch, et le travail aux ciseaux pointus, artisanal, narratif et ordonné, de la petite femme, non moins importante dans l’histoire mondiale du cinéma mais pas au chapitre des avant-gardes, Lotte Reiniger, tombée dans cette potion magique de la mouvance artistique et politique de la République de Weimar dès l’âge de 15 ans. La femme pourtant, pour une fois, dirige les opérations et signe le film tandis que les grands hommes exécutent.
C’est elle que le banquier Louis Hagen est venu chercher pour lui proposer de transformer son art original du découpage de silhouettes noires, qui lui a déjà ouvert toutes les portes, en une vraie affaire économique, un long métrage montrable et vendable qui serait aussi une œuvre d’art, c’est le cas de le dire, ciselée. C’est pour elle et son projet qu’il l’installe avec les collaborateurs qu’elle choisit, dans un studio spécialement aménagé au-dessus du garage de sa résidence de Postdam, installée au bord d’un lac, afin qu’elle ne dépende plus de l’Institut pour la recherche culturelle de Berlin au sein duquel elle travaillait avec eux après avoir suivi les cours de l’école dramatique liée au théâtre de Max Reinhardt et être entrée par la petite porte dans le cinéma grâce à Paul Wegener. C’est elle qui choisit le conte des Mille et Une Nuits qui lui plaît pour lancer l’histoire, et le modifie à sa convenance en lui en adjoignant quelques parties d’autres histoires et tous les détails ou les noms de personnages qui lui conviennent, pris ici ou là dans la profusion des contes issus de la tradition des Nuits (voir « Promenades pédagogiques »). C’est ainsi, à la fois par sa prééminence et par son retrait, que la femme-auteur prend la place de Shéhérazade.
Les Contes de la mère Poule
Le Tissage du féminin
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Joubert-Laurencin Hervé

« Les femmes et les jeunes filles travaillent à l’aiguille, brodent la soie et l’or. Elles reproduisent une grande variété de couleurs et de motifs, des oiseaux, des animaux ainsi que beaucoup d’autres ornements exécutés avec beaucoup de goût. Ces broderies servent de rideaux, de couvre-lits ou de coussins dans les familles riches. Ces ouvrages, confectionnés avec tant degoût et d’habileté ne peuvent que susciter notre admiration. »
Marco Polo (1270), Le Livre des Merveilles
Devant une séance de cinéma dont on a constaté, par l’expérience, qu’elle convient pleinement aux petits « de maternelle », et à laquelle on a pris un plaisir extrême en tant qu’adulte, on se demande d’abord ce qui bâtit son unité. Constituée de trois films courts sans aucune parole ni aucun corps photographié à quoi se raccrocher par identification banale, et même totalement dépourvue de représentation humaine, on se demande ensuite d’où vient ce sentiment de fusion spectatorielle qu’elle engendre. L’absence de tout appel aux réflexes standardisés du commerce dominant contemporain de l’animation « pour enfants » (chanson-rengaines, héros identificatoires codés et dessin animé sur cellulos) n’y est certainement pas pour rien : paradoxalement, l’exotisme de la culture orientale tempéré par l’usagede modèles fabuleux partagés avec l’Occident et la diversité technique des trois œuvres les rassemblent avec force dans un ailleurs de la représentation dominante que les tout petits acceptent sans effort. Cette originalité radicale n’explique pas tout, mais elle indique cependant une qualité spécifique : le « cinéma d’animation » lui-même, lorsqu’il s’est imposé en son nom propre, sous ce vocable et non plus sous les titres partiels et restrictifs de « films à trucs », « dessin animé » ou « filmspour enfants », c’est-à-dire seulement vers le milieu des années1950, s’est fait connaître par la diversité artisanale de ses techniques et par son opposition, théorique et provisoire mais au fond idéologique, avec la forme dominante du « cartoon » ( le dessin animé traditionnel, « sur cellulos »). La fameuse exclamation de Montesquieu : « Comment peut-on être Persan ? », qui résume définitivement, dans la culture française, la curiosité pour le nouveau et l’exotique, décrit aussi parfaitement le moment inaugural de la modernité, méconnue en tant que telle, du cinéma d’animation. Le film d’animation « persan », hétéroclite en trois parties que constitue l’ensemble baptisé Les Contes de la mère poule rejoue ainsi, par sa simplicité artisanale et son hétérogénéité mêmes, la naissance de son art (qui est ausside toutes les manières imaginables, l’art de la naissance – mais n’anticipons pas.) Voilà ce qui rend importante la question de l’unité profonde du rassemblement des trois films du programme. Ceux-ci peuvent être rapprochés selon au moins trois grandes modalités : l’Iran, le Tissu et la Mère (ou : le Féminin)…
La Croisière du Navigator
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Joubert-Laurencin Hervé

L’enfant est innocence et oubli, un nouveau commencement et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, un « oui » sacré.
F. Nietszche
Tandis que Le Mécano de laGeneral (1926) est, de tous les films de Keaton, celui qui a coûté le plus d’argent, le Navigator (1924) est celui qui en a rapporté le plus. Peut-être est-ce pour cette raison qu’il apparaît a priori comme une fantaisie en décors contemporains (A Metro-Goldwin Attraction précise le bas du premier carton de titre) plus « gratuit » que la reconstitution historique minutieuse d’un épisode de la guerre de Sécession qui le suit de seulement deux ans. Les tribulations sans suite, et sans conclusion, de deux privilégiés boudeurs qui ne parviennent même pas à se fiancer apparaissent tout d’abord comme prétexte à l’exhibition ludique d’un beau joujou : un vieux paquebot promis à la ferraille et sauvé provisoirement pour les besoins d’un film burlesque, dont les péripéties, classiques dans le genre (poursuites, chutes, mimiques, personnages secondaires de méchants typés) ressemblent plus à une suite de gags de courts métrages qu’à la grande construction historique d’un Mécano de la General ou théorique d’un Cameraman (1928). Mais existe-t-il des œuvres d’art plus gratuites que d’autres ? Quel est le sens historique d’une œuvre qui se place délibérément hors de l’histoire ? Comment fonctionne une mécanique burlesque parfaite, « célibataire » comme les machines du même nom du mouvement dada, autosuffisante, « abstraite » ? Et pourquoi l’inutile et la fantaisie devraient-ils être déclarés plus « gratuits » que les films historiques dûment thématisés ? En somme, et pour commencer, pourquoi le Navigator serait-il moins historique que le Cuirassé Potemkine, mis à l’eau un an après lui par S.M. Eisenstein de l’autre côté du monde, en Union soviétique ?
L’anti-Potemkine
Le Potemkine, œuvre expérimentale d’un jeune artiste alors peu connu qui révolutionne l’esthétique du montage, est issu d’une commande : la commémoration anniversaire de la révolution de 1905. Il est censé relater un fait historiquement avéré: la révolte de marins du tsar qui protestent contre leur mauvaise nourriture (sérieuse question que celle de l’alimentation quand on part en mer, comme l’apprennent à leurs dépens les deux millionnaires américains du Navigator). Cette première révolution est comme la répétition générale de cellede 1917, qui a vu un mouvement communiste s’emparer d’un pays. Cet événement historique sans précédent provoque, notamment aux États-Unis où l’on craint de voir s’internationaliser la révolution, au début des années 1920, des flambées de violence et de répression « anti-Rouge » visant à interdire tous les partis communistes ou assimilés (première Red Scare: 1917-1920). Keaton évoque au passage ces convulsions historiques, dans ses Mémoires, parmi les misères d’une époque dure. Quant au bateau réel rebaptisé Navigator, le Buford, il a servi de prison de déportation, d’« arche soviétique », dans un épisode extrême de cette paranoïa d’état anticommuniste à la fin de l’année 1919 (cf. Autour du film).
Edward aux mains d’argent
Ed, pupille d’Hollywood
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Joubert-Laurencin Hervé

Une parabole
Le personnage d’Edward, précis dans sa bizarrerie, ainsi que son aventure, aux couleurs si claires, aux limites si bien taillées, appellent explicitement une lecture de notre part. En tant que spectateur ordinaire de Tim Burton – et non en tant que spécialiste ou pédagogue –, nous sommes invités à procéder au déchiffrement d’une parabole. Comme pour toute parabole, l’interprétation est multiple, mais chacune des réponses possibles tourne autour d’un thème commun bien identifié. Le mot qui vient au-devant de nous est bien entendu celui d’exclusion. Un couple thématique, presque aussi évident, nous est offert par un entretien de Tim Burton : celui de création-destruction. « L’idée m’est venue d’un dessin réalisé il y a très longtemps. C’était juste une image que j’aimais bien. Elle m’est venue inconsciemment et était liée à un personnage qui veut toucher et ne le peut pas, qui est créateur autant que destructeur, ces contradictions peuvent générer une espèce d’ambivalence. […] Cette image se manifesta d’elle-même, et apparut probablement pendant mon adolescence, car c’est une chose vraiment adolescente […] L’idée avait à voir avec l’image et la perception.» Infirme, voire malade du Sida, artiste romantique ou adolescent, auteur sincère perdu à Hollywood : Edward est peut-être tout cela, et aussi, tout simplement, un réalisateur de films. De fait, cette étrange idée d’un homme de l’ombre, pâle, aux yeux avides et aux mains-ciseaux, née d’un dessin d’enfance, n’est peut-être qu’un portrait de l’artiste en cinéaste : les ciseaux du monteur sculptent à même le réel, comme ceux d’Edward les haies, puis les chevelures ; ils transfigurent plutôt qu’ils ne créent ou représentent ; enfin, avec les grandes sculptures de glace, c’est l’opération elle-même qui crée la poésie de la vie en agissant sur le climat : une neige de cinéma réinvente le Noël chuchoté en secret par les enfants et les vieillards. Il fallait bien qu’un cinéaste, d’abord dessinateur, imaginât un jour les mains inutiles, les mains négatives et hors-cadre du premier artiste à s’être coupé les mains (à ne plus avoir besoin, dans l’acte de sa création, du contact manuel avec lamatière) : lui-même.
Aura et cinéma
Tous les films de Tim Burton entretiennent un étrange rapport avec la fascination et le dégoût qu’ont pu inspirer le cinéma et la micro sociologie populaire qu’il entraîne avec lui (en l’occurence, nous pouvons à bon droit appeller l’addition des deux : « Hollywood »). Un rapport en effet « ambivalent ». Burton n’a peut-être qu’un seul sujet : l’aura du cinéma, qu’il prend tout entière, c’est-à-dire avec son ambiguïté…
L’Homme qui rétrécit
L’âme qui s’agrandit
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Joubert-Laurencin Hervé
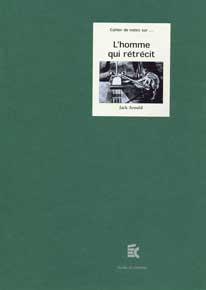
On a coutume de tenir L’homme qui rétrécit pour un petit film, et Jack Arnold pour un petit maître. Ce n’est pas un mince compliment de la postérité que le propos même du film ait pu ainsi rejaillir sur sa perception critique. Je ne voudrais pas renverser totalement cette optique, car ce film doit probablement sa réussite à une parfaite proportion entre ses ambitions et les moyens de sa réalisation, qui sont ceux d’un film de la « série B » d’une grande compagnie (une Major : la Universal). Néanmoins, il apparaît nécessaire, pour jouir pleinement de ce très beau film, de considérer non pas sa petitesse, mais sa grandeur, non plus son humour noir ou, pire, son comique involontaire, mais sa réussite dramatique. Il lui sied mieux d’être pris au pied de la lettre que d’être apprécié nostalgiquement au « second degré ». La vraie découverte, en ce sens, est la fin du film. À première vue un finale discret, expédié pour boucler comme l’on peut, avec un peu de bavardage, une action qui doit s’arrêter, par convention, aux environs d’une heure vingt, et qui a décidé de ne pas impliquer de nouveaux décors, à une échelle microscopique cette fois-ci. En réalité une ouverture véritablement métaphysique, spirituelle, et pour cela profondément paradoxale pour un film et un protagoniste aussi englués dans le concret du matérialisme. Je vais donc essayer de montrer en quoi L’homme qui rétrécit, c’est surtout l’âme qui s’agrandit.
L’acharnement à exister
L’attrait principal du personnage de L’homme qui rétrécit, qui justifie qu’on puisse s’identifier à lui, malgré sa banalité et son absence de relief psychologique, c’est bien sûr son rôle de victime, mais, avant toute chose peut-être, sa vitalité, sa volonté de vivre et de résister. C’est là le lien le plus évident avec le roman originel, écrit par Richard Matheson, et dont il a lui-même tiré le scénario et les dialogues du film, très fidèlement sauf en ce qui concerne l’ultime interprétation. En italien, l’adaptation cinématographique d’une œuvre littéraire s’appelle une « réduction » (riduzione cinematografica), et c’est bien souvent ainsi que les écrivains considèrent ce travail ingrat et paradoxal. Le film contrebalance cet inévitable rétrécissement par deux procédés.
Premièrement, celui de la voix off qui raconte au passé l’histoire que nous voyons se dérouler à grands traits sous nos yeux. Ce commentaire en surplomb leste d’un poids dramatique les épisodes trop rapides d’une évolution physiologique en principe assez lente pour rester invisible à l’œil nu. La voix double le corps et conteste ses brusques écarts de taille. La voix présente de Robert Scott Carey diminue acoustiquement, de façon réaliste, au fur et à mesure que son corps rétrécit (sa femme doit tendre l’oreille à la séquence 18, la dernière fois qu’il parle à haute voix et communique avec un humain, en voix in), tandis que sa voix invisible off conserve la même hauteur sonore, le même son grave et la même autorité tout au long du film.
Deuxième procédé : un ajout en fin de parcours, discret parce que tenant en quelques phrases et quelques plans, mais essentiel, et qui trahit, en quelque sorte, la morale de la fable imaginée par le roman initial (voir, pour plus de détail, « Richard Matheson, le roman originel », dans Autour du film). Dans le roman, un suspense règne sur le dernier jour, celui où Robert Scott Carey sera parvenu à zéro centimètre. Par un coup de théâtre, tout de même un peu attendu par le lecteur, le bref chapitre conclusif retrouve le héros toujours vivant, prenant conscience que « pour la nature, il n’y avait pas de zéro ». Il s’apprête donc à vivre de nouvelles aventures dans le monde microscopique, à chercher à nouveau sa subsistance et imagine qu’il trouvera peut-être même une forme de vie intelligente dans ce nouveau « pays de merveilles ».
Le Mécano de la General
Mécanique générale
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Joubert-Laurencin Hervé

À la seule lecture de la liste des interprètes, quarante secondes après le début du film (« The Cast », qui tient en une seule page), il est déjà flagrant que l’amour, l’humour et la subtile intelligence ont bousculé la hiérarchie militaire guerrière, le particulier triomphé du général. Buster Keaton, patron incontestable du film, comme il le fut une dizaine de fois au sommet de sa carrière : en même temps scénariste, réalisateur, acteur principal, producteur indépendantet chef de l’équipe qu’il a constituée, apparaît en dernier sur la liste des interprètes. C’est que dans la machine burlesque admirable qu’il a réussi à constituer en quelques années, tout est combustion : tout doit passer dans le fourneau du Récit Général. Buster Keaton n’est rien : Johnnie Gray est tout. Annabelle Lee, sa femme idéale, tient le haut de la liste. Or Johnnie, l’un des avatars de l’éternel personnage keatonien, est un peu le dernier des hommes, pauvre type innocent toujours prêt à se faire botter l’arrière-train (c’est la position initiale qu’il offre aux passagers descendant à Marietta autout début du récit, avant de leur envoyer un salut de music-hall, qui s’adresse aussi à nous) ; assez galant, par ailleurs, pour s’effacer devant une dame, et lui laisser la tête du convoi ou la première place sur la liste de recrutement, que constitue aussi bien un générique (la composition du train est inversée, mais provisoire, sur les trottoirs de la petite ville, lors de l’arrivée du prétendant chez sa belle : deux enfants font les wagons derrière lui, et l’espiègle Annabelle prend le train en marche, avant d’ouvrir sa porte et de reprendre ainsi la tête des opérations) ; assez acharné et obsédé aussi, assez athlète de l’âme et du corps pour remonter un à un tous les wagons du film et triompher totalement à l’arrivée. Si, comiquement, les lettres blanches du générique et des intertitres se détachent sur un fond qui représente une écorce d’arbre, c’est parce que – il convient de le répéter – tout doit servir à la combustion du film, autrement dit tout doit, justement, être répété, repris à l’envers, brossé à rebrousse-poil, ramené en marche arrière, jusqu’à ce que les plus innocents prennent les commandes et redeviennent ce qu’ils ont toujours été : des conducteurs, des locomotives pour l’histoire, des enfants qui jouent : les mécaniciens des opérations générales. Comment accéder à l’Union (matrimoniale) en restant dans la Confédération ? Comment être, comme tout le monde, uniforme, général, dans la ligne, dans les rails, tout en étant, comme personne, travesti, particulier, rallongé, recourbé, après avoir si souvent déraillé ? Voilà ce que va chercher à démontrer The General.
Général Annabelle Lee
On a rarement, au cinéma, imaginé un titre aussi évocateur que The General, pourtant trouvé tout prêt dans la réalité historique (voir Autour du film) et on a rarement aussi bien épuisé ses possibilités dans un film. Le titre français, pour une fois, est encore plus évocateur, avec le sens théâtral de « Générale » qui n’est pas avéré en anglais, et ce mot de « mécano », issu du jargon ferroviaire, qui désignait autrefois le conducteur d’une machine à vapeur en opposition au « chauffeur » qui enfourne les bûches, mais vocable qui résonne aussi, dans nos imaginaires d’enfance, comme le nom d’un des plus célèbres jouets de l’histoire occidentale. Or, le réalisme du chef-d’œuvre de Keaton est d’autant plus fascinant que nous percevons dans le film le sentiment du jeu, que nous y sentons la main du grand enfant qui joue, justement pas avec les modèles réduits conventionels du cinéma qui permettent de truquer les scènes de grands bateaux ou de locomotives, mais avec de vraies machines. Quant au mystérieux « mécano » de cette mystérieuse « Générale », c’est aussi, pour nous Français, Buster Keaton qui, en coulisses, lève le rideau sur l’ultime Répétition publique, à laquelle, par chance, nous aurions été invités avec les familiers du spectacle et les amateurs privilégiés du théâtre.
Mon Voisin Totoro
Sur un air d’ocarina ou L’extraordinaire dans l’ordinaire
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Joubert-Laurencin Hervé

Mon Voisin Totoro est, à première vue, un film de bon voisinage. Gentil, familial, écologique, chantant la maison aux panneaux de bois et au bain japonais traditionnel entretenu par un four à bois et l’eau de la pompe, un livre d’images aux musiques entraînantes et aux couleurs chatoyantes. Dès les premières secondes du générique, même les lettres du titre sont au garde-à-vous, et la petite héroïne défile au pas de l’oie sur un air de cornemuse. On dirait un film scout. Toujours prêt à faire le bien. On pourrait donc s’attendre à une vision conformiste de la famille et de la société. Mais ce n’est qu’une impression fausse. Produit et distribué en même temps que Le Tombeau des lucioles d’Isao Takahata, dont il est véritablement le film-frère à bien des égards, et dont il partage l’ancrage historique, Mon voisin Totoro est, semble-t-il, l’image inversée de cette œuvre mélodramatique et traumatisante : la mère des deux fillettes de Miyazaki n’est que malade, et non brûlée vive par une bombe incendiaire puis incinérée sur un bûcher collectif sous les yeux de son fils ; la guerre est finie dès le début du film ; les deux orphelines de mère ne le sont que provisoirement et métaphoriquement, et leur père n’est pas mort à la guerre ; paysage et maison sont grands ouverts sur le bonheur et non refermés sur le deuil dans de successives petites boîtes, comme des lucioles dans une tombe de terre. On devrait donc échapper, avec Mon voisin Totoro, à cette obsession mortuaire spécifiquement japonaise (une absence de tabou devant l’exhibition des cadavres, des atteintes corporelles et des fantômes) qui choque parfois les parents occidentaux lorsqu’ils accompagnent leurs enfants voir Le Tombeau des lucioles. On devrait aller vers la joie et donc s’éloigner des morts. Pourtant, rien n’est moins sûr. Datant de 1988, lors des débuts du studio Ghibli, et n’ayant pas tout de suite été un succès, Mon voisin Totoro ne devrait pas pouvoir soutenir la comparaison avec le succès planétaire et l’énormité mythologique et technique du Voyage de Chihiro (un film aux effets fantastiques grandioses dépassant les deux heures de projection), réalisé en 2001 par le même Miyazaki. Pourtant les premières apparences ne doivent pas mener à des conclusions toutes faites, car si Totoro est bien l’un des plus grands dessins animés de l’histoire de cet art étrange et rare du long métrage d’animation – c’est du moins ce que je crois et ce que je vais essayer de démontrer – c’est parce qu’il est un film absolument singulier, toujours surprenant, non conforme, une enthousiasmante et vivifiante histoire de fantômes et de mort, et malgré tout cela une modeste petite musique, à l’image de l’ocarina qu’il donne épisodiquement à entendre, ce discret instrument à vent rondouillard, d’origine préhistorique et que l’on retrouve dans toutes les cultures du monde.
Papa, maman, fantômes de transition
Pour commencer par le plus simple et le plus attendu, je dirai que Totoro est à la fois maternel et paternel. Maternel : quand Mei le découvre (séquence 8), elle accède à lui, au bout d’un labyrinthe, par un trou dilaté tout exprès pour elle lors de son passage (on ne le trouve plus quand on y retourne), puis elle glisse dans un boyau, et la tanière est un immense cocon végétal très doux. Le grand corps de Totoro n’est que ventre : on y rebondit et on s’y accroche pour voler : Mei s’y endort. Lorsque Satsuki la retrouve à même la terre-mère, on peut penser qu’elle a été enfantée par le rêve, qu’elle a vécu une nouvelle naissance en accédant à une nouvelle réalité. Paternel : quand Satsuki fait à son tour la rencontre (séquence 12), c’est sous une pluie battante, or nous l’avons déjà vue partager la communion aquatique avec son père dans le bain traditionnel ; elle tend à son voisin d’arrêt de bus précisément le parapluie qu’elle destinait à son père, et Totoro prend un chat-bus comme son père un autobus normal ; le geste de rapprochement de Satsuki répète en l’inversant le don du parapluie par un garçon de son âge, Kanta, qui marque par là son premier geste d’homme intéressé par l’autre sexe (séquence 11).
Ponyo sur la falaise
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Joubert-Laurencin Hervé

Ah ! tu n’as que trop d’eau, pauvre Ophélie !
Hamlet, IV, 7
Un double événement précède et déclenche Ponyo.
Un événement très grand, naturel, dans le monde : le 26 décembre 2004, un tsunami (mot japonais formé avec « port » et « vague ») se déclenche dans l’océan indien et frappe les côtes de l’Indonésie, du Sri Lanka, du sud de l’Inde et de la Thaïlande. C’est le tsunami le plus meurtrier de l’histoire de l’humanité. Un tremblement de terre au large de Sumatra provoque des vagues géantes qui atteignent jusqu’à trente-cinq mètres de hauteur, et l’eau déferle en s’enfonçant loin et haut dans les terres. La mer a envahi la terre.
Un événement très petit en comparaison, culturel, dans le monde économique et artistique du cinéma : en février 2005, l’entreprise Ghibli, studio de production japonais de dessins animés « à visage humain », comme le héros de Ponyo qui s’oppose en cela à celui de Porco rosso, par la volonté de Hayao Miyazaki décide d’un changement de cap dans son développement technique, et donc poétique. Les films Ghibli, avec l’aide et sous la pression du progrès technique en informatique des vingt années précédentes, avait été vers toujours plus de détails dans la représentation dessinée du réel : pour rester au sommet de sa réputation et sauvegarder le désir et le plaisir de travailler, Miyazaki décide d’inverser cette croissance et de revenir au fondamentaux du cinéma d’animation (moins de somptuosité plastique, plus d’animation, tout l’effort sur le mouvement coloré rythmé) et de faire marche arrière en dessinant tout à la main et en abandonnant toute velléité de 3D (voir « Hayao Miyazaki à propos de son film » dans Autour du film). L’animation a envahi l’anime.
Double confirmation : le 29 août 2005, l’ouragan Katrina, moins meurtrier, envahit néanmoins une partie de la Louisiane très pauvre, et provoque un immense sentiment d’affolement chez les Américains, dont l’un des cauchemars est que leurs crocodiles géants, ces êtres d’allure préhistoriques, viennent se promener sous la surface de l’eau près des habitations ; début 2006, Hayao Myiazaki commence à concevoir l’histoire future de Ponyo, dont l’esquisse officielle est connue au printemps. Ponyo tournera autour de l’histoire d’un tsunami, le paysage quotidien des personnages sera, comme on l’a déjà vu dans certains de ses films, inondé, les Japonais grands et petits de ce récit sauront faire face à la catastrophe, sans résignation et avec beaucoup de calme, plus habitués que d’autres peuples à dialoguer avec une nature brutale. Les Occidentaux apprennent ou redécouvrent donc en 2004 en même temps le nom et la réalité du tsunami, tandis que les Japonais connaissent bien sa réalité et savent le nommer et le comprendre depuis toujours : les tsunamis ayant touché leur pays remontent à 1605, 1611, 1703, 1707, 1766, 1792, 1896, 1923, 1933, et, parmi ceux qu’a pu connaître Miyazaki, 1946 (il avait cinq ans comme les deux personnages de Ponyo…) et 1966. Ponyo rappelle cette vie des Japonais avec la catastrophe naturelle et en quelque manière les prépare à l’énorme cataclysme du 11 mars 2011, moins de trois ans après la sortie du film, qui voit une partie du Japon ravagé par un nouveau tsunami et la planète un moment menacée par ses centrales nucléaires inondées. En conclusion, parler seulement d’idéologie (de militantisme, de souci, de message) écologiste à propos de l’œuvre, au fond très importante pour notre époque, de Miyazaki, est paresseux : il s’agit bien plutôt de philosophie. N’étant pas néanmoins philosophe de profession, le cinéaste pense et répond aux sollicitations du monde qui l’entoure en termes d’esthétique du cinéma : de dessin, de style, de rythme.
Porco Rosso
La grande illusion ou l’ordinaire dans l’extraordinaire
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Joubert-Laurencin Hervé

Porco Rosso est la création d’un monde utopique, de fable, de graphisme et de mouvement, déguisé en film d’aventures classique, photographique, au réalisme comportemental à l’hollywoodienne. Il exprime les exactes tensions qu’on trouve à l’œuvre dans tous les projets colossaux que sont les dessins animés de long métrage. Tandis que les courts métrages sont, dans le champ de l’animation, la part libérée des contraintes, le lieu privilégié de l’invention et de l’art (en dehors du phénomène commercial des séries, qui représente, quant à lui, la partie la plus prisonnière), les longs métrages sont des entreprises risquées et pleines d’entraves, surtout d’entraves à la liberté créatrice. De ce point de vue, Porco Rosso s’en tire avec un relatif bonheur, et cela est probablement dû au fonctionnement du studio Ghibli, et, en général, à la carrière indépendante qu’a menée Hayao Miyazaki à l’intérieur de l’industrie moderne du dessin animé japonais. Il apparaît que la conscience claire des contraintes liées au métrage a contribué à façonner le film, ce que l’on peut appeler, en première analyse, son scénario. En ce sens, Porco Rosso est l’histoire d’un pilote affublé d’une tête de porc, conçue à l’intérieur d’une entreprise à visage humain. Au-delà et en deçà du scénario et des contraintes de fabrication, nous allons nous intéresser à la manière dont ce film invente, et construit sur ses bases une mythologie, à la fois originale et « gratuite » dans son invention, comme toutes les vraies mythologies, en même temps que dépendante de la forme qu’elle s’est choisie ou qui l’a choisie : le dessin et l’animation.
In illo tempore
« En ce temps-là… » : ainsi commencent les contes. Ainsi s’insinue Porco Rosso dans notre mémoire. Car c’est d’un film sur la nostalgie qu’il s’agit. Celle-ci est portée explicitement par le personnage de Gina. D’une part parce qu’elle chante Le Temps des cerises, une chanson que l’on peut tenir pour l’élégie du romantisme révolutionnaire, dans laquelle se mêlent les regrets des amours passées et ceux de la Commune de Paris, elle-même mélange du rêve d’un communisme utopique et de la réalité d’une société historiquement réalisée, proposition contradictoire proche de l’ordre du conte, et reprise par la création de l’univers de Porco Rosso. D’autre part par ses mouvements doux, sa voix mesurée, son rôle maternel de protectrice des grands enfants, son caractère idéaliste d’amoureuse transie, et sa manière de collectionner les photos et les souvenirs de sa jeunesse. Personnage qui n’existait pas dans la première mouture de l’histoire de Porco Rosso, Gina n’est que l’alter ego, le dédoublement féminin de Marco Pagotto, ravagé lui aussi, peut-être même jusque dans son corps, par la nostalgie ou, du moins, par le souvenir, « la griffe » du passé (pour reprendre le titre français d’une œuvre de Jacques Tourneur.) Avant même la caractérisation du personnage de Gina, c’est toute l’histoire qui est, à l’origine, empreinte d’une nostalgie qu’on pourrait qualifier d’« antiquaire», attirée par le passé, comme les enfants ou les grands enfants peuvent collectionner les maquettes d’appareils attachés à un illo tempore très précis, à un autre temps et un autre lieu que celui de leur vie quotidienne. En témoigne sans ambiguïté le document essentiel que constitue la bande dessinée (le manga, doit-on dire pour être à la mode, puisqu’il s’agit d’une BD japonaise) de Hayao Miyazaki intitulée L’Ère des hydravions, parue ennovembre 1984, justement dans un magazine japonais de modélisme : Model Graphix. De fait, à l’exception d’un plan très bref de la séquence 18, il n’apparaît pas dans le film un seul appareil qui ne soit un hydravion de l’entre-deux-guerres : cela fonctionne comme une obsession constructive, une convention proprement fabulatoire, d’autant plus forte qu’elle s’insinue dans la perception du spectateur à proportion du réalisme historique et dessiné des machines. La mythologie qui se crée possède une couleur, ou plutôt une bannière tricolore – qui n’est pas exactement celle du drapeau italien, très présent, quant à lui, dans les décors: une mythologie bleu, blanc et rouge. Bleu idéal et altier pour l’addition ou la fusion de la mer et du ciel adriatiques (la Méditerranée est, du reste, le siège historique de nos mythologies antiques), blanc maternel – et peut-être couleur du neutre et de l’épuisement des contraires –, pour la Voix Lactée, les sillages blancs, l’écharpe de Porco claquant au vent et les nuages protecteurs, rouge politique et terrestre de l’avion et des cerises-gouttes de sang de la Commune, enfin.
U
Le don des langues
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Joubert-Laurencin Hervé

Qui est U ? D’où vient U ? Où va U ?
Voici les premières questions que le titre impeccable du film de Grégoire Solotareff et Serge Elissalde oblige le spectateur à se poser. Il ne s’agit pourtant pas d’un film métaphysique. Il développe au contraire un réalisme psychologique de caractères que beaucoup de films français d’acteurs devraient lui envier. Encore moins d’une œuvre mystique. La licorne, comme tous les animaux un peu plus naturels qui l’entourent (individus décomplexés d’être ce qu’ils sont, bêtes sans bêtise, aussi idiotes, c’est-à-dire aussi particulières, singulières et réelles que les hommes), n’a rien d’un être fabuleux. Elle est même presque totalement retirée de toute mythologie, elle est rationnelle et douée d’un solide sens pratique et ne se laisse réduire à aucun symbolisme attesté. Elle l’explique du reste placidement en marchant : « Je ne suis pas une fée. Les fées changent le destin, moi je l’accompagne, c’est très différent. » Aussi libre qu’un toon (un personnage de cartoon classique, comme le Goofy de Disney ou le Droopy de Tex Avery), mais sans son inclination à l’absurde, elle reste cependant l’énigme du film, donc sa possible explication, en même temps que l’asssurance de son mystère vital. L’énigme du début : D’où venons-nous ? Qu’est-ce que naître ? L’énigme de la fin : Où allons-nous ? Comment vivons-nous avec la mort ? L’énigme du milieu : Qui sommes-nous ? Comment grandissons-nous ? Que se passe-t-il quand nous passons, peu importe l’âge au fond, de puer à puber, de l’enfant à l’adulte, phase dite de l’adolescence (le verbe latin adolescere signifie tout simplement : « grandir ») ? En somme, le film U, autrement dit le filmu bien connu de la fillu qui rencontre le garçu, ne nous laisse pas le choix : comme le capitaine Haddock dans un album d’Hergé, à la recherche de son aïeul mort depuis longtemps, et du trésor caché sous son nez dans son futur château de Moulinsart (quête du destin en même temps par le passé et par l’avenir), il nous faut rechercher le secret de la licorne.
Le secret de la licorne
La première constatation, à laquelle il ne faut surtout pas rester, est qu’à première vue, il n’y aurait aucun secret. D’où vient U ? Elle le dit elle-même : elle est apparue parce qu’une petite fille pleurait, et elle sera désormais son amie pour lui éviter la solitude. Quel secret chuchote-t-elle à l’oreille de Kulka, l’adolescent qui va devenir homme en épousant sa protégée? Le pathétique album en relief tiré du film nous en donne la primeur (je cite) : « Le jour où une jeune fille tombe amoureuse, la licorne qui la protège disparaît. Elle vole au secours d’une autre petite fille qui, à son tour, a besoin d’elle. » Où va U ? Elle rétrécit comme Robert Scott Carey dans un film hollywoodien, et, comme lui, rejoint le ciel et les étoiles, tout en étant sauvée in extremis par l’amour de son lézard pendant le générique de fin. Pourtant, si l’on chausse des lunettes d’approche pour saisir les détails concrets du film, tout change : pour les pleurs, le côté bonne fée est peut-être de trop (on peut douter que l’ami qui arrive quand vous pleurez est bien le meilleur de tous : en tout cas ça se discute), et leur matérialité, cri et larmes (le cri « Uuuuuu » et le liquide lacrymal), est sans doute plus importante que l’action de pleurer ; pour la fin, le décor a son importance : on est en plein générique, c’est-à-dire au milieu des lettres dans un film dont le titre est une majuscule ; quant au secret, c’est à la fois trop malin et pas malin de lui donner ainsi un contenu, car le problème d’U, c’est d’être le secret du secret (U est une forme du symbolique, pas un symbole…) Il vaudrait mieux rester cool, comme Kulka, le chat musicien, et fermer une oreille pour mieux entendre. Quoi ? Qu’est-ce que vous dites ?
Le don des larmes
D’abord, U ne vient pas consoler les pleurs d’une petite fille sans défense, elle est littéralement engendrée par les larmes de Mona, elles-mêmes provoquées par une goutte de sang rouge, sur la table, et au bout de son doigt jaune. Des larmes et du sang: un peu de liquide humain. Elle disparaîtra avec la puberté de Mona (du sang aussi, chez les filles), et ses baisers profonds (du mélange de salive, comme le dit délicieusement la scène comique). U arrive avec la douleur (le doigt égratigné) et part avec le plaisir ; elle naît de la solitude enfantine et meurt du mariage adulte (de l’accouplement, de la vie à deux, du partage avec l’autre, de la famille fondée et non subie). Dans Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock, la fiction commence à l’instant où l’héroïne observe, dégoûtée, une goutte de sang sur son doigt ganté de gris, petit élément pervers qui fait tache dans le tableau, anomalie qui trahit la présence de la mort : c’est ce même plan qui est repris tel quel au tout début d’U.
Le Voyage de Chihiro
Ça sent l’humain ou La divine comédie humaine
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Joubert-Laurencin Hervé

Dante, avec La Divine Comédie (dont Le Voyage de Chihiro est du reste un pastiche), a décrit sous la forme d’un long poème le voyage, aller et retour, d’un humain au royaume des morts, créant ainsi, dans l’Italie médiévale, l’une des plus immenses fantasmagories de l’histoire de la culture. Balzac, dans le Paris du XIXe siècle, a décidé d’appeler son œuvre romanesque fleuve La Comédie Humaine. Hayao Miyazaki a dessiné, dans le Japon du XXIe siècle, une œuvre d’une semblable ambition, et d’une semblable modestie dans la description, pas à pas, des comportements humains, au croisement des deux premières : une Divine Comédie humaine, qui ne pouvait être qu’un Dessin animé de long métrage, puisque l’histoire la plus simple de l’être humain y est contée à travers tantôt ce qui le tire vers l’animalité et tantôt ce qui le dépasse, deux conditions figurables mais sans référents dans le réel.
De Porco à Chihiro : des cochons aux dieux
Dire d’un personnage dégoûtant qu’il est un porc est une chose ; cela peut être une métaphore. Le montrer animalisé par une peinture à la Jérôme Bosch ou à travers un film par un effet de montage ou un trucage, plus ou moins « invisible » (traditionnel ou numérique), en est une autre. Cela peut devenir une métamorphose fantastique. Dessiner les mouvements d’un porc habillé en humain est tout différent, car un dessin animé d’un assez long métrage crée un monde de substitution au-delà du désir humain. Métaphore et métamorphose ne sont plus que des prétextes de départ à la formation d’un univers cohérent, dans lequel le spectateur accepte ou pas d’entrer, mais où, une fois entré, un porc équivaut à un radis blanc ambulant, une grenouille parlante à des limaces femmes de chambre, des batraciens contremaîtres à des dragons blancs, des dieux poussins à des hommes-têtes ou des fantômes noirs, une lanterne piétonne à un bébé géant et une petite fille à des boules de suie sautillantes (cet inventaire pour tenter de dresser une première liste des êtres apparaissant dans Chihiro, à l’exception des deux figures de la maîtrise de l’univers : Yubaba la sorcière, équivalant au producteur du film et Kamaji aux bras ballants, représentant l’animateur au travail, c’est-à-dire Miyazaki lui-même). Hayao Miyazaki avait déjà admirablement exploré cette voie étrange du cinéma avec Porco Rosso (Japon, 1994), au titre explicite. Dans ce film, le protagoniste était un aviateur humain à tête de porc, mais aussi une énigme ambulante car évoluant naturellement au milieu des autres humains, tous traités de la façon la plus réaliste possible pour un dessin animé moderne. L’énigme de la tête porcine de Marco Pagotto alias Porco trouvait, dans le film, sa solution poétique – pas exactement son explication – avec un récit et des images que l’on retrouve inversées, du côté positif des forces de vie, dans Chihiro. Coupable d’avoir transformé la beauté gratuite et d’ordre quasi divin des premiers vols humains aéronautiques en une sauvage et avilissante action guerrière pendant le conflit de 1914-19185, le héros avait vu sa face porter la trace de cette faute après un mystérieux voyage en avion chez les morts, au-dessus d’une mer de nuages. Ce n’est qu’une « Grande Illusion » de croire qu’on est un héros chevaleresque quand on fait la guerre en avion : on n’est qu’un porc ; le héros a donc attrapé une tête de porc comme Pinocchio des oreilles d’âne pour s’être comporté comme un fainéant. Dans Chihiro, le motif de la mer de nuages réapparaît au point culminant de l’amour entre les deux innocents, Haku et Chihiro : séquence 14, cinq minutes avant la fin du film. Dans ce bref moment hors du temps, paradisiaque dans Chihiro mais infernal dans Porco Rosso, l’aviateur voyait, loin au-dessus de sa tête, avec stupéfaction, une immense nuée blanche, une sorte de Voie lactée qui, de plus près, se révélait constituée de milliers d’avions avec leurs pilotes morts à la guerre, en train de partir au ciel. La nuée blanche serpentine devient, dans Chihiro, le motif classique du Haku Ryu, le grand dragon blanc de la mythologie japonaise : esprit de la rivière polluée lorsqu’il repart purifié des Bains d’abord, Haku ensuite, esprit d’une rivière également victime de l’urbanisation (nous apprenons qu’elle a été recouverte). Chihiro constitue donc, par rapport à Porco Rosso, un stade supérieur dans la création d’un univers paradoxal, en même temps que le film de 2001 semble reprendre celui de 1994 à la source, en inventant une sorte de développement de sa scène primitive antérieure au récit. Chihiro, en effet, se débarrasse assez vite de la fonction parentale en faisant vivre au père et à la mère, dans l’histoire du film, l’aventure pré-filmique de Porco : la métamorphose en cochon. Seule leur fille pourra les empêcher (et éviter elle-même !) de devenir de nouveaux adultes dénaturés.
Seul(s) au monde
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
L’homme sans passé
« La vague qui revint sur moi m’ensevelit tout d’un coup dans sa propre masse, à la profondeur de vingt ou trente pieds ; je me sentais emporté avec une violence et une rapidité extrêmes (…) Je retenais mon souffle et je nageais de toutes mes forces. Mais j’étais près d’étouffer, faute de respiration, quand je me sentis remonter, et quand, à mon grand soulagement, ma tête et mes mains percèrent au-dessus de l’eau. » (Daniel Defoe, Robinson Crusoé, Livre de poche, p. 85).
La puissante singularité de l’ouverture de La Tortue rouge réside dans le parti pris de démarrer le film de façon abrupte, sans contexte. Ce sont les éléments naturels (le vent, la pluie, les vagues) que l’on entend off, avant toute image, puis que l’on distingue ensuite sur l’écran. Après seulement apparaît une silhouette, perdue dans le décor, se débattant pour entrer – et nous faire entrer – dans la fiction. Cette fiction, on l’aura vite compris, s’appuie sur le motif classique du naufrage, motif abondamment revisité en littérature et au cinéma et que le cours du monde convoque malheureusement avec une triste régularité au gré de l’actualité…
Avec cette entame, le film de Michael Dudok de Wit se distingue de bien des histoires de naufragés en refusant à son personnage une origine sociale ou un passé.
Prenons, pour mesurer cet écart singulier, deux œuvres emblématiques du genre, séparées pourtant par près de trois siècles. Dans le Robinson Crusoé originel, Daniel Defoe racontait à la première personne l’histoire de son personnage depuis sa naissance (le naufrage n’arrivant dans le livre qu’au bout d’une cinquantaine de pages), tandis que dans Seul au monde, le cinéaste Robert Zemeckis s’attachait durant trois quarts d’heure à montrer qui était son Chuck Noland au nom prédestiné. À l’inverse, le naufragé de La Tortue rouge est un concept. Il ne parle pas, ne monologue pas, ne rédige pas de journal, ne s’invente pas de compagnie. Tout au plus rêve-t-il, oui, mais toujours de fuite (le rêve du pont), jamais d’un passé qui nous est tu, jamais de proches qu’il aurait pu aimer, avant. On ne sait d’ailleurs vraiment ni où ni quand se passe l’histoire (même si quelques indices – la barque qui est faite de bois, les musiciens apparaissant en rêve – suggèrent un passé aux contours abstraits), ce qui contribue à la dimension atemporelle et universelle du film.
Le film de naufragé – réduisant par sa nature même le nombre des protagonistes – induirait-il alors une forme de minimalisme narratif dont La Tortue rouge prendrait radicalement acte à travers cette ouverture épurée ?
Si Robert Zemeckis pouvait se permettre, dans Seul au monde, de filmer sans musique et dans une relative économie d’effets les années passées sur l’île déserte par son personnage, c’est aussi parce que son film ne se limitait pas à cela, le long épisode insulaire étant encadré par une première partie trépidante (qui se terminait sur une scène de crash aérien très spectaculaire) et par une troisième partie, dite du retour, aux beaux élans mélodramatiques. Sans doute aussi parce que Tom Hanks, alors au faîte de sa gloire, était son acteur principal.
A contrario, le personnage de La Tortue rouge ne se définit par rien d’autre que sa nature de naufragé. Il ne devient un personnage – pour lequel on va s’émouvoir, éprouver de l’empathie – qu’une fois échoué sur l’île.
L’île, ici, c’est donc la fiction. L’île, ici, c’est le lieu d’un retour à zéro (au sens d’une réinitialisation). Un commencement, en somme. « Seul, il aurait tout à faire, tout à redécouvrir, partant de rien, à son seul profit » (Tu imagines Robinson, Jean-Daniel Pollet, 1968).
écrit par Xavier Kawa-Topor
Tout enfant a rêvé de prendre deux ans de vacances « sans école, sans parents, sans violon », de vivre dans la longue durée et jusqu’à un terme si lointain qu’il en devient incertain, la belle utopie estivale pendant laquelle, loin des entraves du quotidien, il peut s’adonner jusqu’à plus d’heure à la liberté d’imagination qu’offre le jeu. Qu’il ait ou non abdiqué ce rêve, tout adulte garde par devers lui la secrète conviction que l’éveil de la personnalité se joue dans les terrains vagues de l’enfance, au temps des vacances, là où l’expérience du monde suit son libre cours, où l’on en devient l’inventeur. Avant même que les lois Jules Ferry n’aient instauré en France l’école obligatoire pour tous, les vacances ont eu leurs apologues rousseauistes. L’une des positions les plus avancées en ce domaine est sans doute celle que le géographe Élisée Reclus expose dans Histoire d’un ruisseau, un texte publié en 1869 par Jules Hetzel – l’éditeur de Jules Verne – dans sa collection d’ouvrages pour la jeunesse.
« Dans nos écoles et nos lycées, écrit-il, nombre de professeurs, sans trop le savoir et même croyant bien faire, cherchent à diminuer la valeur des jeunes gens en enlevant la force et l’originalité à leur pensée, en leur donnant à tous même discipline et même médiocrité ! […] Les pédagogues se vouent à l’œuvre fatale de pétrir des têtes de fonctionnaires et de sujets, et malheureusement il leur arrive trop souvent de réussir. Mais après les dix mois de chaîne, voici les heureux jours des vacances : les enfants reprennent leur liberté ; ils revoient la campagne, les peupliers de la prairie, les grands bois, la source déjà parsemée des feuilles jaunies de l’automne ; ils boivent l‘air pur des champs, ils se font un sang nouveau et les ennuis de l’école seront impuissants à faire disparaître de leur cerveau les souvenirs de la libre nature. Que le collégien sorti de la prison, sceptique et blasé, apprenne à suivre le bord des ruisseaux, qu’il contemple les remous, qu’il écarte les feuilles ou soulève les pierres pour voir jaillir l’eau des petites sources, et bientôt il sera redevenu simple de cœur, jovial et candide. »
Un rêve d’enfant, une nostalgie d’adulte, une aspiration libertaire ? Le programme que se donnent les passagers du Dirigeable volé en se promettant « deux ans de vacances » est peut-être tout cela à la fois. S’il trouve son inspiration dans le roman éponyme de Jules Verne, il ne se démarque pas moins de l’original dans son projet comme dans son accomplissement.
Goshu le violoncelliste
Trait d’union, ou la liberté lieuse
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Ilan Nguyên

Gauche le violoncelliste est un long métrage remarquable à bien des égards dans l’histoire du dessin animé au Japon. Ses sources d’inspiration, comme le soin formel apporté à sa réalisation et la tenue de sa mise en scène musicale, le situent dans une veine singulière. Un ensemble de conditions et d’ambitions particulières contribua à faire de ce film un véritable laboratoire où s’élaborèrent nombre de choix et de motifs techniques résolument neufs, qui firent date et font désormais partie des moyens d’expression établis du dessin animé au Japon. Par-delà – si ce n’est du fait même de – tous les écarts que l’on pourra reprocher à sa forme, en matière de translation du récit originel (la nouvelle de Miyazawa), Gauche le violoncelliste constitue un tour de force et un véritable hommage à l’esprit de l’œuvre originale, par la mise en regard, la réunion fusionnelle qu’il cristallise entre ce texte et la musique de Beethoven.
Un nouveau départ
En tant que premier projet de Takahata prenant pour cadre son pays, Gauche constitue un tournant majeur dans l’œuvre de son réalisateur, et le premier maillon d’un parcours créatif au long cours poursuivi jusqu’à ce jour dans une même perspective : l’œuvre de Takahata est depuis lors tournée toute entière vers la représentation de la réalité de son pays. À l’opposé de toute conception « nationale » par principe, abstraite ou théorique, son projet, dès Gauche le violoncelliste, est de puiser dans la réalité la plus proche de lui, celle de son entourage immédiat, matériel, quotidien, et qu’il connaît naturellement de la manière la plus intime, pour y appartenir et en être acteur. Cet ancrage est aussi à l’origine de chacun de ses travaux ultérieurs.
Gauche est aussi le premier projet de mise en scène d’envergure auquel Takahata choisit de s’atteler sans (et malgré l’absence de) Miyazaki, son collaborateur le plus proche. Les années suivantes confirmeront et accentueront cette séparation, et l’affirmation d’une indépendance créative chez Miyazaki, à partir de sa première expérience à la mise en scène, la série Conan le fils du futur (1978). Ainsi, Takahata aura à explorer au cours des années suivantes de nouvelles modalités de mise en scène, de nouvelles collaborations, recherche dont Gauche marque le premier pas. Takahata n’a réalisé presque aucune œuvre originale à ce jour (Pompoko est le seul de ses longs métrages le créditant à cet égard). Son œuvre repose au premier chef sur un travail d’adaptation, partant de matériaux originels, vers la forme filmique : la quasi totalité de son travail est ainsi basée sur des sources partagées principalement entre textes littéraires et récits en bandes dessinées. Dans leur variation même au cours du temps, les modalités de ce travail de transposition constituent donc un nœud central dans l’approche du cinéma de Takahata. Sur ce chapitre, Gauche le violoncelliste est marquant à au moins trois égards : son ancrage dans le temps de la jeunesse ; l’ensemble des expérimentations techniques et formelles sur lesquelles repose le film ; enfin, la mise à l’épreuve et l’affirmation d’un projet basé tout à la fois sur une très grande fidélité à l’œuvre originale, et des prises de libertés ponctuelles, porteuses de sens.
Le Planète sauvage
Le Mystère Laloux
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Xavier Kawa-Topor

L’image de La Planète sauvage qui me touche le plus est celle de Terr, allongé sur le ventre, le visage tourné vers la caméra. Son regard pur, rêveur, son sourire énigmatique expriment une mélancolie propre à l’enfance. Dans le script de René Laloux, Terr a alors sept ans, chiffre que l’on donne symboliquement pour l’ « âge de raison », ce moment de l’enfance où le regard que l’on porte sur le monde est censé gagner une acuité nouvelle. Terr fixe la caméra comme s’il regardait derrière l’apparence des choses. Plus exactement, c’est la fixité de son expression, sur cette image arrêtée, qui perce progressivement l’invisible paroi qui le sépare de nous, spectateurs, et force notre pudeur. Troublante est aussi la posture du petit garçon dans son réalisme même : étendu sur le sol, la tête appuyée sur l’avant-bras gauche, l’épaule frôlant le menton, les doigts qui jouent distraitement les uns avec les autres… Tout est douceur dans ce portrait, calme et sérénité enfantine, tranquille abandon. Pourtant, si le sourire du personnage rayonne d’un bonheur simple, il en souligne déjà la fugacité, comme si l’instant se chargeait de sa propre nostalgie. Terr vient de jouer avec Tiwa. La scène s’offre comme une parenthèse heureuse dans l’existence du petit d’homme, après la mort tragique de sa mère et sa capture par les Draags. Pour la première fois, l’enfant sourit et visiblement s’amuse. Il n’est plus cet « animal savant », au regard triste, manipulé par une fillette au gré de ses caprices . En grandissant, Terr a lié une certaine complicité avec sa jeune maîtresse : dans le jeu, chacun se prête aux facéties de l’autre. Ainsi, Terr, poursuivi par un furieux orage, dans la chambre de Tiwa, est-il tombé à terre. Immobile, les paupières closes, il mime la mort, manifestant la victoire de sa maîtresse. Cette « mort feinte » n’est pas tant un acte de soumission qu’une ruse. En cachette de Tiwa, le garçonnet ouvre un œil, puis l’autre, pétillants d’espièglerie, et adresse son regard à la caméra, comme pour dire au spectateur: « Ce n’est qu’un jeu.» La prise à témoin se charge aussi d’une signification plus profonde. Tout, dans cette fuite sous l’orage, depuis la chute de l’enfant jusqu’à sa position finale sur le sol, rappelle les circonstances de la mort de sa mère, dans la séquence inaugurale du film. Terr semble rejouer littéralement la scène jusqu’à son issue fatidique. Alors, il ouvre les yeux. Que lire dans son regard à ce moment-là, sinon l’appel d’un orphelin ? Car Terr est orphelin. Et c’est l’un des éléments originaux du film parmi les plus significatifs. La disparition de la mère n’est pas dite dans le roman de Stefan Wul. Dans La Planète sauvage au contraire, elle ouvre non seulement le récit, mais elle accompagne la destinée du personnage. L’itinéraire de Terr est ains imarqué par trois rencontres successives : trois figures féminines auxquelles correspondent les trois âges de la vie. Tiwa, la fillette Draag, Mira, la jeune femme sauvage, et enfin la Vieille qui commande la bande du Buisson Creux. Tiwa est probablement la plus maternelle des trois. Elle joue avec Terr comme avec une poupée, lui prodiguant des soins attentionnés. Mère de substitution pour le petit orphelin, Tiwa vient à le délaisser quand elle grandit. Alors Terr s’évade. La première personne qu’il rencontre dans sa fuite est Mira, une jeune fille sauvage, un personnage qui n’existe pas non plus dans Oms en série. La rencontre a lieu à la lisière d’une forêt semblable à celle aperçue dans la première séquence. Cette circonstance, associée à la vague ressemblance physique de Mira avec la mère de Terr, pourrait suggérer que le personnage est instinctivement revenu sur les lieux de sa naissance. Tout au moins la fuite de Terr semble-t-elle inspirée par une recherche inconsciente de ses origines. L’alliance des deux personnages, signifiée dès les premières images où l’on voit Terr et Mira côte à côte, tirant en tandem le bracelet géant, annonce en substance leur union. Mais une union où l’amour n’apparaît qu’en second plan – tout juste les personnages échangeront-ils, à l’écran, un baiser tendre sur la joue. L’enjeu principal du film est ailleurs : dans « l’adoption » de Terr par le clan du Grand Arbre. Épreuves et rituels jalonnent le chemin initiatique du personnage qui entre alors dans l’âge adulte. Terr affronte en combat singulier l’un des acolytes du sorcier, il est ensuite revêtu de la tenue tribale parles « escargots-tisseurs » ; enfin, ayant pris part à la mise à mort du « vampire-tamanoir », le jeune homme est admis parmi les chasseurs à boire le sang de la bête. Mieux : il en est aspergé, de la tête aux pieds. Bientôt cependant, Terr enfreint la loi du clan et court avertir la bande rivale du Buisson creux de l’imminence du danger qui guette les humains. La Vieille qui commande le clan compose alors une troisième évocation maternelle. Sévère figure matriarcale dont l’autorité s’impose à tous, le personnage est animé d’une volonté sans faille et d’une clairvoyance manifeste. Après l’attaque des Draags, la Vieille rassemble les survivants des deux clans sous son aile et les guide vers un destin collectif : l’exode commence…
Princes et princesses
L’ombre amoureuse ou la petite fabrique des images
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Xavier Kawa-Topor

Tout commence dans une salle de cinéma abandonnée, où les bobines ont fini de tourner. Le spectacle s’est arrêté, le public a déserté. Le rideau est baissé sur l’écran blanc. La scène d’introduction de Princes et Princesses fournit d’emblée bien plus qu’un prétexte narratif à l’enchaînement des six contes : elle pose la condition d’existence du cinéma de Michel Ocelot. Un écran vierge qui semble faire écho à la pensée d’Oscar Wilde : tout ce qu’il faut savoir ignorer pour pouvoir créer ! Si cet écran est vide d’images, c’est que les lieux sont désaffectés. Dans cette ville moderne qui enferme les humains dans des appartements anonymes, où le lien social s’est distendu, la salle de cinéma a fermé ses portes. Au fronton, les lettres de la vieille enseigne s’affaissent une à une dans l’obscurité et l’indifférence. Triste tableau des années 1980 où l’individualisme gagne. Derrière la mosaïque lumineuse des appartements, on imagine la multitude des postes de télévision allumés sur des programmes différents. Et voici que dans la nuit, une jeune fille et un garçon s’évadent de leur citadelle de béton respective et se rejoignent en cachette, tels de nouveaux Roméo et Juliette. L’amour, pourtant, n’est pas en jeu, du moins pas encore. Il viendra au bout de la nuit, au terme du jeu, précisément. Pour le moment, les protagonistes se glissent à l’intérieur du cinéma et prennent place derrière leurs tables à dessin. Comme il n’y a plus de film à voir, toute liberté est donnée d’en imaginer de nouveaux. Au service de la créativité des jeunes gens, la salle de cinéma dispose d’un équipement clandestin improbable : ordinateurs, tables lumineuses, bibliothèque et bras robotisés d’un « costumatic » futuriste. Cependant, pour mettre en image les histoires qu’ils s’inventent, les héros de Michel Ocelot choisissent une forme de spectacle artisanale : le théâtre d’ombres. Vêtus de costumes de circonstance, ils se dissimulent à l’abri du rideau rouge, avant que la lumière du projecteur ne s’allume, pour interpréter eux-mêmes les héros de leur conte. Leurs propres silhouettes apparaissent sur la toile – ou plus vraisemblablement derrière – telles de vivantes ombres chinoises. Cette « régression technique » souligne, bien sûr, la portée de l’acte de nos jeunes clandestins : un acte de résistance qui réinvestit l’écran blanc, vestige d’avant l’ère télévisuelle, et lui redonne vie, une vie d’images rudimentaires, comme une évocation fantomatique de celles du passé. Mais elle dénote également un tout autre désir de retour. L’imagerie clandestine sur l’écran n’est plus une simple projection devant des spectateurs mais la composition vivante des silhouettes des jeunes gens devenus acteurs, et mus par le besoin d’incarner eux-mêmes leurs personnages, d’éprouver leurs histoires, de faire l’expérience de la fiction avec une intensité et un engagement égaux si ce n’est supérieurs à la vie même. Cette nécessité irrépressible de jouer, de jouer avec son ombre comme avec un double étrange, rappelle la pulsion tout enfantine qui consiste, dans une salle de cinéma, à tendre la main dans le faisceau lumineux du projecteur pour la voir envahir l’écran vierge. Princes et Princesses se présente donc comme un théâtre d’ombres, ou plus exactement comme le film d’un théâtre d’ombres prenant lui-même place dans un cinéma abandonné. Deux niveaux de réalité se distinguent de prime abord : la salle d’une part, et l’écran d’autre part, où se succèdent les représentations des contes, véritables fictions dans la fiction. Soit un espace en trois dimensions et l’autre réduit à un plan. Le premier se caractérise par une certaine profondeur de champ créée parles arrière-plans dessinés. Quant au second, il trouve sa singularité dans la lumière qui en émane et accentue le contre-jour. Mais ce qui rend ténue la frontière entre ces deux espaces fictionnels, c’est l’usage indifférencié des ombres de part et d’autre. Michel Ocelot aurait pu rendre flagrante la dichotomie en réservant l’usage des silhouettes découpées à l’écran de cinéma pour utiliser ailleurs un autre procédé. Mais il ne le fait pas, optant pour une solution de continuité qui a l’avantage décisif de rendre immédiate l’intégration des personnages à la réalité plane de l’écran de cinéma et insensible leur passage d’un espace à l’autre. Le doute se produit alors dans l’esprit du spectateur sur la nature même des images projetées sur l’écran : film ou théâtre d’ombres ? Le contexte joue en faveur de la première hypothèse ; mais les sièges laissés vides par le garçon et la fille, et leurs voix étouffées provenant de l’arrière-scène, prouvent le contraire.
Mandala
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Xavier Kawa-Topor
C’est un enfant qui s’assoupit sur les genoux de sa mère et qui, en fermant les yeux, met fin au récit. Sans doute est-il temps qu’il se repose, ce petit garçon aux yeux grands ouverts qui a arpenté le monde à la recherche d’un père qu’il n’a pas trouvé. La quiétude de son sommeil témoigne qu’il est cependant bien parvenu au terme de son voyage et de sa quête.
Pour le comprendre, Il faut tout d’abord revenir à l’argument de ce film à la construction scénaristique virtuose. De prime abord, l’histoire est en effet celle d’un garçon qui voit partir son père au loin, à la recherche d’un travail. Souffrant de son absence, il décide de se lancer sur ses traces et fait successivement la rencontre de deux personnages dont il partage un moment l’existence. D’abord, un vieil homme et son chien qui travaille dans les plantations de coton avant d’en être chassé. Puis un jeune homme, ouvrier dans une filature mais également musicien de rue, qui vit dans une masure des quartiers pauvres de la ville. Au terme du récit (séquence 29), le garçon rebrousse chemin pour retrouver la maison, la rivière et la forêt de son enfance avant qu’elles ne disparaissent. Les cinq séquences qui suivent dévoilent l’autre dimension du récit. Les trois personnages en réalité n’en font qu’un à différents âges de la vie. Le récit change donc de signification. La rencontre du garçon avec ses deux compagnons successifs n’est pas du registre de la réalité. Ainsi, en revenant à la séquence 6, on interprète son départ sous un jour nouveau : il s’agit d’un rêve ou d’un désir jamais réalisé. On comprend alors que le départ effectif du garçon n’a lieu qu’à la séquence 32, alors qu’il est déjà jeune homme. On pourra, dès lors, replacer les faits dans l’ordre chronologique : de la séquence 13 à la séquence 28 pour suivre la jeunesse du personnage, puis de la séquence 7 à la séquence 12 lorsqu’il est devenu âgé. Le retour du garçon chez lui – fantasmé aux séquences 19 et 30 – n’est effectif qu’à la séquence 33.
Par sa construction, le film interroge le sens de l’existence de son personnage principal. Il fait se rencontrer le regard idéalisé de l’enfance sur l’âge adulte et la réalité beaucoup plus prosaïque du vieillissement, des échecs, des renoncements. La trajectoire du personnage, en effet, peut se voir sous l’angle d’une défaite. Parti, comme son père, trouver un emploi au loin, le jeune homme mène une existence précaire, son travail devenant au fil des années de plus en plus accablant et ses conditions de vie misérables jusqu’au « naufrage » final. Les aspirations de sa jeunesse – la grande marche – ont tourné court. La séquence 33 nuance malgré tout ce constat. D’abord, parce que contrairement à son père, le garçon est revenu chez lui : il n’a donc pas disparu dans l’anonymat mais a survécu à son odyssée. Ensuite, parce que la vie a repris autour de la maison de son enfance et, avec elle, la musique est revenue, jouée par des enfants. La roue de la vie s’apprête à faire un nouveau tour et le cycle de l’existence est porteur d’avenir. La séquence le dit autrement en revenant sur la graine plantée lorsqu’il était enfant, et de laquelle un arbre a poussé.
Lire le texte intégral sur la plateforme NANOUK
Bâtir un Programme
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Yann Goupil et Stéphane Kahn.
« Un écolier
marche sur le vieux rail
imitant malhabile
le bruit du train »
Abbas Kiarostami, (Avec le vent, P.O.L, 2002)
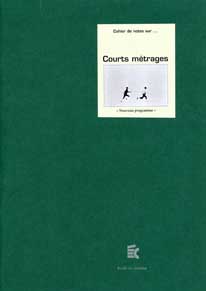 Bâtir un programme de courts métrages expose les programmateurs à un ensemble de questions liées aux films pris un par un (leur singularité et leur dynamique propres), à leur association (les passerelles, les échos, les ruptures entre les films). Toute une tresse d’approches croisant des motifs tels que la thématique, l’esthétique, la narration, le rythme, la durée, la technique…
Bâtir un programme de courts métrages expose les programmateurs à un ensemble de questions liées aux films pris un par un (leur singularité et leur dynamique propres), à leur association (les passerelles, les échos, les ruptures entre les films). Toute une tresse d’approches croisant des motifs tels que la thématique, l’esthétique, la narration, le rythme, la durée, la technique…
Par bien des aspects, l’acte de programmation est proche de l’acte artistique où il s’agit de trancher, de faire des choix (dans le meilleur des cas, programmer s’apparente au montage cinématographique). Dans l’histoire du cinéma, celui qui correspondrait à ce « portrait du programmateur en artiste » c’est Henri Langlois qui fit de la Cinémathèque un lieu inouï de programmation et de correspondance entre les oeuvres. Bien sûr cela ne va pas sans contraintes ni frustrations. Entre le choix idéal des films et la projection, des difficultés (disponibilité des copies, état des copies ou des éléments de tirage, problèmes de droit, contexte de diffusion, relation avec les distributeurs ou les ayants droit…) peuvent intervenir et contrarier la programmation.
Bâtir un programme de courts métrages pour les écoliers c’est d’abord déjouer l’idée d’un montage de « petits » films pour les enfants. Au contraire, il s’agit de les confronter à des oeuvres fortes qui, au même titre que des longs métrages, feront partie de leur expérience de spectateurs (et au-delà, de leur expérience tout court). Le cinéma et la salle où il a lieu sont faits pour le regard et font le regard. D’où leur importance dans ce que nous appelons l’éducation du regard (c’est-à-dire ce qui le fait bouger, remuer et sortir). Comme il y a une enfance du langage, il y a une enfance du regard. Parce qu’ils ont de l’égard pour cette enfance (autrement dit, ils la regardent) les films de notre sélection rencontrent les regardeurs (terme plus juste que « spectateurs »), chacun étant une invitation au regard en mouvement, au regard comme mouvement.
Regards libres
5 courts métrages à l’épreuve du Réel
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Amanda Robles, Olivier Payage et Jacques Kermabon de Bref, le magazine du court métrage

Apologie de l’attention
Regards libres emprunte aux voies du suspense. Mais ici, aucun meurtre n’a été commis. L’événement longtemps dérobé à notre regard et dont les témoins convoqués pour en rendre compte nous entretiennent tour à tour est un tableau. Ce principe formel consistant à filmer des enfants d’une dizaine d’années qui réagissent face à une toile signée Jérémy Chabaud tout en ne nous permettant pas de voir celle-ci, manifeste une certaine dimension démonstrative. Parallèlement, le procédé nous conduit à imaginer ce que les mots des enfants suggèrent jusqu’à ce que les linéaments d’images nées ainsi en nous se confrontent in fine avec l’œuvre enfin montrée longuement, frontalement.
De quelle liberté se revendique le titre ? Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Romain Delange explique les raisons de la tranche d’âge choisie. Ces enfants ne sont pas encore trop bridés par un savoir reconnu, une culture instituée dont la présence, quand bien même ils ne la maîtriseraient pas, pèserait sur leur parole. Ce qui émane de leurs propos recoupe une palette de réactions type que la mise en scène et le montage orchestrent en ménageant différents tempos, des silences, des hésitations, des rires impromptus.
Le prégénérique nous familiarise avec un premier visage en gros plan et avec le principe du regard fixé sur un objet auquel l’enfant réagit. Après le générique, l’enfant qui pénètre précautionneusement dans la salle affine le dévoilement du dispositif. Ensuite, le montage va alterner des raccords de mouvements – par l’entremise du panoramique circulaire qui passe du visage net à l’arrière du tableau flou et réciproquement – à des coupes dans le plan qui privilégient la logique des paroles prononcées. De son côté, le recours à des tandems apporte un autre type de dynamisme au film. Au lieu d’enchaîner les témoignages les uns à la suite des autres, le film les entremêle selon une progression pas complètement linéaire, qui procède par associations – à la barque évoquée par l’un fait suite le bateau qui avance – ou échos – la dimension descriptive présente au début demeure vivante jusqu’à la fin.
Gbanga-Tita
La part du hasard
À quoi correspond ce gros plan qui isole cet Africain ? Pourquoi ne pas avoir montré les enfants à qui il s’adresse et qu’on entend pourtant distinctement ? Quel sens a ce récit qu’il leur conte ? La tenue dont fait preuve Gbanga-Tita, la rigueur du parti pris, font que le spectateur qui le découvre peut difficilement se départir de l’envie de reconstituer une intentionnalité. Pourtant, les cartons qui encadrent les deux plans du film nous donnent le contexte de leur réalisation. Même si la mise en scène en a été programmée – et comment pourrait-il en être autrement avec la lourdeur du matériel qu’il a fallu emporter au fin fond de la forêt équatoriale – Gbanga-Tita est le fruit du hasard, un de ces moments de grâce qui adviennent parfois pendant un tournage. Dans un film, il y a ce qu’on prévoit, ce qu’on sème et ce qu’on cueille par inadvertance. Ici, comme l’explique Thierry Knauff dans l’entretien et comme le laisse entendre le troisième carton, le destin a fait coïncider la durée technologique de la pellicule qui restait dans la caméra et le temps mis par Lengé à boucler son histoire. Que ce dernier soit mort quelques semaines après – comme nous l’apprend le carton final – apporte une émotion supplémentaire au sentiment d’assister à un instant unique arraché à l’oubli, de découvrir un document plus qu’un documentaire. Nous sommes ainsi condamnés à l’attitude qui, toujours, devrait être prioritairement la nôtre face à une œuvre : tenter de mettre en mots l’émotion que le film provoque en nous.
D’une certaine façon, il s’agit de la captation d’un spectacle dans lequel Lengé est à la fois conteur, chanteur et chef de chœur, dans l’exécution duquel toute frontière entre spectateur et participant est abolie. Il serait plus pertinent d’admettre que nous n’avons pas de substantif adéquat pour nommer ce qui se joue là, en pleine nature : la transmission d’un conte mille et une fois répété, d’un récit initiatique qui renvoie à une conception du monde et passe par une sorte de chant.
Accueil > Ecole et cinéma > Films > Regards libres
Regards libres
5 courts métrages à l’épreuve du Réel
Extraits des Points de vue.
écrits par Amanda Robles, Olivier Payage et Jacques Kermabon de Bref, le magazine du court métrage
Regards libres
Apologie de l’attention
Regards libres emprunte aux voies du suspense. Mais ici, aucun meurtre n’a été commis. L’événement longtemps dérobé à notre regard et dont les témoins convoqués pour en rendre compte nous entretiennent tour à tour est un tableau. Ce principe formel consistant à filmer des enfants d’une dizaine d’années qui réagissent face à une toile signée Jérémy Chabaud tout en ne nous permettant pas de voir celle-ci, manifeste une certaine dimension démonstrative. Parallèlement, le procédé nous conduit à imaginer ce que les mots des enfants suggèrent jusqu’à ce que les linéaments d’images nées ainsi en nous se confrontent in fine avec l’œuvre enfin montrée longuement, frontalement.
De quelle liberté se revendique le titre ? Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Romain Delange explique les raisons de la tranche d’âge choisie. Ces enfants ne sont pas encore trop bridés par un savoir reconnu, une culture instituée dont la présence, quand bien même ils ne la maîtriseraient pas, pèserait sur leur parole. Ce qui émane de leurs propos recoupe une palette de réactions type que la mise en scène et le montage orchestrent en ménageant différents tempos, des silences, des hésitations, des rires impromptus.
Le prégénérique nous familiarise avec un premier visage en gros plan et avec le principe du regard fixé sur un objet auquel l’enfant réagit. Après le générique, l’enfant qui pénètre précautionneusement dans la salle affine le dévoilement du dispositif. Ensuite, le montage va alterner des raccords de mouvements – par l’entremise du panoramique circulaire qui passe du visage net à l’arrière du tableau flou et réciproquement – à des coupes dans le plan qui privilégient la logique des paroles prononcées. De son côté, le recours à des tandems apporte un autre type de dynamisme au film. Au lieu d’enchaîner les témoignages les uns à la suite des autres, le film les entremêle selon une progression pas complètement linéaire, qui procède par associations – à la barque évoquée par l’un fait suite le bateau qui avance – ou échos – la dimension descriptive présente au début demeure vivante jusqu’à la fin.
Gbanga-Tita
La part du hasard
À quoi correspond ce gros plan qui isole cet Africain ? Pourquoi ne pas avoir montré les enfants à qui il s’adresse et qu’on entend pourtant distinctement ? Quel sens a ce récit qu’il leur conte ? La tenue dont fait preuve Gbanga-Tita, la rigueur du parti pris, font que le spectateur qui le découvre peut difficilement se départir de l’envie de reconstituer une intentionnalité. Pourtant, les cartons qui encadrent les deux plans du film nous donnent le contexte de leur réalisation. Même si la mise en scène en a été programmée – et comment pourrait-il en être autrement avec la lourdeur du matériel qu’il a fallu emporter au fin fond de la forêt équatoriale – Gbanga-Tita est le fruit du hasard, un de ces moments de grâce qui adviennent parfois pendant un tournage. Dans un film, il y a ce qu’on prévoit, ce qu’on sème et ce qu’on cueille par inadvertance. Ici, comme l’explique Thierry Knauff dans l’entretien et comme le laisse entendre le troisième carton, le destin a fait coïncider la durée technologique de la pellicule qui restait dans la caméra et le temps mis par Lengé à boucler son histoire. Que ce dernier soit mort quelques semaines après – comme nous l’apprend le carton final – apporte une émotion supplémentaire au sentiment d’assister à un instant unique arraché à l’oubli, de découvrir un document plus qu’un documentaire. Nous sommes ainsi condamnés à l’attitude qui, toujours, devrait être prioritairement la nôtre face à une œuvre : tenter de mettre en mots l’émotion que le film provoque en nous.
D’une certaine façon, il s’agit de la captation d’un spectacle dans lequel Lengé est à la fois conteur, chanteur et chef de chœur, dans l’exécution duquel toute frontière entre spectateur et participant est abolie. Il serait plus pertinent d’admettre que nous n’avons pas de substantif adéquat pour nommer ce qui se joue là, en pleine nature : la transmission d’un conte mille et une fois répété, d’un récit initiatique qui renvoie à une conception du monde et passe par une sorte de chant.
Le Chœur
Mobiliser le regard
Regarder n’est pas une évidence, nous en faisons l’expérience tous les jours. La plupart des choses ou des gens que nous voyons, nous ne les regardons pas. Même si le cinéma contribue souvent à détourner le regard de ce qui nous entoure, il peut aussi le mobiliser, et nous apprendre, lentement, une autre façon de faire sens. C’est ce que propose, de films en films, le cinéma d’Abbas Kiarostami, une ouverture sur ce qui vient à se donner pour peu que l’on regarde. Ce cinéma est là pour nous ouvrir les yeux.
Quand il réalise Le Chœur en 1982, Kiarostami est déjà l’auteur de nombreux films dont les protagonistes sont des enfants ; le monde de l’enfance est d’ailleurs le sujet presque exclusif de son cinéma depuis 1969, date à laquelle il fonde le département cinéma au sein de l’Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes (le « Kanun » cf Autour du film). Si le film s’ouvre comme un cahier d’écolier, c’est qu’il se situe d’entrée sur un plan pédagogique, le cinéaste se soucie de nous apprendre quelque chose. Mais apprendre ici n’a rien à voir avec les devoirs d’école et les leçons à retenir. Il s’agit d’abord d’une expérience, celle d’un mouvement qui nous force à sortir (étymologiquement « éducation » signifie « tirer hors de »). Mais sortir de quoi ?
L’exposition pourrait être celle d’un film d’action. Les premiers plans nous montrent une cavalcade empressée qui ne laisse rien deviner de la suite. Il y a un élan irrépressible dans cette intrusion, une brutalité qu’accentuent la frontalité des plans et la verticalité des murs. D’abord statique, la caméra suit le mouvement et se laisse entraîner dans la course en travelling arrière. Un plan serré des jambes puis de la tête du cheval prisonnier de ses harnais redouble le sentiment de violence de cette irruption d’un réel que la caméra ne peut contenir. Mais soudain la charrette ralentit ; un vieil homme en interdit le passage, un homme fragile et replié sur lui-même, un homme qui tourne le dos.
l’Illusionniste
Illusions et réalités – Un portrait
Qu’est-ce que le cinéaste nous donne à voir d’Antoinette ? Comment nous la dépeint-il et grâce à quelles techniques cinématographiques ?
Nous ne connaissons d’abord d’elle que ses mains et sa voix. Le cinéaste commence par filmer avec attention ses gestes ; la caméra, portée à l’épaule, est très proche d’Antoinette et le cadreur doit suivre la vivacité de chacun de ses mouvements. Le spectateur du film est ainsi un spectateur privilégié : grâce au gros plan, il lui est permis d’être plus près de la scène que dans n’importe quelle salle de spectacle. Il peut alors observer en détail les gestes de l’illusionniste et peut tout à fait penser que, si bien placé, il parviendra peut-être à deviner le « truc ». On remarque qu’Antoinette accompagne chacun de ses gestes d’un commentaire. Dans un tour de magie, l’une des astuces consiste en effet à attirer l’attention du spectateur ailleurs, par la parole mais aussi par des gestes inutiles qui servent à en dissimuler d’autres. Antoinette, l’illusionniste, est ainsi présentée d’entrée de jeu comme un être de gestes et de paroles.
Mais c’est aussi un visage magnifique, radieux, dont le sourire malicieux vient illuminer le film, avec un effet à retardement. Si le cinéaste prend du temps avant de faire apparaître le visage d’Antoinette, c’est pour créer une sorte de surprise, mais aussi peut-être pour signifier, par les moyens du cinéma, combien il faut de temps pour approcher quelqu’un et pour parvenir à bien le filmer. Cavalier n’est pas de ceux qui jettent leur caméra au visage des passants. S’il parvient à filmer au plus près Antoinette, c’est qu’il a su instaurer entre elle et lui une relation de confiance, presque d’intimité.
Un air de famille
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Pierre Lecarme
Au départ d’un film image par image, il y a toujours un petit bout de papier, un crayon et l’envie de mettre toute la gomme. C’est un vrai privilège que d’avoir l’opportunité de rencontrer des réalisateurs vivants prêts à parler de leur travail de créateurs. Il est agréable de déceler un esprit maison, une culture commune qui traverse l’ensemble de leurs films d’animation réalisés à ce jour. Dans les bureaux de Folimage près de Valence, ça parle beaucoup, ça discute beaucoup, ça trouve plein de choses personnelles à dire, ça apprend à défendre son idée et à trouver sa place sans perdre ni son identité profonde, ni celle de l’œuvre en cours. Au risque d’avoir trop de choses à dire et de ne pas arriver à bien les raconter. Nous n’avons jamais été directement au cœur de ces longs allers-retours avant que le train du scénarimage ne se mette en route et qu’il ne soit plus guère possible d’avoir des remords. C’est sans doute mieux. Nous avons souvent traversé une ruche calme en pleine ébullition sur plusieurs étapes simultanées en cours de fabrication. Ici la notion de temps est tout autre. Tout cela nous laisse la liberté de parler, à propos de l’inspiration et l’écriture de chaque film, d’une famille de créateurs sans nous soucier des hiérarchies.
De quoi parle-t-on ?
D’un peu de tout, mais souvent des papas, quelquefois des mamans, des méchants qui sont plutôt bêtes ou gentils, de la protection de la nature et des animaux qui sont aussi des hommes.
On l’aura compris, l’objectif premier pour les créateurs des quatre courts métrages de ce programme 1, 2, 3… Léon ! n’est pas de faire des films pédagogiques, mais plutôt de raconter des histoires dans lesquelles on ne fait pas la morale. On défend des valeurs auxquelles on croit et sans manichéisme. Sientje et Chez madame Poule ne sont pas des productions maison Folimage, la famille les adopte pour l’occasion ! Les allers-retours d’un film à l’autre dans les pages qui suivent vont démontrer les liens qui les rapprochent. Et il nous paraît indispensable de faire aussi référence à l’histoire de Folimage. Nous évoquerons Patate et le jardin potager, L’Enfant au grelot, La Prophétie des grenouilles et Mia et le Migou.
Que cent fleurs s’épanouissent !
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Gérard Lefèvre
 Vu aujourd’hui, Le Cerf-volant du bout du monde garde une certaine fraîcheur, une qualité qui persiste malgré la naïveté de son propos d’ensemble. Le film nous parle d’amitié, de solidarité, de coopération entre les enfants vivant dans des pays aussi éloignés que peuvent l’être la France et la Chine, « du bout du monde ». À la sortie du film, c’est le critique communiste Georges Sadoul qui écrivait dans Les Lettres françaises du 26 décembre 1958 : « Et il passionne aussi les adultes, en leur donnant à découvrir la plus grande partie du monde, la plus peuplée, la plus mal connue et la plus attirante. » Quarante ans après cette réalisation, notre regard sur la Chine s’est enrichi de ces dizaines d’années d’histoire qui ont bouleversé les idéologies. Nous avons appris à être moins crédules, peut-être aussi moins manichéens, à nous méfier de ceux qui prônent les lendemains qui chantent. Lorsque le Mur de Berlin est tombé, en1989, il a sans doute mis un terme définitif à la mise en pratique d’une idéologie déjà bien moribonde, et cela quelques mois après la répression sanglante des manifestations de la place Tian An Men à Pékin. Plutôt que chercher, de manière presque compulsive à nous tourner vers quelque pays-modèle, nous essayons tant bien que mal de refonder nos valeurs sur le terreau qui est le nôtre. Néanmoins, nous pouvons éprouver de la sympathie à l’égard d’un film qui, certes, est daté, mais dont les valeurs n’ont pas vieilli. Il n’y a pas si longtemps qu’en France le « Tous ensemble » résonnait agréablement comme un idéal qui perdure. Le film résiste encore aujourd’hui, par sa lumineuse photographie (Henri Alekan), son choix des cadrages et la présence d’une musique inspirée (Louis Bessières) plus que par la mise en scène proprement dite ou sa direction d’acteurs. Le réalisateur, honnête artisan, a eu le grand mérite de s’entourer de collaborateurs talentueux et d’orchestrer un véritable travail d’équipe. Au crédit du film aussi, il faut ajouter l’excellent parti pris d’inscrire dans sa réalisation même la langue chinoise, à la fois comme partition musicale et comme élément dramaturgique qui permet aux spectateurs de partager intimement la difficulté des enfants à se comprendre par le seul langage parlé, avant de trouver une fillette chinoise bilingue. Le fait de ne pas sous-titrer la partie filmée en Chine procède de ce choix artistique.
Vu aujourd’hui, Le Cerf-volant du bout du monde garde une certaine fraîcheur, une qualité qui persiste malgré la naïveté de son propos d’ensemble. Le film nous parle d’amitié, de solidarité, de coopération entre les enfants vivant dans des pays aussi éloignés que peuvent l’être la France et la Chine, « du bout du monde ». À la sortie du film, c’est le critique communiste Georges Sadoul qui écrivait dans Les Lettres françaises du 26 décembre 1958 : « Et il passionne aussi les adultes, en leur donnant à découvrir la plus grande partie du monde, la plus peuplée, la plus mal connue et la plus attirante. » Quarante ans après cette réalisation, notre regard sur la Chine s’est enrichi de ces dizaines d’années d’histoire qui ont bouleversé les idéologies. Nous avons appris à être moins crédules, peut-être aussi moins manichéens, à nous méfier de ceux qui prônent les lendemains qui chantent. Lorsque le Mur de Berlin est tombé, en1989, il a sans doute mis un terme définitif à la mise en pratique d’une idéologie déjà bien moribonde, et cela quelques mois après la répression sanglante des manifestations de la place Tian An Men à Pékin. Plutôt que chercher, de manière presque compulsive à nous tourner vers quelque pays-modèle, nous essayons tant bien que mal de refonder nos valeurs sur le terreau qui est le nôtre. Néanmoins, nous pouvons éprouver de la sympathie à l’égard d’un film qui, certes, est daté, mais dont les valeurs n’ont pas vieilli. Il n’y a pas si longtemps qu’en France le « Tous ensemble » résonnait agréablement comme un idéal qui perdure. Le film résiste encore aujourd’hui, par sa lumineuse photographie (Henri Alekan), son choix des cadrages et la présence d’une musique inspirée (Louis Bessières) plus que par la mise en scène proprement dite ou sa direction d’acteurs. Le réalisateur, honnête artisan, a eu le grand mérite de s’entourer de collaborateurs talentueux et d’orchestrer un véritable travail d’équipe. Au crédit du film aussi, il faut ajouter l’excellent parti pris d’inscrire dans sa réalisation même la langue chinoise, à la fois comme partition musicale et comme élément dramaturgique qui permet aux spectateurs de partager intimement la difficulté des enfants à se comprendre par le seul langage parlé, avant de trouver une fillette chinoise bilingue. Le fait de ne pas sous-titrer la partie filmée en Chine procède de ce choix artistique.
Hollywood et les films de pirates
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Michel Marie
 Dès le premier plan, le personnage mythique, le Corsaire rouge, doublé de la star, Burt Lancaster, s’adresse au public droit dans les yeux : « Larguez les vergues, envoyez toute la voilure ! Venez autour de
Dès le premier plan, le personnage mythique, le Corsaire rouge, doublé de la star, Burt Lancaster, s’adresse au public droit dans les yeux : « Larguez les vergues, envoyez toute la voilure ! Venez autour de
moi ! Vous tous, approchez, vous êtes embarqués pour le dernier voyage du Corsaire rouge, un long voyage autour des îles Caraïbes ! Mais rappelez-vous: sur un bateau de piraterie, dans des eaux de piraterie, dans un monde de pirates, ne posez pas de questions, ne croyez que ce que vous voyez…» Puis, après que le même plan a été projeté à l’envers et que le corsaire est revenu sur la vergue d’où il s’était envolé : « Non, ne croyez que la moitié de ce que vous voyez… Un homme, au cabestan ! Levez l’ancre ! Plus vite ! » Et le récit commence.
Un double récit
Le Corsaire rouge, bizarrement titré ainsi, par pudibonderie morale, pour la version française alors que l’original américain parle de Pirate cramoisi (The Crimson Pirate) est un double récit, mêlant à la fois les conventions du film d’aventures maritimes avec voiliers somptueux, grande figuration, scènes d’abordages et personnages sanguinaires, et parodiant ces mêmes conventions par une avalanche de gags et des prouesses délibérément hors du commun. Il joue sur la crédulité du public, sa confiance un peu aveugle et sa faculté d’émerveillement, sur l’enfant qui sommeille en tout spectateur de cinéma venu voir un film pour qu’on lui raconte une histoire merveilleuse. Mais dans le même temps, le film se moque un peu gentiment de cette naïveté en la tournant en dérision par des détails ironiques (un pirate patibulaire essuie une larme avec un crochet) et par le recours à la comédie acrobatique où les deux héros, tels des enfants jouant aux pirates, seuls contre tous, sont supérieurs à leurs ennemis même si ceux-ci sont cent fois plus nombreux et incomparablement mieux armés. Les méchants Espagnols et les comparses pirates s’entretuent à longueur de film, mais ce sont des adversaires qui restent bien inoffensifs. On ne meurt presque pas dans les scènes d’abordage les plus sauvages, et malgré le Technicolor, le sang ne gicle pour ainsi dire jamais. Bien sûr, le vilain baron Gruda s’écrase sur le pont en perdant l’équilibre, mais il disparaît dans le hors-champ des voiles. Siodmak et Lancaster épargnent aux regards sensibles l’image traumatisante du corps écrasé.
Un vrai film de pirates
Le Corsaire rouge reste d’abord un vrai film de pirates et non un film burlesque comme une aventure des Monty Python sur un bateau de corsaires. Le film suit un schéma narratif assez traditionnel au départ, identique à celui de La Flèche et le Flambeau et à bien des films d’aventures historiques: un individu indépendant, le héros – ici le Corsaire rouge, dédoublé par son faire-valoir, le muet Ojo – se met au service de la collectivité (les insurgés de l’île de Cobra) pour assurer la victoire du peuple. Mais le film abonde en rebondissements inattendus, en renversements de situation (Vallo ne domine plus les règles du jeu et se fait destituer par Bellows, lui-même victime de la ruse du baron Gruda) et en surprenantes pirouettes, à l’image des acrobaties du personnage principal. Les traces de ce récit historique à la coloration anticolonialiste sont encore présentes dans le portrait du baron Gruda, émissaire sanguinaire et cruel du roi d’Espagne (il torture les insurgés, notamment Pablo Murphy) et plus encore dans celui des deux gouverneurs des îles de Cobra et de San Piero ; l’un est un vieillard sénile qui ne désire que réprimer les manifestations populaires avec la plus extrême sauvagerie, et pour son simple plaisir, l’autre est un bouffon facilement bernable, caricature de Louis-Philippe, entouré d’une cour d’aristocrates tous plus ridicules les uns que les autres. Les militaires de San Piero, dont l’un est un sosie de Napoléon, sont des idiots qui obéissent immédiatement aux ordres du faux baron Gruda et s’entretuent ; la cour est composée pour l’essentiel de vieilles coquettes qui ne s’intéressent qu’à la garde-robe de la reine-mère d’Espagne et s’émerveillent des tours de passe-passe qu’effectue le faux comte Ojo pendant qu’il leur subtilise leurs bijoux.
Les Demoiselles de Rochefort
Une comédie musicale en décors naturels
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Michel Marie
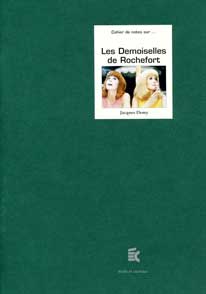
Les Demoiselles de Rochefort correspond donc à l’un des tout premiers projets du jeune cinéaste : tourner en France une comédie musicale à l’américaine avec des chansons et des ballets. La différence essentielle réside dans le choix très provocateur d’une réalisation en décors naturels dans une ville véritable. Nous avons vu que Demy avait choisi la ville militaire de Rochefort, en raison du géométrisme accentué de son architecture. Les dallages réguliers de la Place Carrée se prêtent en effet admirablement, par contraste, à la représentation des figures chorégraphiques modernes, car ils permettent à celles-ci de mieux se détacher sur un fond symétrique. Le sol de Rochefort offre l’équivalent des structures visuelles des ballets kaléidoscopiques du chorégraphe américain Busby Berkeley, le célèbre réalisateur des Chercheuses d’or (1935) et de Place au rythme (1939).
Les chansons
Le film accorde une large place aux chansons : elles sont, en effet, une vingtaine à partir de la chanson initiale, celle des sœurs jumelles (séquence 4) jusqu’à sa reprise lors de la kermesse finale (séquence 21). On notera la disparition des chansons dans la dernière partie du film après la kermesse. Les personnages principaux ont tous l’opportunité d’exprimer leurs sentiments par la voie du lyrisme musical. Et ce sont évidemment les jumelles, Solange et Delphine, qui ont le plus l’occasion de chanter, ensemble et également chacune pour elle-même. Les chansons en commun interviennent dans les séquences 4, 16 et 21 : outre le thème devenu très célèbre Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, le spectateur a droit à la mélancolique et ironique chanson Dans le port de Hambourg, qui est suivie du thème euphorique Quand l’été à disparu. Quand le temps s’en est allé… Aimer les fleurs. Aimer les rires et les pleurs.
Delphine et Solange s’expriment seules lorsqu’elles évoquent leur amour idéal. Il en est de même pour Maxence, Andy, Simon et Yvonne. Les deux forains chantent pour évoquer leurs voyages et leurs amours plus éphémères : Nous voyageons de ville en ville,et de filles en filles… (séquence 9 et séquence 21). Ce qui différencie essentiellement les chansons des Demoiselles de celles des comédies hollywoodiennes qui utilisent souvent des « standards » antérieurs déjà très célèbres comme, « Singin’ in the Rain », c’est qu’elles ont été écrites spécialement pour le film par l’auteur (Jacques Demy, bien évidemment), qui est aussi le scénariste et le dialoguiste. De plus, les paroles des chansons sont toutes prononcées de manière à être comprises par le spectateur-auditeur. Elles ne sont pas séparées du dialogue mais, au contraire, en constituent le prolongement indispensable, du point de vue du sens notamment. Elles permettent de comprendre les sentiments des personnages et donnent des informations scénaristiques importantes, absentes des dialogues parlés : par exemple, la relation antérieure entre Simon et Yvonne. D’autre part, le texte des paroles chantées comprend tout autant de tournures poétiques, lyriques, ironiques et comiques que les dialogues en eux-mêmes. Mais également, Jacques Demy ne limite pas la chanson à l’expression du lyrisme amoureux. Les séquences 17 et 18, consacrées à la découverte du corps de la femme découpée en morceaux, comprennent deux chansons pour la première (chansons d’Yvonne puis de Josette) et une suite de dialogues intégralement chantés par tous les personnages présents pour la seconde : les policiers, Maxence, Solange, Andy, enfin Delphine. La séquence 18 s’oppose ainsi à la séquence 20 qui réunit tous les personnages autour d’une table de restaurant pour les faire parler exclusivement en alexandrins. Ce dialogue de conversations de rue, intégralement chanté, non sans une pointe d’auto-ironie (C’est de l’esprit à quatre sous – Grattez où ça vous démange !) rappelle le chanté des Parapluies de Cherbourg et annonce celui de Une chambre en ville.
Trait d’union, ou la liberté lieuse
Extrait du Point de vue des Cahier de notes sur…
écrit par Ilan Nguyên
 Gauche le violoncelliste est un long métrage remarquable à bien des égards dans l’histoire du dessin animé au Japon. Ses sources d’inspiration, comme le soin formel apporté à sa réalisation et la tenue de sa mise en scène musicale, le situent dans une veine singulière. Un ensemble de conditions et d’ambitions particulières contribua à faire de ce film un véritable laboratoire où s’élaborèrent nombre de choix et de motifs techniques résolument neufs, qui firent date et font désormais partie des moyens d’expression établis du dessin animé au Japon. Par-delà – si ce n’est du fait même de – tous les écarts que l’on pourra reprocher à sa forme, en matière de translation du récit originel (la nouvelle de Miyazawa), Gauche le violoncelliste constitue un tour de force et un véritable hommage à l’esprit de l’œuvre originale, par la mise en regard, la réunion fusionnelle qu’il cristallise entre ce texte et la musique de Beethoven.
Gauche le violoncelliste est un long métrage remarquable à bien des égards dans l’histoire du dessin animé au Japon. Ses sources d’inspiration, comme le soin formel apporté à sa réalisation et la tenue de sa mise en scène musicale, le situent dans une veine singulière. Un ensemble de conditions et d’ambitions particulières contribua à faire de ce film un véritable laboratoire où s’élaborèrent nombre de choix et de motifs techniques résolument neufs, qui firent date et font désormais partie des moyens d’expression établis du dessin animé au Japon. Par-delà – si ce n’est du fait même de – tous les écarts que l’on pourra reprocher à sa forme, en matière de translation du récit originel (la nouvelle de Miyazawa), Gauche le violoncelliste constitue un tour de force et un véritable hommage à l’esprit de l’œuvre originale, par la mise en regard, la réunion fusionnelle qu’il cristallise entre ce texte et la musique de Beethoven.
Un nouveau départ
En tant que premier projet de Takahata prenant pour cadre son pays, Gauche constitue un tournant majeur dans l’œuvre de son réalisateur, et le premier maillon d’un parcours créatif au long cours poursuivi jusqu’à ce jour dans une même perspective : l’œuvre de Takahata est depuis lors tournée toute entière vers la représentation de la réalité de son pays. À l’opposé de toute conception « nationale » par principe, abstraite ou théorique, son projet, dès Gauche le violoncelliste, est de puiser dans la réalité la plus proche de lui, celle de son entourage immédiat, matériel, quotidien, et qu’il connaît naturellement de la manière la plus intime, pour y appartenir et en être acteur. Cet ancrage est aussi à l’origine de chacun de ses travaux ultérieurs.
Gauche est aussi le premier projet de mise en scène d’envergure auquel Takahata choisit de s’atteler sans (et malgré l’absence de) Miyazaki, son collaborateur le plus proche. Les années suivantes confirmeront et accentueront cette séparation, et l’affirmation d’une indépendance créative chez Miyazaki, à partir de sa première expérience à la mise en scène, la série Conan le fils du futur (1978). Ainsi, Takahata aura à explorer au cours des années suivantes de nouvelles modalités de mise en scène, de nouvelles collaborations, recherche dont Gauche marque le premier pas. Takahata n’a réalisé presque aucune œuvre originale à ce jour (Pompoko est le seul de ses longs métrages le créditant à cet égard). Son œuvre repose au premier chef sur un travail d’adaptation, partant de matériaux originels, vers la forme filmique : la quasi totalité de son travail est ainsi basée sur des sources partagées principalement entre textes littéraires et récits en bandes dessinées. Dans leur variation même au cours du temps, les modalités de ce travail de transposition constituent donc un nœud central dans l’approche du cinéma de Takahata. Sur ce chapitre, Gauche le violoncelliste est marquant à au moins trois égards : son ancrage dans le temps de la jeunesse ; l’ensemble des expérimentations techniques et formelles sur lesquelles repose le film ; enfin, la mise à l’épreuve et l’affirmation d’un projet basé tout à la fois sur une très grande fidélité à l’œuvre originale, et des prises de libertés ponctuelles, porteuses de sens.
écrit par Marie Omont
Pierre et le loup retrace un parcours initiatique : c’est un conte. Sans renoncer à son univers sombre et mélancolique, Suzie Templeton signe ici une œuvre plus lumineuse. Si ce film est plus optimiste, c’est que le jeune Pierre parvient à prendre sa place dans le monde des adultes. En partant d’un univers réaliste aliénant, la réalisatrice montre comment l’enfant trouve des alliés dans sa révolte contre l’enfermement et la peur. La réécriture du conte ira même jusqu’à offrir à Pierre la force de proposer une nouvelle éthique de vie.
Isolement et repli
Pour son adaptation du conte de Prokofiev, Suzie Templeton a choisi un réalisme sans concession : le monde dans lequel évolue Pierre ressemble peu à la plaine enneigée de la version de Disney ou pré fleuri de Marcel Tillard. La Russie contemporaine de Templeton est hostile, le quotidien de Pierre brutal. Le début du film nous ancre d’emblée dans un monde froid, venteux et clos. Il faut attendre cinq minutes et quarante six secondes pour entendre la musique de Prokofiev. Avant cela, la bande son crée une ambiance sombre, faite de bruits, de craquements, de hurlements et de souffle retenu. Le choix de la tempête de neige ne vient pas d’un souci de poser un décor pittoresque. Il ne s’agit pas de faire slave mais de créer un monde extérieur menaçant, qui griffe et gifle les personnages autant que leur abri précaire, fait de planches et de clous. La maison de Pierre est fermée sur l’extérieur, d’où ne peut venir que le mal. Dans le plan d’ensemble qui la présente, elle est comme coincée, en marge d’un monde qui la rejette ou du moins l’ignore. Ce n’est pas sordide, mais c’est profondément triste. La mise à l’écart des deux personnages est peut-être due à la pauvreté, mais ce qui frappe surtout, c’est l’attitude du grand-père. Son rôle est de scruter l’horizon, de s’en méfier et de fermer les portes. Il ne cesse de reclouer les planches pour obstruer toute ouverture possible. Sortir de la maison ne se fait que par nécessité : pour aller chercher de quoi manger puis pour marchander la vente du loup. Ainsi, le grand-père ne sait-il pas comment faire habiter le monde à son petit-fils. Par deux fois dans le film, il apparaît comme celui qui bouche l’horizon, qui bloque le mouvement d’émancipation du jeune garçon. Lorsque Pierre contemple l’espace sauvage par la brèche qu’il a faite dans la palissade (1’20), on le sent inquiet : il regarde derrière lui, guettant le grand-père qu’il semble plus craindre que les hurlements des loups. Le plan subjectif sur le paysage, par l’éclairage et le léger zoom avant, nous fait éprouver sa fascination pour cet espace. Mais le contrechamp revient très vite avec une entrée de champ brutale (rendue notamment par le bruitage) de la noueuse main du grand-père (1’30). Poignante est l’angoisse que l’on perçoit dans l’œil de la marionnette ! Le plan suivant, en demi ensemble, permet, malgré l’absence de paroles, de comprendre que le grand-père lui impose d’aller au marché. Le choix du muet prend alors toute son intensité. Le grand-père en devient taiseux, mutique et donc brutal puisque seuls les gestes d’empoignade, de bousculade, lui permettent de signifier ce qu’il veut de Pierre. Mais Templeton ne caricature pas puisqu’elle a le souci de faire un plan sur le grand-père désemparé par ce mode de vie qu’il impose à l’enfant. Qui, lui, se tait par soumission. Pierre voit bien que son grand-père ne sait pas agir autrement, que ce n’est pas par méchanceté mais par peur qu’il lui interdit de sortir vers l’Ailleurs. Lorsqu’il glissera sur la glace, c’est encore un raccord regard qui placera le grand-père comme un obstacle devant le ciel. La beauté et la force du raccord vient de la symétrie des deux plans : les deux personnages sont quasiment présentés sur un même fond. Et cela emprisonne d’autant plus Pierre. C’est toujours le hors-champ proche qui représente une menace pour le jeune garçon. L’absence de tout commentaire, le refus d’un narrateur rassurant et complice (comme chez Disney ou dans les versions sonores) place le spectateur dans une attente inquiète. La réalisatrice utilise habilement la connaissance que l’on a du fameux conte pour le régénérer.
Le Roi des masques
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Marie Omont

Le Roi des masques met en scène une tradition chinoise ancestrale : l’opéra. Deux personnages incarnent deux grandes écoles : l’acteur Maître Liang celle de l’opéra de Pékin et Wang celle de Sichuan. Le film de Wu Tian-Ming interroge la responsabilité de l’artiste face aux injustices de la société. Comment dépasser les vieux adages, les crispations traditionnelles, les superstitions archaïques ? Comment – pour reprendre l’image de Liang -apporter un peu de chaleur sur cette terre froide ? En artiste chinois, Wu Tian-Ming use du détour pour mettre en jeu la place de l’art dans le monde.
Mise en scène pudique et dynamique de la misère
La forme la plus avancée du cinéma doit être une combinaison de réalisme et de romantisme, et cette combinaison doit être ORGANIQUE. Faute de quoi, on aura un produit bâtard. Voilà sans concession l’idéal que Wu Tian-Ming formulait en 1988 et qu’il semble bien avoir réalisé avec Le Roi des masques.
Le sujet du film est poignant : comment le vieux maître des masques parviendra-t-il à accepter de transmettre son art à un enfant acheté qui n’est rien qu’une fille ? Wu Tian-Ming se fait ici le témoin d’une tradition chinoise qui perdure à l’heure actuelle : « bian lian », l’art des masques, ne se transmet au grand jamais à une fille. Ce thème, il l’aborde de façon réaliste mais également poétique. Le cinéma chinois de la Quatrième génération dont Wu est un éminent représentant ne se permet d’aborder les problèmes sociaux qu’avec la distance du film historique. Nous sommes donc au début du siècle, dans une période troublée, inquiète et pauvre, où la vente d’enfants est monnaie courante, si l’on peut dire. La séquence du marché aux enfants (séquence 5) est caractéristique de son traitement du réel : poétique mais sans concession. Nous ne savons pas exactement où se déroule l’action : le montage – par un fondu enchaîné -– nous conduit d’emblée au coeur de cet espace insolite. Wang est abordé immédiatement par une enfant qui lui
offre ses services comme servante. Elle se jette à ses pieds. Dure réalité de cette époque : pour assurer un avenir à ses enfants, on les donnait ou vendait comme domestiques. La caméra suit
le vieil homme mais dans la profondeur de champ s’esquissent d’autres destins tragiques : les enfants sont transportés, poussés, tirés, vendus. La bande-son résonne de cris, de plaintes. Wang traverse cet espace, comme gêné d’en arriver à se trouver là. L’espace fermé est éclairé par le haut, le sol recouvert de paille : atmosphère poussiéreuse. Les divers personnages passent devant la caméra : Wu Tian-Ming n’appuie sur aucun détail, c’est sans pathos qu’il nous laisse entrevoir cette dure réalité. Sous le regard affligé de Wang, nous suivons au premier plan une femme qui peine à laisser sa fille à celui qui l’emporte. Aucune larme, aucun cri : le renoncement de la pauvreté. Alors qu’il se dirige vers la sortie après avoir refusé d’acheter deux pièces un nouveau-né, il est interpellé : « grand-père! ». Déjà sur le seuil, il va sortir enfin vers la lumière. Il se retourne et, pour la première fois, est cadré en gros plan. En contrechamp, nous découvrons Gouwa, au centre du plan et dans un puits de lumière. Là encore, la caméra reste pudique, en plan moyen. Mais la musique nous révèle l’instant magique. Suivent deux plans des visages des personnages, en champ/contrechamp. Celui de Wang est éclairé par la lumière venant de la rue et celui de Gouwa par le puits de lumière qui la surplombe. Voilà comment l’on quitte le réalisme pour amorcer une rencontre. En travelling latéral, la caméra accompagne Wang qui se dirige en silence vers l’enfant. Les bruits du marché ont cessé dans la musique. Il se baisse jusqu’à l’enfant et se trouve lui aussi dans le puits de lumière, comme dans une sorte de révélation. Mais ce n’est pas l’enfant qui répondra à ses questions : un homme est entré dans le champ qui cache Gouwa et l’exclut.
Jusqu’au bout du rêve
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Jean-Pierre Pagliano
Un film d’exception
 Depuis un bon demi-siècle (la première version du film date de 1953), l’aventure de la bergère et du ramoneur traverse allègrement nos écrans et la mémoire de plusieurs générations de spectateurs. Des premiers croquis pour La Bergère tracés en1945 à la sortie du Roi et l’Oiseau en 1980, ce fut aussi pour Paul Grimault une longue aventure, qu’il résumait ainsi : « J’ai mis cinq ans pour le réaliser et trente pour trouver l’argent ! » Notre pays est le berceau du dessin animé. Pourtant – malgré une certaine embellie en ce début du XXIe siècle – on y réalise peu de longs métrages, et lorsqu’on en produit ils sont généralement animés à l’étranger pour des raisons économiques. Avec une légitime fierté, Jacques-Rémy Girerd pouvait présenter sa Prophétie des Grenouilles (2003) comme « le premier dessin animé de long métrage entièrement fabriqué en France depuis Le Roi et l’Oiseau ». À cet égard déjà, le film de Grimault et Prévert est une référence. Il l’est à bien d’autres titres – si j’ose dire, puisqu’il en a précisément changé, de titre, au cours de sa houleuse histoire. Bien avant que l’animation n’entre dans le champ plus large de la cinéphilie (elle cesse à peine d’être perçue comme un genre marginal), Le Roi et l’Oiseau avait déjà réussi cette percée. Seul dessin animé couronné par le Prix Louis-Delluc (en décembre1979), il est également le seul – avec Blanche-Neige et les Sept Nains – à figurer parmi les cent films préférés des Français (sondage-palmarès du Mondeet de la Fnac, octobre 1999). Son importance ne se limite pas à l’Hexagone. Tout autant que Le Petit Soldat (1947), Le Roi et l’Oiseau est considéré comme un des sommets de l’animation mondiale. Et l’on sait que l’influence de La Bergère et le Ramoneur a été décisive sur les maîtres japonais Takahata et Miyazaki : le dessin animé pouvait éveiller les consciences, marier réalisme et symbolisme, dégager une profonde émotion en faisant exister (et pas seulement bouger) les personnages sur l’écran. Juste retour des choses : ces qualités sont aujourd’hui reconnues par le public français dans Le Tombeau des lucioles ou dans Le Voyage de Chihiro. Au Japon, l’animation n’est pas un genre réservé à l’enfance. Elle souffre encore chez nous de ce préjugé terriblement restrictif, même si les goûts et les mentalités évoluent avec l’arrivée, notamment, des longs métrages nippons. Le Roi et l’Oiseau, plus nettement que La Bergère et le Ramoneur, s’était déjà affranchi de la barrière des âges. Ce classique se transmet de génération en génération, comme les poèmes et les chansons deJacques Prévert, qu’on découvre dans l’enfance et qui nous accompagnent toute la vie. Le dessin animé de Grimault peut d’ailleurs être abordé comme un film de Prévert. On y reconnaît des thèmes, des types, une invention verbale communs aux films écrits par le poète pour son frère Pierre, pour Grémillon, Renoir ou pour Marcel Carné. C’est surtout cette dernière association, étiquetée « réalisme poétique » dans les Histoires du cinéma, qu’évoquait André Bazin après la présentation de La Bergère et le Ramoneur au festival de Venise 1952 : « Il est troublant de constater par exemple la permanence d’un thème qu’on aurait pu croire inséparable du réalisme cinématographique, celui de la banlieue, et qui révèle ici sa véritable valeur métaphorique. À l’univers du roi méchant (…) s’opposent les quartiers souterrains où le soleil ne pénètre jamais mais où chante l’aveugle qui croit à la lumière. On pense à l’Aubervilliers du Jour se lève (…) et l’on comprend mieux quels symboles de la condition humaine Prévert poursuivait dans les cercles de l’enfer suburbain. »
Depuis un bon demi-siècle (la première version du film date de 1953), l’aventure de la bergère et du ramoneur traverse allègrement nos écrans et la mémoire de plusieurs générations de spectateurs. Des premiers croquis pour La Bergère tracés en1945 à la sortie du Roi et l’Oiseau en 1980, ce fut aussi pour Paul Grimault une longue aventure, qu’il résumait ainsi : « J’ai mis cinq ans pour le réaliser et trente pour trouver l’argent ! » Notre pays est le berceau du dessin animé. Pourtant – malgré une certaine embellie en ce début du XXIe siècle – on y réalise peu de longs métrages, et lorsqu’on en produit ils sont généralement animés à l’étranger pour des raisons économiques. Avec une légitime fierté, Jacques-Rémy Girerd pouvait présenter sa Prophétie des Grenouilles (2003) comme « le premier dessin animé de long métrage entièrement fabriqué en France depuis Le Roi et l’Oiseau ». À cet égard déjà, le film de Grimault et Prévert est une référence. Il l’est à bien d’autres titres – si j’ose dire, puisqu’il en a précisément changé, de titre, au cours de sa houleuse histoire. Bien avant que l’animation n’entre dans le champ plus large de la cinéphilie (elle cesse à peine d’être perçue comme un genre marginal), Le Roi et l’Oiseau avait déjà réussi cette percée. Seul dessin animé couronné par le Prix Louis-Delluc (en décembre1979), il est également le seul – avec Blanche-Neige et les Sept Nains – à figurer parmi les cent films préférés des Français (sondage-palmarès du Mondeet de la Fnac, octobre 1999). Son importance ne se limite pas à l’Hexagone. Tout autant que Le Petit Soldat (1947), Le Roi et l’Oiseau est considéré comme un des sommets de l’animation mondiale. Et l’on sait que l’influence de La Bergère et le Ramoneur a été décisive sur les maîtres japonais Takahata et Miyazaki : le dessin animé pouvait éveiller les consciences, marier réalisme et symbolisme, dégager une profonde émotion en faisant exister (et pas seulement bouger) les personnages sur l’écran. Juste retour des choses : ces qualités sont aujourd’hui reconnues par le public français dans Le Tombeau des lucioles ou dans Le Voyage de Chihiro. Au Japon, l’animation n’est pas un genre réservé à l’enfance. Elle souffre encore chez nous de ce préjugé terriblement restrictif, même si les goûts et les mentalités évoluent avec l’arrivée, notamment, des longs métrages nippons. Le Roi et l’Oiseau, plus nettement que La Bergère et le Ramoneur, s’était déjà affranchi de la barrière des âges. Ce classique se transmet de génération en génération, comme les poèmes et les chansons deJacques Prévert, qu’on découvre dans l’enfance et qui nous accompagnent toute la vie. Le dessin animé de Grimault peut d’ailleurs être abordé comme un film de Prévert. On y reconnaît des thèmes, des types, une invention verbale communs aux films écrits par le poète pour son frère Pierre, pour Grémillon, Renoir ou pour Marcel Carné. C’est surtout cette dernière association, étiquetée « réalisme poétique » dans les Histoires du cinéma, qu’évoquait André Bazin après la présentation de La Bergère et le Ramoneur au festival de Venise 1952 : « Il est troublant de constater par exemple la permanence d’un thème qu’on aurait pu croire inséparable du réalisme cinématographique, celui de la banlieue, et qui révèle ici sa véritable valeur métaphorique. À l’univers du roi méchant (…) s’opposent les quartiers souterrains où le soleil ne pénètre jamais mais où chante l’aveugle qui croit à la lumière. On pense à l’Aubervilliers du Jour se lève (…) et l’on comprend mieux quels symboles de la condition humaine Prévert poursuivait dans les cercles de l’enfer suburbain. »
Réalisme dans la fantaisie et raffinement dans la satire
Si judicieux que soit le commentaire d’André Bazin, il serait mal venu d’étendre à l’ensemble du film ce réalisme noir dont Prévert a effectivement été le chantre pour Carné. La collaboration avec Grimault prend d’autres couleurs. Alors que Carné illustre le versant nocturne de Prévert, Grimault incarne son versant solaire. Le poids du destin ne pèse pas chez Grimault, la fatalité – sociale ou métaphysique – lui est étrangère. La façon dont les deux amis s’approprient l’histoire d’Andersen est très révélatrice de leurs intentions. Dans le conte danois, la velléité émancipatrice des deux protagonistes tourne court : ils rejoignent bien vite leur coin de cheminée au lieu d’explorer « le vaste monde ». Chez Prévert et Grimault, au contraire, la résignation n’est pas de mise et l’évasion réussie des jeunes amoureux fera des émules, jusqu’à changer l’ordre du monde…
Réalisme et merveilleux
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Alain Philippon
 J’ai choisi comme titre « réalisme et merveilleux », et non « réalisme merveilleux », pour éviter de calquer ma formulation sur « réalisme poétique » – expression qui, sauf lorsque quelqu’un le note en passant, renvoie officiellement à une école et à un genre bien connus, alors même qu’il y a là une incontestable contradiction dans les termes. En recourant ici au terme « merveilleux », je me réfère à un genre littéraire auquel appartiennent les contes de Perrault, et que l’on distingue traditionnellement du « fantastique ». Ici, des événements surnaturels se produisent grâce à des puissances magiques (la principale étant celle de la Fée), mais comme inscrites naturellement, sans heurt, dans la réalité. (Tous les films de Jacques Demy – ou presque – peuvent d’ailleurs être considérés comme des contes de fées réalistes.) François Truffaut disait ne pas aimer les dessins animés parce que « tout y (était) possible ». Sans doute affirmait-il ainsi sa nécessité personnelle de ne se mouvoir que sur le terrain du réalisme. Mais ici : si dans un conte tout est possible d’un coup de baguette magique, qu’en est-il au cinéma ? Avec quels moyens ? Dans quelles limites ? Quid, d’autre part, de l’adaptation d’un conte, chez un cinéaste que l’on peut également taxer de « réaliste » ? Jacques Demy adapte de façon très scrupuleuse un conte lui-même très réaliste, les principales licences de Jacques Demy ayant trait au personnage de la Fée : quelque magiques que puissent être certains événements de Peau d’Âne, le conte et le film donnent de la réalité du dix-septième siècle, et principalement de sa réalité sociale, une vision juste. On y apprend par exemple que, dans le royaume du père du Prince, on trouve encore des souillons qui vivent et travaillent dans de véritables porcheries, et qu’il convient de remédier à cela. La Princesse n’est pas seulement revêtue d’une peau métaphorique, quelle qu’ait été la nature particulière de l’âne-banquier: elle pue, c’est dit crûment dans le film (même chez les rois), et sa puanteur donne même lieu à un évanouissement. Toutes les classes sociales sont représentées, exemplairement dans la scène de l’essayage de l’anneau, puisque toutes les filles du royaume (mais « pas les garçons » – légère licence ironique que se permet Demy par rapport au conte) y sont invitées. De même, avec la métairie où travaille Peau d’Âne, on a l’impression, un peu irritante d’abord, de voir une de ces images que l’on a tant vues dès qu’un film se situe avant notre siècle : une sorte de cliché, d’image d’Épinal ou d’image-SFP, tant les films réalisés avec cette instance nous ont montré maintes fois les mêmes chevaux, les mêmes figurants dans les mêmes postures (parfois totalement irréalistes de maladresse). (Serge Daney notait qu’il avait fallu Bresson et Lancelot du Lac pour que l’on découvre au cinéma que l’on pouvait parcourir des kilomètres et des kilomètres sans rencontrer personne, alors que tous les films sur le Moyen Âge grouillent de monde.) Or il n’en est rien : ce que l’on voit à l’image ne relève que de la fidélité au récit, où l’on peut noter, entre autres choses, la présence de l’« auge aux cochons » ou celle des valets dont la Princesse était « la butte ordinaire de tous leurs quolibets et de tous leurs bons mots ». De même Jacques Demy garde-t-il, à propos de la robe couleur du temps, le sens que le mot « Temps » avait chez Perrault et plus largement au dix-septième siècle : un beau ciel légèrement chargé de clairs nuages. De même, lorsque les médecins, après avoir examiné le Prince, rendent leur verdict (« maladie d’amour »), il ne s’agit absolument pas d’une fantaisie : la maladie d’amour faisait partie des maladies répertoriées par l’Université au dix-septième siècle, et des remèdes – parmi eux, le mariage – étaient même préconisés. Un détail enfin souligne le désir de réalisme de Jacques Demy : lorsque (séq. 15) la Fée confie sa baguette à la Princesse, elle n’omet pas de préciser qu’elle en a une autre dans son domaine, et demande à la Princesse de la lui prêter un instant, juste pour disparaître. Mais sans doute le trait le plus évident du souci de réalisme de Jacques Demy est-il le gros plan des mains essayant l’anneau, seul plan systématiquement et longuement répété. Une séquence, peu réussie à mes yeux, pose très précisément la question du « Tout est possible », et fait figure de symptôme : celle, onirique, où l’on voit le Prince et la Princesse se permettre « tout ce qui est interdit ». L’inventaire de « tout ce qui est interdit » (pure invention de Jacques Demy) semble bien mince, bien pauvre (se gaver de pâtisseries, entre autres choses). On me répliquera qu’il s’agit là de rêves d’enfants. Cela n’en témoigne pas moins, à mes yeux, de la difficulté de Jacques Demy à ouvrir toutes grandes les portes de la fantaisie, comme s’il lui fallait toujours des limites à l’intérieur desquelles il se meuve aisément. Le réalisme serait alors un garde-fou contre les excès de la fantasy (de l’imagination ou du fantasme).
J’ai choisi comme titre « réalisme et merveilleux », et non « réalisme merveilleux », pour éviter de calquer ma formulation sur « réalisme poétique » – expression qui, sauf lorsque quelqu’un le note en passant, renvoie officiellement à une école et à un genre bien connus, alors même qu’il y a là une incontestable contradiction dans les termes. En recourant ici au terme « merveilleux », je me réfère à un genre littéraire auquel appartiennent les contes de Perrault, et que l’on distingue traditionnellement du « fantastique ». Ici, des événements surnaturels se produisent grâce à des puissances magiques (la principale étant celle de la Fée), mais comme inscrites naturellement, sans heurt, dans la réalité. (Tous les films de Jacques Demy – ou presque – peuvent d’ailleurs être considérés comme des contes de fées réalistes.) François Truffaut disait ne pas aimer les dessins animés parce que « tout y (était) possible ». Sans doute affirmait-il ainsi sa nécessité personnelle de ne se mouvoir que sur le terrain du réalisme. Mais ici : si dans un conte tout est possible d’un coup de baguette magique, qu’en est-il au cinéma ? Avec quels moyens ? Dans quelles limites ? Quid, d’autre part, de l’adaptation d’un conte, chez un cinéaste que l’on peut également taxer de « réaliste » ? Jacques Demy adapte de façon très scrupuleuse un conte lui-même très réaliste, les principales licences de Jacques Demy ayant trait au personnage de la Fée : quelque magiques que puissent être certains événements de Peau d’Âne, le conte et le film donnent de la réalité du dix-septième siècle, et principalement de sa réalité sociale, une vision juste. On y apprend par exemple que, dans le royaume du père du Prince, on trouve encore des souillons qui vivent et travaillent dans de véritables porcheries, et qu’il convient de remédier à cela. La Princesse n’est pas seulement revêtue d’une peau métaphorique, quelle qu’ait été la nature particulière de l’âne-banquier: elle pue, c’est dit crûment dans le film (même chez les rois), et sa puanteur donne même lieu à un évanouissement. Toutes les classes sociales sont représentées, exemplairement dans la scène de l’essayage de l’anneau, puisque toutes les filles du royaume (mais « pas les garçons » – légère licence ironique que se permet Demy par rapport au conte) y sont invitées. De même, avec la métairie où travaille Peau d’Âne, on a l’impression, un peu irritante d’abord, de voir une de ces images que l’on a tant vues dès qu’un film se situe avant notre siècle : une sorte de cliché, d’image d’Épinal ou d’image-SFP, tant les films réalisés avec cette instance nous ont montré maintes fois les mêmes chevaux, les mêmes figurants dans les mêmes postures (parfois totalement irréalistes de maladresse). (Serge Daney notait qu’il avait fallu Bresson et Lancelot du Lac pour que l’on découvre au cinéma que l’on pouvait parcourir des kilomètres et des kilomètres sans rencontrer personne, alors que tous les films sur le Moyen Âge grouillent de monde.) Or il n’en est rien : ce que l’on voit à l’image ne relève que de la fidélité au récit, où l’on peut noter, entre autres choses, la présence de l’« auge aux cochons » ou celle des valets dont la Princesse était « la butte ordinaire de tous leurs quolibets et de tous leurs bons mots ». De même Jacques Demy garde-t-il, à propos de la robe couleur du temps, le sens que le mot « Temps » avait chez Perrault et plus largement au dix-septième siècle : un beau ciel légèrement chargé de clairs nuages. De même, lorsque les médecins, après avoir examiné le Prince, rendent leur verdict (« maladie d’amour »), il ne s’agit absolument pas d’une fantaisie : la maladie d’amour faisait partie des maladies répertoriées par l’Université au dix-septième siècle, et des remèdes – parmi eux, le mariage – étaient même préconisés. Un détail enfin souligne le désir de réalisme de Jacques Demy : lorsque (séq. 15) la Fée confie sa baguette à la Princesse, elle n’omet pas de préciser qu’elle en a une autre dans son domaine, et demande à la Princesse de la lui prêter un instant, juste pour disparaître. Mais sans doute le trait le plus évident du souci de réalisme de Jacques Demy est-il le gros plan des mains essayant l’anneau, seul plan systématiquement et longuement répété. Une séquence, peu réussie à mes yeux, pose très précisément la question du « Tout est possible », et fait figure de symptôme : celle, onirique, où l’on voit le Prince et la Princesse se permettre « tout ce qui est interdit ». L’inventaire de « tout ce qui est interdit » (pure invention de Jacques Demy) semble bien mince, bien pauvre (se gaver de pâtisseries, entre autres choses). On me répliquera qu’il s’agit là de rêves d’enfants. Cela n’en témoigne pas moins, à mes yeux, de la difficulté de Jacques Demy à ouvrir toutes grandes les portes de la fantaisie, comme s’il lui fallait toujours des limites à l’intérieur desquelles il se meuve aisément. Le réalisme serait alors un garde-fou contre les excès de la fantasy (de l’imagination ou du fantasme).
écrit par Raphaëlle Pireyre
Grâce à ce fort sentiment de l’immédiat
qui constitue la vraie atmosphère de l’âme enfantine,
le passé, dans chaque alternative,
devenait pour elle aussi vague que l’avenir. (…)
Elle était à l’âge où toutes les histoires sont vraies,
et où toutes les idées sont des histoires. L’actuel était l’absolu, le présent seul existait. Ce que savait Maisie, Henry James
I. Présentation
Gants de vaisselle remontés jusqu’aux coudes, Jojo, garçon d’une dizaine d’années, s’apprête à s’attaquer à l’évier débordant d’assiettes sales lorsque son père le met au défi : ils se lancent dans une course effrénée. L’un emprunte sa voiture pour se rendre au travail, l’autre coupe à travers champ pour arriver le premier au point d’arrivée. La première séquence de Little Bird (Kauwboy pour le titre original qui fait un jeu de mot sur le terme Kau qui en néerlandais signifie « choucas ») nous fait entrer en trombe dans le quotidien des deux hommes, dont on a entendu les voix dans le prégénérique énigmatique, par une action aussi rapide que saccadée. Le contraste entre la complicité dans la course et le costume de ménagère qu’endosse le garçon désigne la position mal définie de Jojo au sein de la famille et témoigne d’une relation aussi complexe que paradoxale entre lui et son père.
L’évocation d’une répartition ultra conventionnelle des rôles familiaux – l’un part travailler, l’autre reste à la maison pour y accomplir les tâches ménagères – dénonce déjà le déséquilibre de cette famille où c’est l’enfant qui prend le rôle de mère au foyer, désignant ainsi le personnage manquant dont le film ne va cesser de nous dessiner le portrait en absence.
Rentrant chez lui à travers champ après avoir fait la course avec son père, Jojo découvre un bébé choucas tombé du nid qu’il va recueillir, contre l’avis de son père. La présence de l’oiseau va lui attirer l’intérêt de la belle Yenthe, nouvelle venue dans son équipe de water-polo tout en redistribuant les rapports de force au sein de ce drôle de couple que forme le garçon avec son père.
Le récit qui se déroule sur la période ramassée des vacances scolaires et dans le direct voisinage de la maison du garçon, emboîte deux types de temporalités : le temps réel, linéaire et objectif qui sépare Jojo du jour de l’anniversaire de sa mère et qui voit le bébé oiseau devenir adulte ; le temps libre laissé à l’enfant par les vacances et sa perception subjective à travers les jeux et la découverte de l’amour. La collusion dans le montage, entre ces deux manifestations du temps, renvoie à une troisième dimension, bien plus difficile à appréhender : l’éternité.
II. Une aussi longue absence
Comment filmer l’absence ? Voilà bien la question que pose Little Bird. Comment rendre perceptible le vide laissé par le départ de la mère de Jojo, comment faire ressentir la place omniprésente qu’elle occupe dans l’esprit du garçon alors qu’elle n’est précisément pas là ? Comment rendre par l’image le fait qu’à travers les relations qu’il entretient avec son père, avec Yenthe et avec le choucas, c’est son rapport avec sa mère que rejoue Jojo ? Comment faire comprendre enfin, le déni de cette absence ?
Alors que Yenthe, invitée pour la première fois chez Jojo, observe le père endormi tout habillé sur le canapé en plein après midi, elle demande : « Où est ta mère ? ». La première réponse du garçon, instinctive, est de lui intimer de se taire. « Chut », dit-il, avant de poursuivre à voix basse : « Elle est en tournée en Amérique, je ne sais pas quand elle reviendra, elle me manque. » Il ajoute enfin qu’il confectionnera prochainement un gâteau pour son anniversaire. Alors que le film reste vague sur la nature et les motifs de cet éloignement, la seule raison qui en est explicitée est précisément ce que cette absence ne peut pas être, ce que nous comprenons ou pressentons qu’elle n’est pas. En entendant Jojo faire cette affirmation, le spectateur sait que cette version n’est pas la bonne, ne serait-ce que parce qu’elle ne peut pas être énoncée à voix haute devant le père, même somnolent.
Ce est qui évident d’emblée pour le spectateur, c’est que la distance entre Jojo et sa mère ne sera pas comblée, et que la cellule familiale incomplète telle qu’elle nous est présentée dans la première séquence est devenue une réalité pérenne. « Elle ne sera pas là » ou « Tu sais que ce n’est pas possible », répond le père lorsque Jojo évoque son désir de fêter l’anniversaire sans plus de détails. Le spectateur accumule les indices et les preuves dans le but de reconstituer les faits et avance comme un enquêteur chargé de résoudre ce mystère sur lequel planent beaucoup de non dits et de mensonges.
C’est essentiellement à travers les explications données par Jojo à l’oiseau, que nous apprenons progressivement des éléments sur la mère, qui, pour la plupart, relèvent du passé : les affiches qui montrent son visage et son nom, Judy Van Gelder, et font comprendre son appartenance à un groupe de musique country, les tournées internationales en famille, la chanson écrite pour son fils. Son récit insiste sur le bonheur passé de la vie à trois et sur le futur proche de l’anniversaire de sa mère qui les verra à nouveau réunis, mais occulte tout à fait le passé proche et le présent.
On apprend notamment à travers la visite guidée qu’il donne de la maison pour son nouvel hôte que, dans telle chambre, « c’est là que maman dormait et que papa dort encore », ce qui insiste sur le fait que cette absence scelle la fin du couple parental. Le récit conçu par bribes laisse au spectateur le soin de combler les trous à partir des éléments livrés par Jojo, et des traces de sa présence passée (photo ou enregistrements) et de construire comme un puzzle le portrait de ce personnage central du récit, quoiqu’absent de corps.
Sur la disparition de la mère, le garçon ne nous apprend rien, et le caractère incomplet de son discours nous aiguille même sur une fausse piste concernant les circonstances de son départ. À la façon dont les trous de son récit suggèrent que ce n’est pas lui qu’elle a quitté, mais simplement son père, on peut imaginer qu’elle a quitté le foyer pour fuir un mari violent.
Voyage à travers les émotions… et retour
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
Ces émotions qui nous dépassent
« Il arrive qu’une émotion nous atteigne, nous étreigne, sans que nous sachions pourquoi ni, exactement, en quoi elle consiste : sans que nous puissions nous la représenter. Elle agit en moi mais elle me dépasse complètement. Elle est en moi mais hors de moi. » C’est par ce paradoxe que l’historien de l’art Georges Didi-Huberman expliquait à une assemblée d’enfants lors d’une conférence qui leur était destinée comment Sigmund Freud décrivait le phénomène d’inconscient qu’il venait d’inventer. Sous son exploration d’une île peuplée de créatures fantastiques, Max et les Maximonstres se présente comme un voyage intérieur au cœur de l’enfance. Leur force inexplicable telles qu’elles traversent le sujet, voilà ce qui est au principe de son prologue « réaliste ».
Les premières séquences font se succéder une série de sentiments qui passent par l’enfant, le bouleversent, le révoltent, sans que le garçon ne les anticipe, les comprenne, les rejette ou les accepte. Un véritable précipité d’émotions qui se bousculent dans son âme. Max fait d’abord preuve de cruauté envers son chien qu’il poursuit agressivement, puis il va se sentir abandonné par sa sœur qui le repousse et refuse de jouer avec lui. Il se montre ensuite despotique dans son jeu solitaire avant d’être excité par la bataille de boules de neige qu’il déclenche avec les amis de Claire. Brutalement, le jeu devient trop violent pour lui et la destruction de son igloo lui est insupportable. Il ressent comme une trahison le fait que sa sœur ne prenne pas sa défense, et la rage le pousse à saccager la chambre de cette dernière avant que le remord et la honte ne le plongent dans l’apathie. Il trouve le réconfort de sa mère qui l’aide à ranger, il éprouve de la peine pour elle lorsqu’il assiste à une conversation professionnelle au cours de laquelle elle voit son travail dénigré, avant de la consoler à son tour. Le lendemain, il sera joyeusement bagarreur dans la cour de l’école avant d’être attentif au cours d’astronomie et profondément déprimé par les nouvelles apocalyptiques qu’il y apprend. Le soir, l’amusement dans sa chambre se mue en ennui, puis en jalousie à l’encontre du petit ami de sa mère, puis en insolence qui gonfle en provocation verbale et gestuelle avant d’aboutir à de la violence physique que la punition transformera en sentiment de profonde injustice. « Ce n’est pas ma faute », conclut le garçon avant de quitter le foyer, cette maison où les sentiments contradictoires se bousculent en lui de façon insupportable et incontrôlée. La rapidité avec laquelle cette foule de sentiments se précipite fait entrer le spectateur avec une certaine violence dans le monde de Max, violence renforcée par un montage qui, à la fluidité des transitions de scène à scène, préfère des raccords qui entrechoquent les atmosphères contradictoires. Réglé de façon expéditive, ce prologue ballotte le spectateur dans un univers chaotique et déprimant qu’il a lui aussi envie de quitter. Or, c’est bien le paradoxe freudien qui rend à Max ces montagnes russes d’affects insupportables : les sentiments passent en lui avec une soudaineté et une violence inouïes, mais semblent lui faire l’effet de corps étrangers qui le colonisent, de monstres sauvages qui s’emparent sans prévenir de son caractère. « Avec Dave Eggers, le scénariste, nous avons essayé que le film traduise une angoisse face à tout ce qui échappe à notre contrôle, notamment les émotions. Les vôtres et celles des autres, vous ne pouvez pas les anticiper, et c’est vraiment effrayant. », raconte Spike Jonze. En cela, le cinéaste est totalement fidèle à l’esprit de l’auteur qui déclarait : « Ce qui m’intéresse, c’est ce que font les enfants dans ces moments particuliers de leur vie où il n’y a ni règles ni lois, où ils ignorent émotionnellement ce que l’on attend d’eux. Dans Max et les Maximonstres, Max se met en colère. Que fait-on quand on est en colère ? Eh bien, on est méchant avec sa mère, après on regrette et, finalement, tout redevient calme. Cela se reproduira peut-être le lendemain et le jour d’après, mais le problème, pour les enfants (…) est de savoir comment passer d’un moment critique à un autre. »
Saccades et ritournelles, moderato cantabile
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par F. Revault d’Allonnes
 Ritournelles « comediante » disait-on à propos des œufs de moineaux ou des trajets avec le père ; petits rituels presque burlesques, disait-on à propos des bagarres ou des jeux des gamins. À quoi s’ajoutent d’ailleurs les passages de trains, qui battent la mesure de cette réitération du quotidien. Dans ce film comme dans toute son œuvre, Ozu colle au quotidien et à ses cycles répétés ; même s’il s’agit en l’occurrence de ritournelles ou de rituels drolatiques, vus ici d’un œil amusé en même temps qu’attendri. Le quotidien avec ses éternels retours coutumiers, est au centre de l’œuvre, la fonde. Et ceci explique que les drames y restent eux-mêmes familiers. Tout comme ceci explique que ces drames ne perturbent finalement qu’à peine la vie quotidienne qui reprend bientôt son cycle ordinaire, tout juste transformé par eux : chez Ozu, la vie quotidienne est la plus forte.
Ritournelles « comediante » disait-on à propos des œufs de moineaux ou des trajets avec le père ; petits rituels presque burlesques, disait-on à propos des bagarres ou des jeux des gamins. À quoi s’ajoutent d’ailleurs les passages de trains, qui battent la mesure de cette réitération du quotidien. Dans ce film comme dans toute son œuvre, Ozu colle au quotidien et à ses cycles répétés ; même s’il s’agit en l’occurrence de ritournelles ou de rituels drolatiques, vus ici d’un œil amusé en même temps qu’attendri. Le quotidien avec ses éternels retours coutumiers, est au centre de l’œuvre, la fonde. Et ceci explique que les drames y restent eux-mêmes familiers. Tout comme ceci explique que ces drames ne perturbent finalement qu’à peine la vie quotidienne qui reprend bientôt son cycle ordinaire, tout juste transformé par eux : chez Ozu, la vie quotidienne est la plus forte.
Des histoires sans paroles
Contes chinois
Extrait du Préambule du Cahier de notes sur…
écrit par Christian Richard,
assisté d’Anne-Laure Morel.
« Celui qui sait ne parle pas.
Celui qui parle ne sait pas. » Lao-Tseu
« Trop de paroles tue l’action. »
« Trop de glue ne colle plus. »
 Excepté Les Têtards à la recherche de leur maman, le plus ancien des courts métrages sélectionnés (créés à l’origine expressément pour être montrés dans des salles de cinéma, même si leur diffusion en public a concerné principalement les grands festivals internationaux spécialisés dans l’animation, où ils ont d’ailleurs été très remarqués), toutes les œuvres présentées sont sans paroles, mais dotées de bandes son d’une très grande richesse et d’une belle inventivité musicale. Elles ont donc été conçues pour être accessibles/ressenties de manière universelle, par delà les systèmes linguistiques. À l’instar de Chaplin, Jacques Tati ou d’autres grands maîtres de l’animation (re)découverts ces dernières années au festival de films Pour éveiller les regards à Aubervilliers, comme Norman McLaren avec Jeux d’images en 1993, Tezuka Osamu avec La Légende de la forêt en 2002 ou dernièrement Paul Driessen avec Des histoires pas comme les autres en 2004, leurs auteurs vont à contre courant, sans violence, de l’attitude passive et pavlovienne du spectateur conditionné (on pourrait dire de manière ironique dès la vie intra-utérine !) par la présence systématique et objectivement rassurante d’un commentaire descriptif et redondant de l’image. Elles s’opposent donc à la pratique dominante de la réception de produits « audio-visuels » imposés aujourd’hui par la télé, dont les enfants sont abreuvés dès l’âge du biberon.
Excepté Les Têtards à la recherche de leur maman, le plus ancien des courts métrages sélectionnés (créés à l’origine expressément pour être montrés dans des salles de cinéma, même si leur diffusion en public a concerné principalement les grands festivals internationaux spécialisés dans l’animation, où ils ont d’ailleurs été très remarqués), toutes les œuvres présentées sont sans paroles, mais dotées de bandes son d’une très grande richesse et d’une belle inventivité musicale. Elles ont donc été conçues pour être accessibles/ressenties de manière universelle, par delà les systèmes linguistiques. À l’instar de Chaplin, Jacques Tati ou d’autres grands maîtres de l’animation (re)découverts ces dernières années au festival de films Pour éveiller les regards à Aubervilliers, comme Norman McLaren avec Jeux d’images en 1993, Tezuka Osamu avec La Légende de la forêt en 2002 ou dernièrement Paul Driessen avec Des histoires pas comme les autres en 2004, leurs auteurs vont à contre courant, sans violence, de l’attitude passive et pavlovienne du spectateur conditionné (on pourrait dire de manière ironique dès la vie intra-utérine !) par la présence systématique et objectivement rassurante d’un commentaire descriptif et redondant de l’image. Elles s’opposent donc à la pratique dominante de la réception de produits « audio-visuels » imposés aujourd’hui par la télé, dont les enfants sont abreuvés dès l’âge du biberon.
Ces courts métrages chinois sollicitent de la part du spectateur une concentration peu usitée, l’incitant sans retenue à faire fonctionner son imagination, lui offrant la liberté de construire ses propres histoires au gré de sa propre interprétation. Une attitude
« pédagogique » très saine, mais aussi peut-être très déroutante, à l’encontre de ce que vivent petits et grands aujourd’hui habitués à « zapper » sporadiquement l’image de leur téléviseur : on peut en effet facilement aller ouvrir une porte, faire la cuisine, la vaisselle, répondre au téléphone (sacré portable !), ou se soulager… Même si l’image du récepteur n’est plus présente quelques instants, le son, d’une pièce à l’autre, entretient le lien et continue de diffuser l’information basique qui permet de ne pas perdre le fil de « l’histoire » … Ce qui est hélas concevable pour un téléfilm ne peut pas s’appliquer à une œuvre cinématographique digne de ce label que l’on ne peut réduire, pas plus qu’un roman ni un poème, à un simple argument ou à la trame de l’histoire qu’elle raconte…
Aussi, le caractère inhabituel, déroutant (et devenu contrenature !) requérant une attitude active (et non plus passive, dépouillée de sa forme adjuvante inutile) doit être souligné lors des projections.
Pour preuve, à la fin d’une copieuse présentation du film de Chaplin Le Cirque, annoncé comme comique (drôle), mais sans paroles, cette question angoissée d’une petite de CE1 : « Monsieur, mais comment on va faire pour rire, s’ils ne parlent pas ? ». À l’issue de la projection, 1h10 plus tard, constat et explication évidente de la même, soulagée d’avoir bien ri : « Ben, y avait qu’à regarder ce qu’on voit… et puis d’écouter les musiques ! »…
Jeux d’acteurs, jeux d’auteurs
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
Les intentions des auteurs du film, leur personnalité, leur humour, leurs origines, leur amour du cinéma transpirent par tous les pores du film, particulièrement dans les actions, souvent ludiques, des personnages principaux. Les « acteurs » bricolent, s’amusent, ils sont insousciants. Pendant que les auteurs se racontent, racontent le studio Aardman, auquel ils sont tous deux liés depuis des décennies. On analysera tour à tour plusieurs de ces composantes : l’importance du bricolage, la cohabitation entre humains et animaux, les multiples références cinématographiques, l’affection pour les gens de condition modeste, puis bien sûr la composante « british », et enfin l’humour.
Les as du bricolage
Depuis Une grande excursion, les scènes de bricolage sont légion dans les productions Aardman. Et Shaun ne déroge pas à la règle, tant s’en faut. Plusieurs fois dans le film, l’intrigue avance à grand renfort d’inventions improbables bricolées avec divers objets du quotidien ou de récupération. Leur mise en œuvre suit un canevas souvent similaire : après maturation de l’idée et brainstorming, des plans sont dessinés, puis le projet fabriqué dans une grande effervescence et une grosse débauche d’énergie. Malgré toute la bonne volonté, on a peine à croire que le résultat sera à la hauteur des espérances, mais contre toute attente, ça fonctionne.
Au début du film, le premier plan échafaudé est conçu pour se débarrasser du fermier. Shaun entraîne ses compagnons dans son projet, expliqué préalablement sur un tableau noir. Les moutons sont chargés de sauter en boucle au-dessus d’une haie pour endormir le fermier, qui est ensuite trimballé dans une brouette et enfermé dans une caravane stationnée au bout de la propriété. En même temps, un colvert (soudoyé en pain rassis) détourne l’attention du chien Bitzer avec un os tiré au bout d’une ficelle. Pour maintenir le fermier endormi, Shaun donne l’illusion de la nuit en dessinant un paysage nocturne sur le store baissé de la fenêtre de la caravane.
Plus tard, Shaun emmène tous les moutons dans un magasin de vêtements de seconde main pour les déguiser en humains. Le stratagème a l’air bancal mais personne ne semble remarquer la supercherie, pas même le sagace Trumper qui a pourtant le temps de bien les observer lorsqu’ils sortent du magasin. Plus loin encore, les moutons mettront au point un plan d’évasion pour faire sortir Shaun de prison, et Shaun dessinera un nouveau trompe-l’œil pour se sortir de là. Le retour final à la campagne se fera aussi grâce à une nouvelle invention : un cheval pantomime sophistiqué et boitillant traversant la ville sans trop attirer l’attention des passants.
Lire l’intégralité du texte dans la plateforme NANOUK
La beauté du geste
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Emmanuel Siety
Dans la catégorie des films « de cape et d’épée », la première version du Signe de Zorro avec Douglas Fairbanks occupe une place fondatrice. Fairbanks y campe un personnage héroïque, différent de ceux auxquels il était accoutumé et qui étaient plus proches de la comédie (même si le personnage de Diego est encore prétexte à comédie dans le film de Niblo). Couronnée de succès, cette tentative de Fairbanks inaugure une série de films d’aventures à grand spectacle (Les Trois Mousquetaires, Robin des bois, Le Voleur de Bagdad, Le Pirate noir…). Fairbanks, acteur et athlète, y accomplit lui-même les cascades, faisant feu de tout bois (édifices, rideaux, voiles de navire, tables, jarres, balcons…).
Le film de Rouben Mamoulian avec Tyrone Power appartient à la deuxième génération des films de cape et d’épée, celle du cinéma sonore des années 1930-1940 dans laquelle s’illustra particulièrement Errol Flynn, et qui puise en partie dans le stock des sujets déjà traités à l’époque du muet (exemplairement : Zorro et Robin des bois).
Selon Tom Milne, auteur d’un livre sur Mamoulian, certains critiques jugèrent à l’époque que Tyrone Power n’accomplissait pas suffisamment de prouesses physiques en comparaison de son illustre prédécesseur Douglas Fairbanks. Par ailleurs, contrairement à Fairbanks, Power était doublé dans les scènes d’action. De telles réserves tranchent pourtant avec l’impression que laisse le film – impression de virtuosité, de fluidité, de mouvement, sensation d’action. Milne l’exprimait à sa façon en observant que si Power n’avait pas la combattivité et le mordant d’un Fairbanks, la mise en scène de Mamoulian y suppléait largement. Il ne faudrait pourtant pas s’en tenir à l’idée d’un réalisateur palliant par la mise en scène les faiblesses de son acteur, car le plaisir que procure le film est incontestablement « conduit » par les corps des trois acteurs principaux (Tyrone Power, Linda Darnell, Basil Rathbone. Il est toutefois vrai que Le Signe de Zorro nous invite à évaluer plus finement ce que peut être l’action, ou la « sensation d’action », dans un film qui vise précisément à satisfaire certaines attentes du public de ce côté-là.
Les enfants millionnaires
« Vite, je suis pressée », signifie Teresinha au patron du Magasin des tentations, après lui avoir dicté la liste des articles qu’elle cherche à se procurer. L’injonction résonne avec l’ardeur qui traverse le film de part en part. Tourné en 1942, Aniki-Bóbó, se libère d’une double pression : l’Estado Novo, en vigueur depuis 1926, étouffe la nation sous un ordre moral pétrifié ; la Seconde Guerre mondiale coupe la péninsule ibérique du reste de l’Europe et plonge le Portugal dans un état d’hébétude. C’est pourtant dans ce contexte que Manoel de Oliveira, jeune auteur d’un documentaire, réalise sa première fiction. Une œuvre à nulle autre pareille : tout en avouant sa dette au cinéma muet, Aniki-Bóbó innove, franchit des limites, tresse les genres, déplace les cadres. Un film consacré au monde de l’enfance ? Oui, mais en essayant « de faire miroiter chez les enfants les problèmes de l’homme », selon le mot du maître. Ainsi, la scène d’ouverture : tandis que sa mère tente de mettre de l’ordre dans ses cheveux, on voit Carlitos jouer avec une figurine en porcelaine. Absorbé par son jeu, le garçon ignore jusqu’à la présence l’adulte, attitude que la caméra imite en excluant la femme de l’écran. Pendant que sa mère le coiffe, Carlitos donne des pichenettes sur la tête mobile de son jouet en répétant sa formule rituelle – « Aniki-Bóbó » –, refrain de la version portuense du jeu des gendarmes et des voleurs. Lorsque, à la suite d’un mouvement brusque, la figurine tombe par terre et se casse, la mère le traite de bouffon (« bobo », en portugais) et lui assène une gifle. L’enfant s’enfuira, heureux de retrouver la liberté dans les ruelles ensoleillées de la ville, mais l’exclamation de la mère, faisant écho au thème principal du film, sonne le signal de départ du jeu : Carlitos sera-t-il gendarme ou voleur ?
La réversibilité et les oppositions renvoient non seulement à la dimension morale du film, mais elles affectent également l’intrigue et la structure du récit. Teresinha ne cesse d’osciller entre Eduardo et Carlitos, celui-ci apprendra le Bien à travers le Mal, les variations d’échelle assouplissent les contrastes entre enfants et adultes. Si la personnalité de Carlitos, timide et sensible, tranche avec celle, affirmée, de son rival, son caractère se révèle néanmoins contrasté : innocent en ce qui concerne l’accident, il est toutefois coupable du vol. Paradoxalement, c’est à Eduardo qu’il reviendra de révéler les marques de cette dualité : d’abord en poussant Carlitos dans une flaque de chaux dans la rue, puis en lui décochant à l’aide d’une fronde une boulette de papier trempée dans de l’encre. Et Teresinha ? Elle est l’arbitre de la scène, et lorsqu’elle suit du regard les deux garçons qui défilent sous son balcon, ce sont les grandes lignes de la dramaturgie du récit qui semblent résumées dans son champ de vision : un premier plan subjectif montre le groupe dont s’isoleront successivement Eduardo et Carlitos, deux autres vues cadrent ensuite individuellement les concurrents. La scène se poursuit enfin avec un plan qui annonce la confrontation physique des deux prétendants…
Lire le texte intégral sur la plateforme NANOUK
L’artiste et le vagabond
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
écrit par Charles Tesson
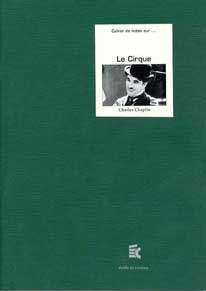 Charlot, accusé d’un vol qu’il n’a pas commis, se réfugie dans la galerie des glaces d’un spectacle de foire. La façade de la galerie, visible au fond de l’image, ressemble à un bateau. C’est vers elle que Charlot se dirige en se joignant au groupe lorsqu’il fait sa première apparition à l’écran, de dos. Entre la terre ferme où sont attroupés les badauds et ce monde promis et invisible, de l’autre côté de la carcasse du navire, il y a un ponton, suspendu dans le vide, première zone d’équilibre à franchir et à surmonter pour y accéder. Étrangement, ce décor de bateau évoque l’Arche de Noé. Il n’y a pas de déluge visible, à l’échelle cosmique et communautaire, mais il y a un naufrage personnel. Celui de Charlot le vagabond, dont on comprend vite qu’il a faim (le gâteau du bébé qu’il mange à la dérobée), puis qu’il est affamé (la nourriture qu’il s’achète en plus avec l’argent providentiel). Dans la galerie des glaces, ce ne sont pas les miroirs qui trompent l’œil mais l’opposition entre la promesse du décor (l’Arche de Noé) et son contenu. À l’intérieur, les miroirs réfléchissent à l’infini, démultipliée et éclatée, une image de soi. Il n’y a plus de place pour l’Autre, le reste de la communauté des hommes et le monde animal. La galerie des glaces sera un refuge provisoire, sans avenir, car le monde du cirque sera ce vrai lieu conforme à cette vitrine de spectacle en forme de ce décor de bateau : l’humanité retrouvée, la cohabitation heureuse, magiquement pacifique, avec l’espèce animale (la scène avec le lion en cage).
Charlot, accusé d’un vol qu’il n’a pas commis, se réfugie dans la galerie des glaces d’un spectacle de foire. La façade de la galerie, visible au fond de l’image, ressemble à un bateau. C’est vers elle que Charlot se dirige en se joignant au groupe lorsqu’il fait sa première apparition à l’écran, de dos. Entre la terre ferme où sont attroupés les badauds et ce monde promis et invisible, de l’autre côté de la carcasse du navire, il y a un ponton, suspendu dans le vide, première zone d’équilibre à franchir et à surmonter pour y accéder. Étrangement, ce décor de bateau évoque l’Arche de Noé. Il n’y a pas de déluge visible, à l’échelle cosmique et communautaire, mais il y a un naufrage personnel. Celui de Charlot le vagabond, dont on comprend vite qu’il a faim (le gâteau du bébé qu’il mange à la dérobée), puis qu’il est affamé (la nourriture qu’il s’achète en plus avec l’argent providentiel). Dans la galerie des glaces, ce ne sont pas les miroirs qui trompent l’œil mais l’opposition entre la promesse du décor (l’Arche de Noé) et son contenu. À l’intérieur, les miroirs réfléchissent à l’infini, démultipliée et éclatée, une image de soi. Il n’y a plus de place pour l’Autre, le reste de la communauté des hommes et le monde animal. La galerie des glaces sera un refuge provisoire, sans avenir, car le monde du cirque sera ce vrai lieu conforme à cette vitrine de spectacle en forme de ce décor de bateau : l’humanité retrouvée, la cohabitation heureuse, magiquement pacifique, avec l’espèce animale (la scène avec le lion en cage).
D’emblée, le cirque est ce monde de l’autre côté de la passerelle, et le spectacle, par le biais de ce décor singulier, est associé à l’invitation au voyage : larguer les amarres d’un quotidien difficile et désespérant, partir au loin pour tout oublier. Sauf que chez Chaplin, essence de son art, le spectacle ne se détache jamais entièrement de la réalité car, par le rire, il y ramène tout le temps.
La scène dans la galerie des glaces, où le corps est reflété dans une mosaïque d’images, est la mise en perspective des multiples identités biographiques et cinématographiques de Chaplin. Il y a d’un côté la figure complexe de Charles Chaplin, l’homme à la ville, connu et attaqué à l’époque par les ligues puritaines pour ses problèmes conjugaux (nombreux divorces) et critiqué pour ses engagements politiques (ses sympathies pour le régime soviétique qui lui vaudront de sérieux ennuis au moment du maccarthysme), et l’artiste, tour à tour acteur, réalisateur, musicien et ici chanteur, sans oublier l’homme d’affaires indépendant, producteur de ses films et propriétaire d’un studio qu’il a fait construire à Hollywooden 1916. De l’autre côté, il y a la figure simple et mythique, universellement connue : Charlot, l’homme à la canne et au chapeau melon, les mimiques, le langage du corps qui a franchi toutes les barrières des langues. Dans la galerie des glaces, la relation duelle entre Charles Chaplin et sa légende vivante, Charlot, est gravement perturbée. La confusion identitaire est souvent le moteur et le sujet de nombreux films de Chaplin. André Bazin, dans un célèbre texte, disait que Chaplin a fait Le Dictateur pour récupérer la moustache de Charlot qu’un mauvais autre, Adolf Hitler, lui avait volée, faisant du tort à son image. Hitler, aux yeux de Chaplin – ils sont tous les deux nés en 1889 – est un double imposteur. Accessoirement, parce qu’il a attenté à la personne de Charlot : le plagiat et la confusion de la moustache. Profondément, parce qu’il s’en est pris à l’humanité tout entière. L’identité et sa confusion est également le sujet de Monsieur Verdoux où la femme du héros ainsi que la police ignorent les multiples rôles et noms d’emprunts de Verdoux au gré de ses conquêtes féminines. Dans la galerie des glaces, Charlot ne se retrouve pas seul car il est poursuivi par un policier. On peut voir dans cette course-poursuite diffractée en des points multiples le rappel emblématique, à partir de son noyau originaire minimal (Charlot et le policeman), de ce que furent les multiples courts métrages burlesques de Chaplin qui, autour de cette situation à répétition, de film en film, contribuèrent à sa gloire. On peut y voir également, puisque ce décor est un lieu de transition entre la réalité extérieure et l’autre monde à venir, celui du cirque, un hommage en forme d’adieu à un monde cinématographique passé, en constante évolution.
L’Homme invisible
L’étrange homme du parlant
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Tesson Charles
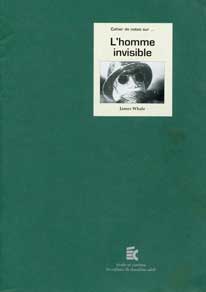
De tous les films à la charnière du muet et du parlant, L’Homme invisible est le plus riche et le plus profond. C’est dans le regard qu’il porte sur ce changement de nature technique que le film est à proprement parler, fantastique. Dans le muet, le corps est visible mais la voix inaudible. Dans le parlant traditionnel, le corps gagne sur les deux tableaux : on continue de le voir et on l’entend parler. Dans la version que propose le film, il en va tout autrement. Ce que le corps gagne d’un côté avec la voix, il le perd en raison de sa soudaine invisibilité. Soit on voit le corps sans l’entendre (le muet), soit on l’entend sans le voir. Problème de transfert par conséquent, la qualité du report optique s’accompagnant d’une déficience dans l’enregistrement des images. La voix de l’homme invisible émane d’un corps réel qui a le défaut ou l’avantage d’être imperceptible à l’œil. Ce corps vocal présent (le lieu de la voix) et absent, invisible, redouble la condition de la voix radiophonique. Le début du parlant, en plus de s’inspirer du théâtre, a surtout été subjugué par la puissance de la radio. En ce sens, L’Homme invisible est le contemporain du dispositif sonore de Mabuse du Testament et il annonce les dispositifs sonores explorés par Orson Welles, aussi bien à la radio (son adaptation de La Guerre des mondes, d’après H. G. Wells) qu’au cinéma.
Jiburo
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Tesson Charles

« Puise en toi l’idée de ce que tu peux faire pour les autres, voilà qui te mettra dans le sens du ren ! »
(Entretiens de Confucius, « Des disciples »,
Livre VI, 28).
Un enfant des villes, de la génération des jeux vidéo, se retrouve en vacances forcées chez sa grand-mère, en pleine campagne reculée, coupée de tout. Le tableau est dressé mais il s’agit seulement d’un cadre, non de la finalité de l’histoire. Si l’enfant retourne à la fin à Séoul avec sa mère, le film, à aucun moment (c’est heureux) ne l’a mis en demeure de choisir entre deux modes de vie, deux types de confort. Certes, on joue sur les contrastes (une télé qui ne fonctionne pas, la galère pour trouver des piles, l’absence de KFC dans le secteur) mais on ne verra pas au final l’enfant, même s’il se débarrasse de ses jouets avant de rentrer, devenir un adepte d’un retour à la nature ou faire le choix d’un renoncement à l’austérité monacale. L’enrichissement se situe ailleurs. Le parcours de l’enfant ne va pas dans le sens d’une opposition tranchée entre tradition et modernité, le film ayant l’intelligence de ne pas s’enfermer dans ce schéma. Jiburo ou Sur le chemin de la maison (on aurait envie d’ajouter, « sur le chemin de la raison ») est le récit d’une transformation intérieure, l’histoire d’un enfant qui passe de l’égoïsme à la découverte du lien affectif, tissé à partir du besoin de l’autre et de l’expérience du manque. L’envers de l’égoïsme serait moins l’altruisme que le sentiment de solitude, l’absence ressentie de l’autre et le vide qu’il laisse en soi. D’où l’importance des mots écrits, des dessins, sur lesquels le film s’achève. Sang-woo est ce qu’on appelle un « enfant-roi », parfois rebaptisé familièrement « tête à claques », tant il est insupportable et caractériel. Des claques, il en reçoit, de sa mère, et il en distribue aussi (il bouscule la grand-mère), même s’il semble plus habile de ses pieds, contre sa mère et contre le pot qu’il envoie valser par terre. Manifestement, personne ne lui résiste et tout le monde semble s’écraser devant ses caprices et ses exigences. Sa mère n’est plus à la hauteur et ne maîtrise plus la situation. La grand-mère et le jeune voisin, Cheol-yee, sur le même registre comportemental, ne sont pas rancuniers. Ils le laissent faire ses écarts sans rien lui dire. Ils semblent sans réaction et font montre d’une extrême tolérance. Tous les deux refusent la surenchère du « œil pour œil », celle de la riposte immédiate, du cercle de la vengeance et de la réprimande. Non violents, ils sont tous les deux (on y reviendra) les deux sages confucéens du film, deux maîtres d’une maîtrise qui ne passe pas par le contrôle, la discipline, la sanction et la punition et qui apprennent à l’enfant à devenir humain. En revanche, une seule personne lui tient tête, la fillette Hae-yeon qui le gronde ouvertement pour avoir piétiné son aire de jeu et exige des excuses sur le champ. L’enfant s’écrase sans riposter, fait exceptionnel, parce qu’il veut lui plaire, entrant dans un rapport de séduction et de reconnaissance (être vu d’elle, attirer son attention)…
King Kong
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Tesson Charles

Il y a eu des suites, conçues en partie par ceux qui avaient mis sur pied l’original (voir « Autour du film »), il y a eu des remakes, dont celui récent de Peter Jackson (2005) et la version de 1976 avec Jessica Lange signée par John Guillermin, habitué aux James Bond, mais aucun de ces films n’est parvenu à effacer entièrement le souvenir du premier King Kong. Pourquoi ?
Vertige des frontières
Plusieurs raisons à cela, qui tiennent à la nature singulière du film, à la fois accomplissement du parcours personnel de deux hommes, Cooper et Schoedsack, qui ont beaucoup mis d’eux-mêmes dans le personnage de Denham (un autoportrait sous la forme d’un double qui transgresse leur comportement de cinéastes), et radiographie d’une époque. Celle de l’Amérique lors de la Dépression qui, face à la réalité du chômage (files d’attente des femmes au début, quémandant leur repas, Ann volant de la nourriture et acceptant une proposition d’emploi, perçue comme une aubaine), a besoin de spectacle et d’évasion pour faire oublier la crise : King Kong, la huitième merveille du monde, exhibée dans un théâtre de Broadway, jusqu’au film lui-même comme réponse à la demande du public dans ce contexte particulier. Le divertissement proposé n’oublie pas ses origines, puisqu’il se donne lui-même comme une réponse au malaise de son temps qu’il prend soin d’exposer. Mieux, l’évasion recherchée, par la direction qu’elle prend, est une remontée aux origines, un questionnement de l’Amérique, de l’humanité aussi, dans ses fondements et surtout ses frontières. Frontières entre le territoire américain et l’ailleurs, sauf qu’il n’est pas le territoire de l’avenir, puisque l’Amérique estime en avoir le monopole, mais la terre originaire, un continent lointain oublié (l’île ne figure sur aucune carte) que l’Amérique estime avoir dépassé culturellement ou tout simplement refoulé. Frontières entre les races ensuite (« les blondes sont rares par ici » constate Denham, voyant l’attrait suscité par Ann auprès du chef du village) et tableau désarmant de leur inégalité affichée, intériorisée par le chef disposé à offrir six jeunes femmes noires contre Ann, comme s’il fixait sans les avoir la valeur d’échange, boursière, de l’action féminine (une blonde vaut six noires), selon les cours en vigueur sur le marché américain d’alors. À moins qu’il n’anticipe le juste prix de l’offrande à Kong, puisque l’animal géant sera touché par la valeur extraordinaire de ce présent qui le conduira à découvrir l’Autre Monde, dont il ne reviendra pas. Dans cette frontière entre les sexes, seules les femmes sont exposées, en offrande forcée au singe géant (les femmes noires, Ann) ou offertes en pâture à la caméra pour les besoins du film que tourne Denham. Avant que Kong ne soit publiquement exhibé et sacrifié sur l’autel du spectacle, divinité des temps modernes. Répartition entre les races surtout, car la population noire du film (les indigènes du village et les figurants du tournage) est exclusivement rassemblées sur l’île, alors que dans les scènes se déroulant à New York, au début comme à la fin, on ne voit jamais de Noirs, pas plus que sur le bateau. Comme si ce nettoyage ethnique plus ou moins conscient faisait l’objet d’un déplacement, ayant pour effet de placer la population noire manquante de New York face au reflet de ses origines, sur un plan géographique, culturel et politique (la mémoire enfouie de l’esclavage, partie de cette île). Un sorte de transfert originel, comme si l’Amérique, en absentant les Noirs de son territoire, voulait rappeler d’où ils viennent ou bien les y ramener. Seul un Chinois sur le bateau (acteur grimé, selon les usages au cinéma à l’époque) porte la trace, la plus minime qui soit, de la diversité ethnique de l’Amérique, à l’écart de l’hégémonie blanche par ailleurs affichée. Frontière des sexes et des races, avec substitution à la clé (une femme blanche pour Kong à la place d’une femme noire), objet du dérèglement fictionnel car tout serait resté dans l’ordre si on avait offert à Kong une femme noire, son « pain quotidien ». Rupture dans le rite qui a pour conséquence d’activer un fantasme du métissage et surtout sa phobie, que la figure de Kong, au nom de l’île, puisqu’il en est le roi, a pour charge d’endosser. Frontière entre le monde humain et animal pour finir, matérialisée sur l’île par la forteresse qui sépare la communauté noire des animaux tout en installant une proximité de fait tandis que dans les images de New York, au début et à la fin, on n’aperçoit aucun animal (autre forme de refoulement, en écho à celui des Noirs, associés « naturellement » avec le monde animal, au nom de la promiscuité de l’évolution des espèces), à l’exception de Kong lui-même et du désordre qu’il cause. Seul un singe, aperçu sur le bateau, préfigure la promiscuité à venir et la confusion irréversible qu’elle va provoquer. Monstre lui-même, par son gigantisme, mais animal contemporain de l’homme par l’espèce qu’il représente, Kong domine et extermine, en preux chevalier défendant sa belle, tous les animaux préhistoriques, rampants et volants. Cette domination de Kong sur le monde animal et la population indigène qui le craint, ce jeu infini des frontières contribuent à faire du film une curieuse fantaisie sur l’évolution de l’espèce, de l’animal préhistorique à l’animal contemporain de l’homme, du sauvage au civilisé, jusqu’à la fiction de l’origine de l’homme, supposé descendre du singe, alors que l’attachement amoureux et érotique de Kong pour les femmes contribue à son anthropomorphisation. L’île, où cohabitent le monde préhistorique et la communauté noire (merci pour eux), sous la coupe du singe géant, seul capable d’une entente avec les hommes, se trouve à dix mille lieues du monde moderne, capitaliste, symbolisé par New York et Manhattan. Pour cette raison, on peut voir dans King Kong le premier film catastrophe du cinéma hollywoodien à faire de l’origine des espèces comme de son montage entre l’animal et l’homme, ainsi que du retour du refoulé de cette association, l’objet même du chaos. Dès que l’animal change d’environnement, passant de la jungle archaïque à la jungle urbaine, des oiseaux préhistoriques qui l’agressent et qu’il domine, au sommet de la montagne où il a élu domicile, aux avions, oiseaux des temps modernes qui auront sa peau, le chaos menace de renverser l’ordre du monde et de tout anéantir. Le ciel, une fois de plus, sauve l’Amérique, puisqu’une fois encore elle n’a pas voulu regarder la réalité du sol et de ses origines, là d’où elle vient…
La Nuit du Chasseur
La poupée du diable
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Tesson Charles

Le prologue céleste, où une vieille femme dans la nuit étoilée commente la Bible à des enfants, installe une atmosphère (la candeur irréaliste d’un conte de fées biblique) tout en désamorçant l’enjeu narratif du long épilogue où le prêcheur Harry Powell (Robert Mitchum) rôde autour de la maison de Rachel Cooper (Lillian Gish), à la recherche du trésor. Avant même que l’histoire ne commence, la communauté enfantine rassemblée autour de la mère est en sécurité, hors d’atteinte du danger qui rôde en contrebas. Lorsque la barque des enfants endormis s’échoue dans l’herbe, un mouvement de caméra ascendant découvre la voûte étoilée du ciel. […] Film sur « la fin de l’innocence (l’adieu au monde avant la distinction du bien et du mal), l’expérience d’un désenchantement, d’un temps à jamais révolu, que seul l’amour du cinéma, de ses récits en ombres imagées, peut mélancoliquement réchauffer. Le cinéma a besoin du mal pour être aimé afin que l’homme ressente en lui cet exil de l’enfance, ce souvenir d’une terreur indicible dont il demeure inconsolé. Sans cette appréhension renouvelée du spectre de la mauvaise rencontre pas de vrai désir de cinéma. »
Le Passager
L’enfant cinéma ou l’écran blanc d’un rêve évanoui
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Tesson Charles

Lorsque Gassem entre en classe, en pleine leçon de lecture, il feint un mal aux dents pour justifier son retard alors que le spectateur en connaît le motif : le temps qu’il lui a fallu pour ranger chez lui le matériel de jeu, celui passé devant un kiosque à journaux afin d’acheter une revue de football. Alors que le visage de Gassem apparaît dans l’embrasure de la porte, déguisé conformément au personnage qu’il s’est construit pour abuser le professeur (la douleur dont le tissu enroulé autour du visage devient le signe ostentatoire), la voix de l’élève qui n’a pas interrompu sa lecture donne à cette entrée en scène une résonance particulière. L’enfant, les yeux rivés sur son livre, ne voit pas qu’il parle sur ce visage, de ce visage : « Et c’est comme s’ils fuyaient quelque chose. Une ambiance triste régnait. » Plus loin : « Kazad n’avait qu’une seule idée, s’enfuir, s’enfuir de toutes ses forces. » Le déguisement de Gassem est une première fuite. Il se fait passer pour ce qu’il n’est pas : un enfant qui a mal au dents. Cette fuite dans le rôle n’a pas une finalité ludique, pour le plaisir de tromper le professeur, car elle répond à une appréhension de la réalité. Face à son évidence, celle de son retard en classe, Gassem ruse et triche pour sauver sa peau. La manipulation ne donne pas à celui qui l’exerce le goût du pouvoir car elle s’inscrit dans une logique de survie. Plus concrètement dans Le Passager, dans la logique d’une survie du désir. Gassem ne vit le temps du film que pour une seule chose : aller voir l’équipe nationale de football jouer à Téhéran. Tel est son désir. Intervenir sur la réalité pour son propre compte, c’est se donner les moyens de satisfaire son désir, la meilleure façon pour que la réalité soit son alliée et non plus cet obstacle qui menace d’y mettre un terme. Manipuler revient à jouer avec la peau des apparences pour abuser les autres, afin de maintenir à flot un désir à fleur de peau. Gassem, comme Kazad, ne songe qu’à une seule chose : s’enfuir. Quitter l’espace familial, celui de l’école. Laisser tomber ses amis, aussi bien ceux avec qui il joue au football que son meilleur ami Akbar. Le Passager retrace l’évolution de cette idée, son cheminement dans la réalité. Gassem ne part pas contre la réalité dans laquelle il vit. Il ne s’agit pas d’une fuite négative mais d’une aspiration vers un ailleurs qu’il ne connaît pas et qui l’attire à partir d’un monde d’images : les photos des joueurs et des équipes accrochées au kiosque, celles qui ornent les murs de sa chambre, celles qu’il regarde dans la revue. Gassem sera ce passager, cet enfant qui fera la navette entre la réalité proche dans laquelle il vit et qui pour lui ne fait pas image et ces images du lointain, pour lui sans réalité. Histoire de voir de plus près de quoi elles sont faites. Une traversée du miroir, à la mesure de l’étoffe d’un rêve, afin de vérifier, de l’autre côté des images, leur coefficient de réalité.
L’attrait du lointain
Le pouvoir d’attraction de la ville, son impact dans l’imaginaire des gens qui se font des illusions sur son compte, fantasmant en ce lieu la réponse à toutes leurs attentes, est un sujet qui traverse toute l’histoire du cinéma. À commencer par L’Aurore de Murnau. Nul doute que Satyajit Ray, avec la trilogie d’Apu, a donné naissance à une forme de récit dans laquelle un film comme Le Passager vient s’inscrire. Parce que la trilogie d’Apu répond à une réalité démographique précise (l’exode rural, le repli des populations pauvres vers les villes) tout en greffant sur ce constat une aspiration plus profonde, d’une autre nature. Apu quitte la campagne pour la ville afin de poursuivre ses études. La ville est le monde du savoir, celui du livre et de l’écriture, dans le sillage de la voie tracée par le père. Dans ce passage au monde adulte qu’elle symbolise, la ville est l’expérience d’un deuil impossible, celui de l’enfance et des origines. Pour Gassem, la ville serait plutôt ce théâtre qui permet à son imaginaire de s’épanouir en toute liberté, là où la réalité environnante ne laisse plus de place à son rêve pour s’exprimer. On verra ce qu’il lui en coûtera de croire en cela. Gassem veut partir au loin mais il part pour revenir. Son voyage n’est pas définitif. Il va là-bas juste pour voir. Il s’agit d’une expérience passagère, dont la futilité apparente, au vu de son envie soudaine (pourquoi ce match plutôt qu’un autre ?) est contredite par la détermination de Gassem à vouloir en faire aussitôt la chose de sa vie, celle par où il doit absolument passer et dans laquelle toute son énergie va passer. Si voir le match est son rêve, Gassem n’est pas un rêveur. Mieux, son application à rendre son rêve possible nous montre, étape après étape, qu’il n’est plus tout à fait un enfant égaré dans l’univers de ses songes. Il sait se prendre en charge tout seul, s’affranchissant de toute tutelle (l’organisation de son voyage, son sang-froid et son aplomb en toutes circonstances face aux adultes) et il brave la loi, même s’il n’ignore pas le châtiment qu’elle va lui réserver : son cauchemar pendant le match, appréhension de ce qui l’attend concrètement à son retour au village. Gassem, par son entêtement, son intransigeance, l’égoïsme fondamental de son désir, garde ce trait de caractère dur et inflexible de l’enfant. Par définition, l’enfant est celui qui ne veut rien céder de son désir. Pour Gassem, le désir ne connaît pas de limites dans la réalité. Mieux, la réalité est pour lui l’écho narcissique d’un désir passé dans le champ de sa volonté. L’historiser, le socialiser, c’est lui apprendre qu’il n’est pas seul au monde (tenir compte des autres) et que la réalité, « au jeu du désir », n’est pas nécessairement ce théâtre enchanteur mais une possible expérience du désenchantement. Travail que Kiarostami, par le film, accomplit pour lui.
Un rendez-vous manqué
Gassem a envie de voir un match de football mais, à la lueur d’une scène des Quatre Cents Coups de Truffaut et lorsqu’on sait l’attirance d’Abbas Kiarostami pour des personnages qui lui ressemblent, il est possible d’habiller son désir du vêtement d’une autre réalité. Ali Sabzian, le faux Makhmalbaf de Close Up avait le désir d’être metteur en scène et, pour ce faire, devenait acteur en se faisant passer pour ce qu’il n’était pas. Gassem a un désir de spectateur : voir un match de football. À sa manière, il est un enfant cinéphile qui, à la tombée de la nuit, alors que toute la ville dort, quitterait la maison en cachette, billet à la main, pour se réfugier dans l’obscurité d’une salle de cinéma…
la Ruée vers l’or
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Tesson Charles

Le cinéma muet de Chaplin a aimé ces longs fondus au noir pour isoler scrupuleusement chaque séquence. Lorsque le cinéaste a décidé de sonoriser le film, de le raccourcir en supprimant les intertitres, commentant les situations de sa voix ou restituant les dialogues, il a conservé ces longues marques de ponctuation. L’étonnement premier devant le phénomène du cinéma et la réalité de la salle où sont projetées les images, avec cette séparation entre l’écran de lumière et l’obscurité qui l’entoure, a imprégné la matière des premiers films. A chaque début de séquence, pensée inconsciente du lieu où le film sera montré, chaque nouvelle image se doit de figurer et de rappeler la nuit dont elle est issue, et où elle va vivre, et qui ne cesse de l’accompagner dans ses bords. Le noir de la salle entoure l’écran tandis que du noir entoure.
Naturalisme burlesque
De tous les films de Chaplin, la Ruée vers l’or est celui dont on garde une idée de blancheur, en raison des vastes étendues de neige secouées par la tempête, associée à une sensation de froid. Parmi les nombreuses images de Charlot vagabond, celles où on le voit transi de froid, couvert de neige et protégé par une couverture, permettent d’identifier la Ruée vers l’or au sein de la continuité de son personnage. L’or convoité scintille imaginairement dans l’esprit de Big Jim, dans ses mains aussi, car on ne peut pas dire que Charlot soit un prospecteur acharné, mais son éclat n’irradie pas l’image ni ne suscite visuellement une quelconque brillance. Dès le début, suite au défilé de chercheurs d’or gravissant le col enneigé, on découvre Charlot à part, solitaire, marcheur tranquille, peu empressé, suivi d’un ours débonnaire. Il a bien une carte, rustique, car elle indique le nord, le sud, l’est et l’ouest mais, vierge de tout emplacement désigné, elle suggère qu’il n’y a rien à creuser, nul lieu où se fixer, mais juste à se déplacer dans une direction quelconque. Suite à la découverte de cette carte avec des propositions de directions dans un monde inexistant, non tracé, l’intelligence du montage de Chaplin fixe immédiatement deux directions possibles au personnage de Charlot. Soit la mort, avec la tombe du chercheur, qui est la première chose qu’il trouve sans l’avoir cherchée, sitôt la carte dépliée, et l’or trouvé par Big Jim, non loin de là, au même moment. Entre ces deux directions, qui débouchent sur deux actions similaires, à savoir creuser pour enterrer un cadavre ou creuser le sol pour en extraire de l’or, il reste au personnage de Charlot, pour éviter l’une (la mort) et avoir l’autre (l’or), de mettre le cap sur sa propre survie, pour lui-même (surmonter la faim) et contre les autres : les conflits et tensions entre chercheurs, aggravées par la convoitise de l’or. Toute cette première partie, dans la cabane, avec la faim à l’intérieur (la nourriture ou la mort), et le plateau enneigé (à l’extérieur l’or et la mort), évoque l’atmosphère des Rapaces de Stroheim, réalisé juste avant la Ruée à l’or, tournée en 1923 et sorti en décembre 1924. A la fin des Rapaces, deux hommes dans le désert, sous le soleil, se disputent l’argent, et ici, deux autres, Black Larson et Big Jim, se disputent une cargaison d’or dans la neige. Cette situation, où des hommes se battent pour leur propre survie et sont prêts à tout (le cannibalisme suggéré par les hallucinations de Big Jim) puis se disputent un trésor, caractérise le naturalisme du cinéma de Chaplin, où la nature humaine est guidée par le monde de besoin (la nourriture, avoir faim) et de l’envie : l’or, la richesse, la réussite par l’argent. Sauf qu’il s’agit d’un naturalisme burlesque, unique en son genre. Si Charlot semble préoccupé par sa propre survie (manger à sa faim), thème fréquent dans ses films, et guère préoccupé par l’or, il manque à ce naturalisme son moteur second (le sexe, le désir, la femme), objet de la seconde partie. Aux deux hommes, Black Larson et Big Jim, la quête de l’or, et à Charlot la « ruée vers la femme ». Dès ce plan large dans le saloon, où on voit longuement Charlot de dos au premier plan, observant la foule en train de danser, en amorce de la scène, on devine que, dans cette cavité humaine frénétique et surpeuplée, « sa mine » en quelque sorte, il va trouver sa pépite d’or, sous les traits de Georgia. Pas besoin de carte ni de boussole, le cap est vite trouvé. Au début du film, Charlot tombe sur un cadavre sous un monticule de terre couvert de neige puis, au village, se fait passer pour mort, allongé dans la neige, évanoui, bénéficiant ainsi d’un bon repas puis de la cabane du prospecteur qui lui en confie la garde avant de partir, lui aussi, chercher de l’or. Après la cabane trouvée, dans laquelle il se réfugie au début, il y a celle qu’il s’est choisie, futur nid de son idylle amoureuse, car peuplée de femmes (Georgia et ses amies), alors que la première était strictement masculine.
Tomboy
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Tesson Charles
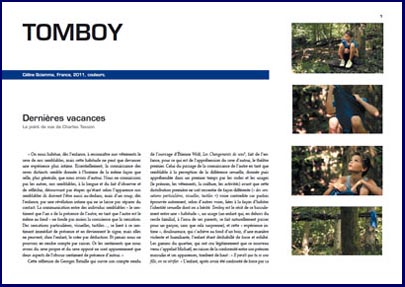
« On nous habitue, dès l’enfance, à reconnaître aux vêtements le sexe de nos semblables, mais cette habitude ne peut que devancer une expérience plus intime. Essentiellement, la connaissance des sexes distincts semble donnée à l’homme de la même façon que celle, plus générale, que nous avons d’autrui. Nous ne connaissons pas les autres, nos semblables, à la longue et du fait d’observer et de réfléchir, découvrant par étapes qu’étant selon l’apparence nos semblables ils doivent l’être aussi au-dedans, mais d’un coup, dès l’enfance, par une révélation intime qui ne se laisse pas séparer du contact. La communication entre des individus semblables -le sentiment que l’un a de la présence de l’autre, en tant que l’autre est le même au fond- ne fonde pas moins la conscience que la sensation. Des sensations particulières, visuelles, tactiles…, se lient à ce sentiment immédiat de présence et en deviennent le signe, mais elles ne peuvent, chez l’enfant, le créer par déduction. Et jamais nous ne pouvons en rendre compte par raison. Or les sentiments que nous avons du sexe propre et du sexe opposé ne sont apparemment que deux aspects de l’obscur sentiment de présence d’autrui. »
Cette réflexion de Georges Bataille qui ouvre son compte-rendu de l’ouvrage d’Etienne Wolf, Les Changements de sexe , fait de l’enfance, pour ce qui est de l’appréhension du sexe d’autrui, le théâtre premier. Celui du passage de la connaissance de l’autre en tant que semblable à la perception de la différence sexuelle, donnée puis appréhendée dans un premier temps par les codes et les usages (le prénom, les vêtements, la coiffure, les activités) avant que cette distribution première ne soit ressentie de façon différente (« des sensations particulières, visuelles, tactiles ») voire contredite car parfois éprouvée autrement, selon d’autres voies, liées à la façon d’habiter l’identité sexuelle dont on a hérité. Tomboy est le récit de ce basculement entre une « habitude », un usage (un enfant qui, en dehors du cercle familial, à l’insu de ses parents, se fait naturellement passer pour un garçon, sans que cela surprenne), et cette « expérience intime », douloureuse, qui s’achève au fond d’un bois, d’une manière violente et humiliante, l’enfant étant déshabillé de force et exhibé. Les gamins du quartier, qui ont cru légitimement que ce nouveau venu s’appelait Michaël, en raison de la conformité entre son prénom masculin et ses apparences, tombent de haut : « Il paraît que tu es une fille, on va vérifier. » L’enfant, après avoir été confronté de force par sa mère à l’enfant Rayan qu’il a frappé, ce dernier sachant désormais qu’il n’est pas le garçon qu’il prétendait être, tout comme Lisa, sa meilleure amie, prend la fuite seul dans la forêt, au lieu de rentrer chez lui avec sa mère. Cette même forêt où Lisa, alors que l’enfant était sorti de chez lui pour rejoindre le groupe des garçons, l’avait conduit la première fois, en franchissant avec lui un trou dans le grillage pour y accéder. Cette fois-ci, seul dans la forêt, l’enfant, assis au pied d’un arbre, retire la robe que sa mère l’avait obligée à mettre afin de signifier à son nouvel entourage qui il est. A cet instant, un mouvement de caméra ascendant, faussement subjectif, se laisse aspirer par la voûte des feuillages, le son du bruissement des feuilles au contact de l’air, dont la douceur gracieuse rappelle en ouverture du film le visage de l’enfant, par le toit ouvrant du véhicule, se laissant griser par le contact de l’air et du soleil à travers les feuillages. A la fin du mouvement de caméra, l’enfant est déjà parti, en fond de plan, tandis qu’on découvre la robe bleue posée sur une branche, telle une feuille morte, la relique d’un paraître rejeté. L’enfant tombe la robe, pour retrouver sa tenue familière (un débardeur ou marcel et un bermuda) avant de tomber sur le groupe de garçons qui, de manière sauvage, dans une sorte de tribunal improvisé, va anéantir publiquement le garçon qu’il a eu envie d’être, le temps d’un été. Tomboy (en français, « garçon manqué ») ou, littéralement, tomber sur le garçon (Lisa d’abord, le groupe ensuite) puis faire tomber le garçon, comme on le dit d’un masque, d’une apparence trompeuse.
Aux confins du réel et du magique
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
Réel/irréel
L’entremêlement du réalisme et du merveilleux est, dans Adama, le premier élément remarquable. Que ce soit dans la facture des personnages, la construction des décors ou dans les différentes thématiques abordées, ces deux domaines, en apparence dichotomiques, vont de pair. Dès la première image, celle de l’enfant sortant de l’eau, on est surpris de ne pas reconnaître les univers visuels habituels de l’animation informatique en 3D (1). Le formatage plastique des grosses productions hollywoodiennes type Pixar, Disney ou Dreamworks, avec leurs personnages aux détails corporels hyperréalistes mais aux textures lisses, aux visages rondouillets et aux yeux ou organes disproportionnés, est loin. Au contraire, Simon Rouby insiste sur les imperfections faciales, sur l’aspect humain des protagonistes en leur apportant des caractéristiques naturalistes et bien plus brutes.
Cependant, les logiciels ne travaillant que dans la perfection géométrique des formes et imposant une programmation minutieuse de tous les détails sales ou chaotiques, le cinéaste a choisi, dans un premier temps, de se passer de l’ordinateur et de revenir à une technique manuelle. Aidé par un sculpteur, il a réalisé les modèles en argile des visages de ses personnages sans chercher, bien au contraire, à gommer leurs irrégularités naturelles. Puis, dans un second temps, il les a scannés et numérisés en 3D pour pouvoir les faire se mouvoir.
Le premier effet est celui d’une étrange confrontation entre une technique archaïque – au sens de « commencement » et sans la connotation désuète que le mot porte aujourd’hui – et une autre bien plus contemporaine. Il n’est pas une année sans que les logiciels d’animation 3D n’améliorent drastiquement leurs possibilités et leurs performances graphiques. Si l’ordinateur permet de plus en plus d’atteindre un haut niveau de mimétisme avec le monde dans lequel nous vivons, la conception des objets numériques comporte une certaine part de mystère pour les non-initiés. Elle prend sa source dans une immense chaîne binaire de 0 et de 1. De façon plus lointaine, poterie et sculpture ont toujours entretenu des liens forts avec la magie. Les légendes selon lesquelles des êtres sculptés ou modelés prennent vie, s’animent, sont florès. Ici, l’âme du personnage est insufflée par l’ordinateur à partir d’un élément argileux qui a vocation à apporter une touche réaliste. Les êtres qui peuplent le film deviennent donc des golems informatisés aux mains des animateurs – ceux qui donnent la vie – à travers des schémas et des codes seulement compréhensibles par un nombre limité d’individus.
Lire l’intégralité du texte dans la plateforme NANOUK
Aux confins du réel et du magique
Extrait du Point de vue. Cahier de notes sur…
Plan, ligne et cercle
L’Irlande et la mythologie celtique ont permis à Tomm Moore de s’amuser à édifier des récits hautement symboliques tout en restant classiques qui trouvent des répercussions dans différentes cultures. Il les dote à chaque fois d’une dramaturgie forte, mais leur principal attrait réside dans les expériences plastiques qu’il s’autorise. Inventer des formes tout en adaptant ses récits à un public large et familial n’est jamais une mince affaire. Ces deux dimensions, essentielles, se rejoignent et se conjuguent au détour de plusieurs motifs qui ancrent Le Chant de la mer dans un univers qui oscille entre réel et imaginaire, se gardant d’entrer totalement dans le merveilleux afin de coller toujours à notre monde. C’est ainsi, par exemple, qu’on reconnaîtra les lieux et les décors. L’action se déroule à Dublin : la cathédrale Saint-Patrick ou la statue de Molly Malone, figures importantes de la cité, sont parfaitement visibles même si elles semblent étrangement situées. Le cinéaste va s’amuser à recomposer la nature et les paysages qu’on peut trouver en Irlande, tout en les parsemant de statues de sidhes. Sidhes qui vivent en ville dans un rond-point de verdure, au milieu des voitures, et dont l’entrée de la cachette se fait en passant dans un tonneau orné de graffitis plutôt osés et réalistes – au moins dans la version anglaise – avec un « feic off » ou un autre « no humans » [32.20].
Mais ce qui contribue à faire du Chant de la mer une œuvre oscillant entre un réel qu’il faut accepter et une magie dont il ne faut pas oublier qu’elle est inhérente à la création du monde, c’est aussi sa structure. Trop maîtrisée pour être naturelle, ce qu’amplifie encore une fabrication animée qui ne laisse guère de place à l’improvisation, elle joue sur des formes simples omniprésentes, apportant à l’œuvre un savoir-faire technique et esthétique indéniable.
Le film de Tomm Moore frappe en premier lieu par sa circularité et sa linéarité. Alors que le peintre Vassily Kandinsky écrivait en 1926 un court ouvrage retraçant son enseignement au Bauhaus qu’il nomma Point ligne plan et dans lequel il dégage une grammaire picturale, le cinéaste semble lui inspiré par un trio qu’on pourrait nommer : Cercle ligne plan.
Lire l’intégralité du texte dans la plateforme NANOUK
Haut en couleurs
Jason et les Argonautes
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Antoine Thirion
« For the Greek, gods are just big people »
Ray Harryhausen
Jason et les Argonautes est certes un spectacle pensé avant tout pour le grand public. Mais son illustre récit invite néanmoins à tenter de comprendre quel lien, quel rapport est établi entre mythologie et cinéma, création artistique et divine. C’est précisément l’art de Ray Harryhausen – un artisanat plutôt – qui introduit dans le film des questions liées à la croyance, au rapport des hommes au sacré. Mais plutôt que d’en faire une relation invisible, ce rapport est montré de façon parfaitement immanente. Le sacré est débarrassé de tout glacis historique, pour apparaître dans une certaine puissance primitive – colosses malhabiles, squelettes à la démarche saccadée, harpies en pâte à modeler, et des dieux montrés comme de simples parents ou de vieux époux. C’est la grande force de Jason et les Argonautes que de faire ressurgir des questions antiques dans une visibilité renouvelée, à la fois spectaculaire et mal ajustée, brute et ouvragée.
Un mythe impur
Comme toute légende, celle de Jason, l’une des plus anciennes, s’est construite peu à peu, au gré de multiples versions complémentaires ou contradictoires. Lors de l’émergence de cette civilisation vers 2000 avant Jésus-Christ, les Grecs ont en effet repris des mythes antérieurs dans les religions d’Égypte et du Moyen-Orient, tout en en forgeant de nouveaux, telle la figure du demi-dieu Hercule.
Si Jason et les Argonautes reprend la trame globale de la saga – le voyage héroïque d’un mortel confronté à l’humeur changeante des dieux –, les noms des protagonistes ou des lieux traversés diffèrent si souvent que chercher leur origine devient un problème épineux, voire une véritable impasse. Si Ray Harryhausen et ses scénaristes ont tenté d’adapter la mythologie plus fidèlement que d’autres à la même époque, ils ont aussi veillé à ce que le résultat corresponde aux attentes d’un public large. L’idée d’une suite ne fut pas moins abandonnée en raison des recettes décevantes du film que parce que Médée se révèle, pendant le retour de Jason en Thessalie, un personnage sanguinaire. Alors que Ray Harryhausen expliquait avoir voulu apporter certaines modifications à la légende afin de respecter les règles classiques de la narration cinématographique et d’offrir aux spectateurs un spectacle inédit, la suite aurait nécessité une trahison pure et simple de la légende à laquelle il ne voulait pas céder. « La suite de l’histoire de Jason est tellement morbide : Médée tue ses enfants et jette leurs membres aux quatre vents ! Peut-être que le public d’aujourd’hui aimerait ça, mais à l’époque on ne pouvait vraiment pas le montrer. »
Il faut ainsi moins considérer Jason et les Argonautes comme l’adaptation d’un mythe que comme une nouvelle transformation d’un matériau déjà impur. Le film ne peut peut-être pas prétendre nous documenter de quelque manière sur la mythologie, mais les transformations apportées à celle-ci aident à comprendre certains aspects du projet de Ray Harryhausen. Par exemple, dans l’épisode de l’île de Bronze tel que le poète Apollonius de Rhodes l’a raconté au IIIe siècle, Hylas commet l’imprudence de se laisser séduire par une nymphe des forêts qui s’était jetée à son cou. Cet impair aurait paru peu vraisemblable au spectateur, à qui Hylas a été présenté comme un être particulièrement malin.
L’Enfance d’un chef
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Pierre-Olivier Toulza
 Lors de sa distribution en France, en septembre 2003, Paï, second long métrage de Niki Caro, a été accueilli par une presse généraliste modérément louangeuse, vantant « l’émotion » qui se dégage du récit, et aussi par une presse cinéphilique (Positif, Les Cahiers du cinéma) peu convaincue par le film de la Néo-zélandaise. Il ne s’agit pas, ici, d’occulter des maladresses qui, pourtant, ne devraient guère décourager l’analyse, puisque le film, malgré ses imperfections, intrigue et aussi permet d’appréhender, avec les enfants, une cinématographie des antipodes. Pour aller vite, disons que les défauts du film découlent de ses ambitions : Niki Caro explique ainsi avoir voulu faire de son œuvre, dont l’action se déroule entièrement sur la côte Est, l’équivalent de La Leçon de piano de Jane Campion qui fut tourné, quant à lui, sur la côte Ouest du pays. D’où – au regard des normes néo-zélandaises – une production ambitieuse qui associe financements locaux et étrangers. Comme parfois dans ce type de montage financier, l’addition de talents avérés et multiples court le risque d’aboutir à une certaine dispersion : pour la musique, omniprésente, Caro a fait appel à Lisa Gerrard, l’ex-chanteuse du groupe Dead Can Dance ; Tim Sanders, le producteur, fut aussi celui du Seigneur des anneaux, de Peter Jackson ; le chef décorateur, Grant Major, a lui aussi œuvré sur ce même film ; Cliff Curtis, enfin, qui interprète dans Paï le père de la fillette, s’est illustré dans La Leçon de piano. D’où le sentiment que, parfois, la cinéaste a laissé les rênes de son film à d’autres… ce qui n’est pas forcément critiquable, tant Paï s’affirme aussi comme l’œuvre d’un homme, le directeur de la photographie Leon Narbey, qui parvient souvent à insuffler à son image une véritable profondeur (aux sens propre et figuré, s’entend). Et seule la projection en salles – notons-le d’emblée pour les adeptes du DVD – rend justice au travail du chef-opérateur, jamais aussi à l’aise que dans l’obscurité presque totale (scènes nocturnes dans la pirogue du père, par exemple), les lumières blêmes, les teintes presque délavées (cf. Analyse de séquence ).
Lors de sa distribution en France, en septembre 2003, Paï, second long métrage de Niki Caro, a été accueilli par une presse généraliste modérément louangeuse, vantant « l’émotion » qui se dégage du récit, et aussi par une presse cinéphilique (Positif, Les Cahiers du cinéma) peu convaincue par le film de la Néo-zélandaise. Il ne s’agit pas, ici, d’occulter des maladresses qui, pourtant, ne devraient guère décourager l’analyse, puisque le film, malgré ses imperfections, intrigue et aussi permet d’appréhender, avec les enfants, une cinématographie des antipodes. Pour aller vite, disons que les défauts du film découlent de ses ambitions : Niki Caro explique ainsi avoir voulu faire de son œuvre, dont l’action se déroule entièrement sur la côte Est, l’équivalent de La Leçon de piano de Jane Campion qui fut tourné, quant à lui, sur la côte Ouest du pays. D’où – au regard des normes néo-zélandaises – une production ambitieuse qui associe financements locaux et étrangers. Comme parfois dans ce type de montage financier, l’addition de talents avérés et multiples court le risque d’aboutir à une certaine dispersion : pour la musique, omniprésente, Caro a fait appel à Lisa Gerrard, l’ex-chanteuse du groupe Dead Can Dance ; Tim Sanders, le producteur, fut aussi celui du Seigneur des anneaux, de Peter Jackson ; le chef décorateur, Grant Major, a lui aussi œuvré sur ce même film ; Cliff Curtis, enfin, qui interprète dans Paï le père de la fillette, s’est illustré dans La Leçon de piano. D’où le sentiment que, parfois, la cinéaste a laissé les rênes de son film à d’autres… ce qui n’est pas forcément critiquable, tant Paï s’affirme aussi comme l’œuvre d’un homme, le directeur de la photographie Leon Narbey, qui parvient souvent à insuffler à son image une véritable profondeur (aux sens propre et figuré, s’entend). Et seule la projection en salles – notons-le d’emblée pour les adeptes du DVD – rend justice au travail du chef-opérateur, jamais aussi à l’aise que dans l’obscurité presque totale (scènes nocturnes dans la pirogue du père, par exemple), les lumières blêmes, les teintes presque délavées (cf. Analyse de séquence ).
Hésitations
Film oscillant entre mise en scène et photographie, entre sens et sensation également, tout comme entre récit logique, linéaire, et spectacle (comment ne pas songer au Grand Bleu de Besson devant les plans sous-marins illustrés par la voix et les accords de Lisa Gerrard ?), Paï fait de l’hésitation le moteur de son récit : c’est là une des qualités principales du film, la source de son étrangeté. Paï est l’histoire d’une communauté, mais aussi celle d’une famille, ou tout simplement celle d’une enfant solitaire. De plus, le film se présente comme une fiction de l’initiation – mais cette ligne scénaristique, qui épouse largement la trame du conte merveilleux, est mise en tension par un souci réaliste ou, pour être exact, ethnologique, qui affleure régulièrement au cours du récit. Le village maori paraît, de prime abord, littéralement coupé du monde : parce qu’il est accolé à l’océan et isolé de façon étanche par des collines et une contrée désertique (filmées lors du bref départ de la fillette en compagnie de son père), on pourrait penser que l’endroit est un lieu clos et quasi utopique, un milieu fermé dans lequel, à l’écart de la modernité néo-zélandaise, peuvent surgir, comme dans les contes,le passé et le mythe. Pour autant, on comprend vite que les habitants du village sont loin d’être en dehors de leur époque : les femmes fument, les hommes boivent, s’habillent avec des pantalons en cuir et des lunettes de soleil voyantes, ils partent en virée avec leurs «potes» dans des Ford noires… De l’ensemble se dégage en filigrane le constat plutôt pessimiste dressé au sujet d’une société qui paraît écartelée entre modernité et tradition, et au sujet d’un village où nombreux sont ceux qui fuient très loin, et où ceux qui restent semblent vaincus par le chômage, l’alcool et l’inaction, ou au contraire se réfugient dans la nostalgie d’un passé d’autant plus valorisé et idéalisé qu’il est définitivement révolu.
Spectacles
Dans cette situation de déshérence, le seul lien qui puisse durablement s’instaurer entre les générations, et surtout entre les vivants et leurs racines, relève du simulacre et de l’artifice. Un bon tiers du film est ainsi composé de longues séquences de représentations, au cours desquelles les enfants chantent, et aussi jouent face à un public d’adultes quelque peu désabusés le mythe des origines…
Cahier de notes sur…
écrit par Marcos Uzal
Le Chien jaune de Mongolie s’accorde au rythme de la vie d’une famille de nomades des steppes mongoles. Sa lenteur, son caractère contemplatif, sa simplicité narrative traduisent la perception de ses personnages. Ce rythme pourrait constituer pour le spectateur occidental, habitué à des actions et des récits plus complexes, un premier dépaysement. Et c’est l’une des principales qualités de ce film que de prendre ainsi le temps de s’attacher à des choses simples plutôt que de gonfler artificiellement le drame. Nous verrons que les antagonismes (entre le père et la fille, entre les éleveurs et les loups) servent ici à ancrer un récit mais ne sont pas au centre, car tout s’avère finalement emporté dans un même mouvement, appartenir à un seul et même grand cycle. Il s’agit au bout du compte, au-delà des oppositions relatives, de révéler une certaine harmonie du monde. Dans cette analyse, nous prendrons donc en compte la dimension spirituelle du film, les références au bouddhisme sur lesquelles il se fonde. Bien sûr, pour y être sensible, il importe peu d’être bouddhiste ou non, de croire ou non en la réincarnation. Tout film, quel que soit son point de vue, propose un rapport au monde et l’important est que celui-ci produise une forme singulière qui le rende partageable.
Une harmonie à trois niveaux
« Pour moi, affirme Byambasuren Davaa, le film a trois niveaux. D’abord, l’histoire écrite par Gantuya Lhagva. Un enfant veut un chien et son père n’est pas d’accord. C’est le premier niveau. C’est un récit universel auquel tout le monde peut se rattacher. Ensuite, il y a un niveau spirituel autour de la fable du chien jaune. C’est une légende que j’ai apprise quand j’étais petite. Ma grand-mère me la racontait. Enfin, il y a un aspect documentaire. Le film montre des tranches de réalité, les changements d’une culture et la vie quotidienne des nomades. »
1er niveau. Le film se situe donc d’abord dans un contexte culturel très spécifique tout en tendant vers une forme d’universalité. La simplicité du récit permet à la réalisatrice (qui vit en Allemagne) de s’adresser au plus grand nombre, à son peuple comme aux spectateurs lointains que nous sommes, aux adultes aussi bien qu’aux enfants. Ceux-ci s’accrocheront d’abord au film à travers des éléments classiques du cinéma pour enfants, contenus dans le conte : un autre enfant auquel s’identifier, un désaccord avec des adultes, un animal auquel s’attacher.
2e niveau. La minceur de l’histoire laisse une grande place à l’aspect documentaire, aux gestes domestiques qui tempèrent la dramatisation pour nous rapprocher au plus près de la vie quotidienne de ces nomades. Ces gestes familiers pour les protagonistes nous paraissent très loin des nôtres, et en même temps ils renvoient à notre propre quotidien, à nos propres nécessités: se nourrir, s’habiller, travailler, construire sa maison, jouer… Ils nous montrent la valeur de ces choses essentielles pour ces hommes à la vie précaire. Il est d’ailleurs frappant de voir combien les parents ne cessent de travailler, même lorsqu’ils sont avec leurs enfants, presque chacune de leurs apparitions les montrant accomplir une tâche vitale pour la famille. De la préparation d’un repas au démontage d’une yourte, le film accompagne ces actions avec une précision ethnographique, tout en étant très sensible à leur beauté visuelle (voir par exemple la façon dont la réalisatrice filme les tissus ou la charpente de la yourte).
3e niveau. Le niveau le plus complexe est ce que Davaa appelle « le niveau spirituel ». Il est explicité dans le rêve de Nansa qui évoque la conception de la vie et de la mort selon les bouddhistes, le cycle des réincarnations. Cette dimension apparaît dès l’ouverture du film (le père expliquant à l’enfant que « Tout le monde décède, personne ne meurt ») et revient à plusieurs reprises (notamment dans le rêve de Nansa et dans la scène où les enfants regardent les nuages).
À la grande colline ! Pour quoi faire ?
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Luce Vigo
 Elle est tout entière dans les yeux du vieux Pugsa lorsqu’il la regarde au loin, la grande colline, la première fois que Rabi vient s’occuper de lui, selon la promesse de son père faite au vieil homme. « Pourtant », dit Rabi, « on la voit à peine ! » Les journées, au village, bien rythmées par les travaux de chaque jour et que Gaston Kaboré filme telle une chronique paysanne, se répètent : la mère et la sœur de Rabi mixent la terre pour fabriquer les poteries que le père ou elles-mêmes iront vendre au marché, elles pilent le mil et préparent les feuilles d’oseille… Le père et son apprenti activent le feu de la forge et travaillent le fer, les jeunes filles vont chercher et rapportent l’eau, la marchande de tabac prépare sa marchandise, et Rabi se partage entre son apprentissage au métier de forgeron, les petits services à rendre à Pugsa (lui apporter sa ration quotidienne de tabac et de noix de kola râpée), les tâches qui reviennent aux enfants comme aller chercher la terre sèche des termitières que les potières travailleront, et les jeux de leur âge. La ronde du soir les réunit au crépuscule. Chaque jour aussi, les coupeurs de bois déboisent un peu plus la région. Et chaque nuit apporte le repos. Même l’averse, la récolte du mil et les règles de Laalé sont inscrites dans ce qui doit arriver ! Et pendant ce temps, quoi qu’il advienne, la grande colline est toujours là, présente dans les pensées et les regards de Pugsa et de Rabi, telle un appel à une mystérieuse et large appréhension de l’univers. Très attaché au respect des valeurs rurales, c’est de manière simple et juste, documentée pour ne pas dire documentaire, que Gaston Kaboré approche ses personnages bien ancrés dans leur environnement pour lequel ils ont quelques inquiétudes : le charbon de bois ne va-t-il pas manquer pour continuer à alimenter le feu de la forge ou la cuisson de la poterie ? Le vieil homme, Pusga se souvient de la forêt, des grands animaux sauvages qui l’habitaient, la tortue se rappelle les histoires que les hirondelles rapportent de leurs voyages lointains… Car la tortue parle, fantasmatique mais logique aboutissement de tout un cheminement mental et moral, fait par l’enfant et qui inscrit le film dans la tradition du conte.
Elle est tout entière dans les yeux du vieux Pugsa lorsqu’il la regarde au loin, la grande colline, la première fois que Rabi vient s’occuper de lui, selon la promesse de son père faite au vieil homme. « Pourtant », dit Rabi, « on la voit à peine ! » Les journées, au village, bien rythmées par les travaux de chaque jour et que Gaston Kaboré filme telle une chronique paysanne, se répètent : la mère et la sœur de Rabi mixent la terre pour fabriquer les poteries que le père ou elles-mêmes iront vendre au marché, elles pilent le mil et préparent les feuilles d’oseille… Le père et son apprenti activent le feu de la forge et travaillent le fer, les jeunes filles vont chercher et rapportent l’eau, la marchande de tabac prépare sa marchandise, et Rabi se partage entre son apprentissage au métier de forgeron, les petits services à rendre à Pugsa (lui apporter sa ration quotidienne de tabac et de noix de kola râpée), les tâches qui reviennent aux enfants comme aller chercher la terre sèche des termitières que les potières travailleront, et les jeux de leur âge. La ronde du soir les réunit au crépuscule. Chaque jour aussi, les coupeurs de bois déboisent un peu plus la région. Et chaque nuit apporte le repos. Même l’averse, la récolte du mil et les règles de Laalé sont inscrites dans ce qui doit arriver ! Et pendant ce temps, quoi qu’il advienne, la grande colline est toujours là, présente dans les pensées et les regards de Pugsa et de Rabi, telle un appel à une mystérieuse et large appréhension de l’univers. Très attaché au respect des valeurs rurales, c’est de manière simple et juste, documentée pour ne pas dire documentaire, que Gaston Kaboré approche ses personnages bien ancrés dans leur environnement pour lequel ils ont quelques inquiétudes : le charbon de bois ne va-t-il pas manquer pour continuer à alimenter le feu de la forge ou la cuisson de la poterie ? Le vieil homme, Pusga se souvient de la forêt, des grands animaux sauvages qui l’habitaient, la tortue se rappelle les histoires que les hirondelles rapportent de leurs voyages lointains… Car la tortue parle, fantasmatique mais logique aboutissement de tout un cheminement mental et moral, fait par l’enfant et qui inscrit le film dans la tradition du conte.
Du point de vue documenté aux fantasmes
Gaston Kaboré connaît bien ce qu’il met en scène. Il sait comment rendre, par une caméra dont il ne multiplie pas les mouvements inutiles – ils peuvent être souples comme les allées et venues de ses protagonistes dans la cour, s’arrêter le temps d’« enregistrer » un échange de paroles, une gestuelle liée au travail – sans que, pour autant, le rythme du film en souffre. Car le temps ne s’arrête jamais, lui, et la répétition des faits, qui se ritualisent (comme la « corvée » d’eau des jeunes filles – ou encore les visites de Rabi à Tusma ou à Pugsa), en n’étant jamais filmés, ou montés, de la même manière, font que quelque chose dans le récit avance doucement, à partir d’une réalité qui permet l’accession aux fantasmes. De même que Gaston Kaboré nous fait imaginer la rivière avant de nous la montrer dans toute sa tranquille splendeur, en un panoramique qui suit le retour au village de Rabi portant sa tortue fugueuse, de même il travaille l’idée de la grande colline comme un pur fantasme de Pugsa, qui prend forme quand l’enfant décide d’y mettre sa tortue à l’abri.
Le rôle des tortues
C’est l’arrivée au village, par accident, de la première tortue – de taille raisonnable – qui donne corps à bien des fantasmes, à bien des rêves. La seconde, énorme, ne fait que les accroître ou les renforcer. Chez Pugsa d’abord, que hante déjà le souvenir du moment précis où sa vie d’homme amoureux ne s’est pas accomplie. Sur quoi ses yeux se fixent-ils lorsque Rabi lui apprend que cette tortue a été trouvée en brousse ? Sur une colline invisible vers laquelle s’échappe son esprit. Plus que les mots, le silence et les regards disent cet invisible dont Rabi, à son tour va devoir faire l’apprentissage. « Car la grande colline, pour Gaston Kaboré, chacun de nous la porte en lui, c’est un lieu imaginaire et redouté qu’il faut prendre d’assaut. Pour Pugsa, c’est faire face à Tusma, demander pardon de n’avoir pas su réaliser leur amour, de n’avoir pas vécu avec elle*.» Et pour Rabi ? Cet enfant que le cinéaste nous présente dès la première séquence comme ayant du caractère – l’altercation qu’il a avec les garçons de son âge le montre bien, comme la remarque qu’il fait à son père sur son rapide retour du marché – s’est mis, lui aussi, à penser à cette colline qui, dans un premier temps, ne représente rien pour lui. Avant ce jour où il décide de faire ce long chemin pour rendre la tortue à la liberté, dans un endroit sûr, Rabi a reproduit, d’une manière concrète, les rapports de pouvoir que sa famille entretient avec lui : il a construit un abri à cette tortue, essayé de l’éduquer, il l’a nourrie, l’a retenue auprès de lui, exprimant de cette façon les fantasmes qui lui permettent d’échapper à l’emprise des siens. Non pas que ses parents soient de « mauvais » parents : ils représentent la loi parentale à laquelle Rabi a besoin de se référer et de s’opposer.
Une rupture esthétique
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Pascal Vimenet
 Vous êtes-vous demandé d’où venait… L’Étrange Noël de Monsieur Jack ? De même que Halloween est une fête qui convoque des revenants, de même L’Étrange Noël de Monsieur Jack est un film qui convoque une multitude de revenants, cinématographiques s’entend. Et, comme les revenants, L’Étrange Noël de Monsieur Jack, de plusieurs manières, se dérobe. Il se dérobe parce qu’il échappe à une narration et une dramaturgie classiques et que toute tentative de catégorisation se heurte instantanément au masque grimaçant et sarcastique de Halloween, sombre figure de la face cachée de la société américaine. L’Étrange Noël de Monsieur Jack est le film emblématique d’une rupture, thématique et esthétique, comme il n’y en a pas eu depuis longtemps dans l’histoire du cinéma d’animation américain. Soit le grotesque contre le « merveilleux », figure incontournable de toutes les tartes à la crème publicitaires du cinéma d’animation américain. Au-delà du seul renversement des valeurs narratives habituelles, l’esthétique gothique du film rejette trois dogmes principaux du cinéma d’animation disneyen : l’anthropomorphisme, les formes rondes et la bidimensionnalité. Non pas que des tentatives de remise en cause de ce canon n’aient existé précédemment, mais parce que L’Étrange Noël de Monsieur Jack a été conçu au cœur même de ce système de production. Du coup, il met à nu ses ressorts et son état internes : l’inspiration thématique et esthétique de la grande machine, en panne sèche depuis longtemps, pour tenter de se ressourcer, a dû perdre de son imperméabilité. Elle est devenue poreuse. À ses risques et périls. À quelle histoire la confronte donc L’Étrange Noël de Monsieur Jack ?
Vous êtes-vous demandé d’où venait… L’Étrange Noël de Monsieur Jack ? De même que Halloween est une fête qui convoque des revenants, de même L’Étrange Noël de Monsieur Jack est un film qui convoque une multitude de revenants, cinématographiques s’entend. Et, comme les revenants, L’Étrange Noël de Monsieur Jack, de plusieurs manières, se dérobe. Il se dérobe parce qu’il échappe à une narration et une dramaturgie classiques et que toute tentative de catégorisation se heurte instantanément au masque grimaçant et sarcastique de Halloween, sombre figure de la face cachée de la société américaine. L’Étrange Noël de Monsieur Jack est le film emblématique d’une rupture, thématique et esthétique, comme il n’y en a pas eu depuis longtemps dans l’histoire du cinéma d’animation américain. Soit le grotesque contre le « merveilleux », figure incontournable de toutes les tartes à la crème publicitaires du cinéma d’animation américain. Au-delà du seul renversement des valeurs narratives habituelles, l’esthétique gothique du film rejette trois dogmes principaux du cinéma d’animation disneyen : l’anthropomorphisme, les formes rondes et la bidimensionnalité. Non pas que des tentatives de remise en cause de ce canon n’aient existé précédemment, mais parce que L’Étrange Noël de Monsieur Jack a été conçu au cœur même de ce système de production. Du coup, il met à nu ses ressorts et son état internes : l’inspiration thématique et esthétique de la grande machine, en panne sèche depuis longtemps, pour tenter de se ressourcer, a dû perdre de son imperméabilité. Elle est devenue poreuse. À ses risques et périls. À quelle histoire la confronte donc L’Étrange Noël de Monsieur Jack ?
À l’origine
À l’origine de l’aventure du film de Henry Selick et Tim Burton, on trouve une parodie d’un poème de Clement Clark Moore, Night Before Christmas, transformé illico par Tim Burton en un autre qui a donné son titre original au film, The Nightmare Before Christmas.
Le poème de Burton, écrit dix ans auparavant, démarrait ainsi :
C’était durant l’automne, dans la ville de Halloween.
La Lune frissonnait, Et là-haut, solitaire, assis sur la colline, un squelette ruminait,
Portant chauve-souris pour tout nœud papillon,
C’était Jack Skellington, un mince et grand garçon.
Un cauchemar… Matrices de l’idée du film, la rythmique poétique initiale et son contenu sarcastique sont essentiels. Ils engendrent la versification ironique des chants qui scandent le récit, faisant de celui-ci une ballade, et conditionnent simultanément sa construction et les choix plastiques. Le processus avait été le même dans Vincent, premier court métrage d’animation de l’auteur (1982), lorsque Vincent Price lisait, off, l’histoire du petit Vincent. Halloween, Lune, frisson, squelette, chauve-souris… Tout l’univers de L’Étrange Noël de Monsieur Jack se cristallise autour de cette première intuition : tant le principe du récit, qui ressortit avant tout à la danse ou à la ronde macabre, que la prééminence de la figure de Halloween incarnée par Jack, et que sa traduction esthétique qui donne la primauté au volume et au sombre.
Qui sont les monstres ?
Lorsque, apparemment en contradiction avec ce qui vient d’être énoncé, Tim Burton déclare: « On peut trouver l’idée de départ étrange, voire déconcertante, mais il n’y a réellement pas d’affreux dans ce film. Il s’agit, en fait, tout simplement d’un éloge de Halloween et Noël – mes deux fêtes préférées », il désigne implicitement l’ambition de L’Étrange Noël de Monsieur Jack et pose en réalité, comme innocemment, une seule question « Qui sont les monstres ? » : « On obéit toujours à une logique interne. Il y a d’une part la figure de la quête. Le personnage de Jack est à la recherche de quelque chose de positif. Et, d’autre part, le thème de la perception. Le personnage peut être perçu comme effrayant, mais l’est-il vraiment ? Pour moi, le film s’est structuré autour d’un thème majeur : un personnage fondamentalement bon est à la recherche de quelque chose de positif, mais les autres le perçoivent comme négatif. En fait c’est l’histoire classique depuis Frankenstein : comment on perçoit les gens et les choses. »
Si l’enjeu d’un dispositif de sensibilisation artistique tel que École et cinéma est de rendre possible la rencontre avec des œuvres inventant une langue qui leur soit propre, s’il est aussi de proposer aux écoliers d’identifier et d’approcher cette singularité, non pas comme une langue qui nous est étrangère, mais comme une invitation à réinventer notre propre langage, notre propre regard, comment appréhender l’expérience particulière que représente la découverte d’un programme de courts métrages ?
Comment en effet dégager de la juxtaposition des propositions que chaque film construit et qui se trouvent réunies – de manière plus ou moins arbitraire – dans un seul et même programme de films, ce qui relèverait de cet horizon de l’éducation artistique qu’est « le point de vue de l’auteur » ? Qu’y aurait-il à apprendre de la coprésence de ces mondes et des résonances qui nécessairement apparaissent dans ces rapprochements ? Qu’y aurait-il à découvrir sur les chemins de traverse qui, circulant d’une œuvre à l’autre, nous font à chaque fois déborder leurs spécificités et nous entrainent à l’aventure, loin du monde clos qu’elles dessinent ?
Cette aventure, c’est celle que se propose de dégager ce texte qui s’attachera moins à parcourir chacun des films proposés qu’à explorer les chemins qui les relient secrètement et qui, en eux-mêmes, définissent un voyage singulier, celui des Aventuriers.
Au commencement
Si on ne sait pour l’instant pas où nous arriverons, du moins connaît-on notre point de départ. Quel est-il ici ?
Trois des films du programme s’ouvrent en pointant un lieu que l’on pourrait rapprocher, le lieu où se noue, dit-on, l’apprentissage des savoirs et du sens, le lieu de l’étude. Celui de l’école pour les jeunes élèves de La Première nuit et de Rentrée des classes, celui du monastère pour le moine du film de Michaël Dudok de Wit.
Dans Le Moine et le poisson, le lieu de l’étude est un lieu de vie. Une vie un peu particulière puisque, monastique, elle est une vie de peu, une vie de retrait du monde. Un monde extérieur particulièrement absent. Mise à part la présence de quelques oiseaux parcourant librement l’espace du ciel et celui du cadre, rien n’existe d’abord en effet que le monastère et l’aqueduc attenant, vides tous les deux. C’est un lieu totalement hors du temps et de l’espace, un lieu qui nous est d’abord présenté depuis l’intérieur de sa clôture, un lieu de refuge où l’on peut à l’ombre de ses larges murs – et bercé par une Folia dont la structure répétitive renvoie à cette idée de clôture – consulter les livres pour chercher à solutionner les questions auxquelles, malgré tout, le monde nous confronte.
Il en est un peu autrement dans le film de Jacques Rozier. À l’annonce de la toute proche rentrée des classes, l’élève Boglio s’empresse d’aller faire faire à un autre les devoirs de vacances qu’il ne juge pas bon de réaliser lui-même. L’école est d’emblée posée comme le lieu d’une contrainte qu’on cherche à esquiver. Mais au-delà de ce rapport particulier qu’entretient un élève avec l’institution scolaire, c’est aussi tout un rapport au savoir qui est, par son biais, désigné. À travers le portrait d’une classe et de son enseignant, Rentrée des classes semble en effet questionner ce qui véritablement s’apprend dans cette école de la dictée et des savoirs préétablis qu’il importe avant tout de savoir répéter. Le générique sur lequel s’ouvre le film, écrit sur le papier à carreau des cahiers d’écoliers, ne nous renvoie-t-il pas d’ailleurs à l’idée que la première des choses à savoir c’est de savoir suivre les lignes qui ont préalablement été tracées pour nous, pour l’écriture ou pour la discipline ?
Dans La Première nuit enfin, l’école est aussi le lieu où débute le film avec cette fois-ci l’arrivée joyeuse des élèves dans l’établissement au petit matin. Mais l’expérience que celle-ci représente est étrangement passée sous silence. Il est même curieux de noter que si l’école ne présente, dans la suite du film, aucun intérêt dramaturgique, Georges Franju prend le soin d’y ancrer le parcours de son jeune héros mais comme pour mieux le désigner comme espace vide. Ainsi, dans la collure entre deux plans, une journée d’apprentissage s’écoule entièrement sans qu’il n’en soit rien dit. Journée qu’il faudra ensuite mettre en regard de l’expérience à venir, celle que cristallisera cette première nuit de fugue.
Étranges caractérisations donc pour ce lieu censé être celui où l’individu se forme afin de se construire une place propre dans un monde qui ne l’attend pas pour tourner. Un lieu qui, s’il peut être de quiétude, est pourtant ici étrangement coupé du monde, si ce n’est complètement absent à celui-ci.
Coupée du monde, la jeune femme qui attend son petit poisson dans Le jardin l’est aussi à sa manière, tout comme le hérisson au début du film de Youri Norstein. Tous les jours la jeune femme attend. Tous les soirs, le petit hérisson quitte sa maison pour retrouver son ami l’ourson et compter avec lui les étoiles dans le ciel.
Comme dans les films auparavant cités, on retrouve ce point initial qu’est le retrait du monde mais sur un mode plus intime. Cette absence qui rend le hérisson étranger à la présence inquiétante du hibou qui le suit, ce retrait qui met la jeune femme du jardin un moment à l’écart, semble en effet ici venir de leur monologue intérieur et du programme qu’il ne s’agit que de suivre à l’aveugle : tous les soirs se mettre en chemin, apporter de la confiture de framboise, s’assoir sur un tronc d’arbre, toujours le même, et, sirotant un thé, compter les étoiles du ciel avec son ami. Au commencement donc, la vie, mais comme absente à elle-même
Splash ! ! !
Extrait du Point de vue du Cahier de notes sur…
écrit par Anne-Sophie Zuber
 En bras de chemise, veste sur le bras et instrument à la main, des musiciens descendent en trottinant une rue en pente. Ils trottinent mais ne courent pas car leur âge ne leur permet pas d’aller aussi vite que leur curiosité les y pousserait. En effet tout l’orchestre « troisième âge » dont Louis est l’un des violonistes, a abandonné sa répétition pour aller vérifier, de visu, l’incroyable nouvelle : Louis aurait un crocodile dans sa baignoire ! Louis n’aurait-il pas des visions après avoir bu un petit coup de trop ? Louis, c’est Grand-Père, le grand-père de Katia et Minka, deux petites filles dégourdies et autonomes, qui sont au cœur de l’aventure : Katia s’est engagée à garder pour la journée la colonie animalière d’une école, que lui a confiée Micha, petit garçon rencontré au hasard de la rue ; mais sa petite sœur, Minka, en voulant jouer avec les animaux, les a tous laissés s’échapper. Et voici que, juste au bas de cette rue en pente parcourue par les vieux musiciens, se mêlant à leur flot, déboule une cavalcade d’enfants : Katia a prévenu ses copines de la présence des animaux chez elle et les voilà toutes, courant et suivies d’une flopée d’autres petits curieux alléchés par le crocodile. D’un côté des vieillards, de l’autre des enfants, réunis là dans un mélange des âges tout à fait réjouissant.
En bras de chemise, veste sur le bras et instrument à la main, des musiciens descendent en trottinant une rue en pente. Ils trottinent mais ne courent pas car leur âge ne leur permet pas d’aller aussi vite que leur curiosité les y pousserait. En effet tout l’orchestre « troisième âge » dont Louis est l’un des violonistes, a abandonné sa répétition pour aller vérifier, de visu, l’incroyable nouvelle : Louis aurait un crocodile dans sa baignoire ! Louis n’aurait-il pas des visions après avoir bu un petit coup de trop ? Louis, c’est Grand-Père, le grand-père de Katia et Minka, deux petites filles dégourdies et autonomes, qui sont au cœur de l’aventure : Katia s’est engagée à garder pour la journée la colonie animalière d’une école, que lui a confiée Micha, petit garçon rencontré au hasard de la rue ; mais sa petite sœur, Minka, en voulant jouer avec les animaux, les a tous laissés s’échapper. Et voici que, juste au bas de cette rue en pente parcourue par les vieux musiciens, se mêlant à leur flot, déboule une cavalcade d’enfants : Katia a prévenu ses copines de la présence des animaux chez elle et les voilà toutes, courant et suivies d’une flopée d’autres petits curieux alléchés par le crocodile. D’un côté des vieillards, de l’autre des enfants, réunis là dans un mélange des âges tout à fait réjouissant.
Débordements
La multitude des personnages envahit l’écran, déborde du cadre et me renvoie à l’image où l’eau ayant rempli toute la baignoire, le crocodile, grimpé sur la planche qui flotte, s’échappe par la fenêtre ouverte. Mais il n’y a pas que la baignoire qui déborde dans cette histoire : les ballons jaillissent des boîtes et rebondissent comme des éclaboussures, les enfants dévalent rues et escaliers comme de l’eau qui coule, pour se répandre dans l’appartement de Katia complètement inondé (pour de vrai !). La scène où Katia et Micha franchissent impétueusement la porte cochère de la cour de l’immeuble évoque encore cette image d’eau bondissante. Pour détourner l’attention des enfants de la rue, Katia a fait semblant de retourner chercher un éléphant oublié, entraînant derrière elle les plus curieux. Faisant volte-face, elle rentre en courant et somme les enfants de la cour de bloquer la porte pour empêcher l’éléphant d’entrer. Mais, poussé par une locataire furieuse, l’obstacle saute, comme un bouchon. Débordement encore, le petit vent de folie qui, gagnant tout le quartier, pousse un courageux vieillard à cheveux blancs et un ancien combattant portant élégamment chapeau, cravate et parapluie, à vagabonder sur les toits à la recherche du fameux crocodile. Débordement aussi, dans le merveilleux insolite avec la séquence du ballon de Katia qui tourne dans le ciel, celle des carreaux cassés qui se réparent magiquement, celle, finale, des ballons qui remontent, tout bondissants, les marches de la rue, bouclant l’histoire. L’image est poétique certes, mais c’est parce qu’elle est cinématographique qu’elle prend toute sa force.
Investir les adultes
Pour nous faire partager cette explosion, les réalisateurs alternent des gros plans et des plans rapprochés (en particulier sur les enfants) avec des vues générales qui nous plantent dans un pittoresque quartier (du vieux Prague ?). Il faut sans arrêt plonger les yeux dans la cour ou les lever vers les balcons et les toits pour suivre les galopades des enfants, les escapades des animaux. C’est un vrai plaisir de capter ainsi des fragments de cette si belle ville, plus qu’un décor, presqu’un personnage, discret certes, mais présent tout de même. La grande mobilité de la caméra accentue cette découverte « à la sauvette » mais pas superficielle pour autant. Car c’est l’un des charmes de ce film que de montrer des enfants qui investissent aussi librement une ville comme terrain de jeux et qui, de plus, jouent à détourner les actions des adultes : « Moi aussi, j’veux jouer ! » s’écrie le petit garçon qui a ouvert les robinets de la lance à incendie pendant que les plus grands ont déjà escaladé l’échelle des pompiers. Pour les récupérer, il faut les faire sauter dans la toile tendue par les valeureux pompiers ! L’occasion est trop belle : une véritable noria s’installe immédiatement…




























































